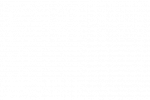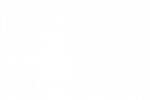Les personnels psychiatriques battent le pavé pour réclamer « un renouveau des soins psychiques »

Les personnels psychiatriques battent le pavé pour réclamer « un renouveau des soins psychiques »
Par Valentin Cebron
Entre 300 et 500 manifestants ont défilé jeudi à Paris pour protester contre la décrépitude des services psychiatriques.
A quelques pas de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (XIIIe), une couronne de fleurs est venue orner la statue de Philippe Pinel. Un médecin de renom, « bienfaiteurs des aliénés », ayant œuvré à la fin du XVIIIe siècle pour l’humanisation du traitement des malades mentaux. Mercredi 21 mars, le point de rendez-vous de la manifestation est loin d’être anodin. Il est même symbolique. Médecins psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, familles de patients et patients : ils étaient, selon les organisateurs, entre 300 et 500 à venir réclamer « un renouveau des soins psychiques ».
Tous sont unanimes pour dénoncer des services psychiatriques à l’abandon. « La maladie mentale est une maladie du lien social. Recréons du lien pour soigner », pouvait-on lire sur l’une des pancartes qui flottaient au-dessus des têtes des manifestants. Patrick, un quinquagénaire syndiqué CGT Santé, est venu de loin pour exprimer sa colère. Cet infirmier en psychiatrie du centre hospitalier de Lavaur (Tarn) défend « l’idée d’une approche relationnelle du soin ». « Sauf qu’on n’en peut plus, poursuit-il, indigné. Dans mon service, les absences ne sont pas remplacées. Et, malgré notre bonne volonté, les répercussions sur les conditions de soins auprès de nos patients sont terribles. »
Listes d’attente interminables
Nombre de manifestants soulignent un manque de moyens, qui se traduit par des sous-effectifs et un trop faible temps accordé à chaque patient. Les quelque 100 millions d’euros alloués à la psychiatrie pour l’année 2019 ne sont qu’une vaste illusion perdue, souffle-t-on dans les rangs. Certains psychiatres se disent même obligés de faire du « surbooking ». A l’image de Mathieu Bellahsen, praticien à l’hôpital public Roger-Prévot (Val-d’Oise) qui, en ce moment, est sur une cadence de plus de trente patients journaliers. « Si on ne les voit pas, ils ne sont pas bien. Mais lorsque les consultations durent cinq minutes, on est conscient de ne pas faire du bon boulot », regrette-t-il. Confronté à ce dilemme et en proie à une souffrance éthique, il évoque « une honte quotidienne de ne plus pouvoir réussir à faire notre travail ».
Un sentiment partagé par beaucoup de professionnels du secteur, dont Roger Teboul, président de l’Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile (API). Ce dernier déplore des listes d’attente interminables. « Et qui dit liste d’attente dit aussi tri. Ce tri que nous sommes obligés de faire relève de la médecine de catastrophe. L’état de notre société est-il à ce point catastrophique ? », s’interroge-t-il lors d’une prise de parole. Delphine Glachant, de l’Union syndicale de la psychiatrie (USP), assure être forcée d’espacer ses consultations. « Je ne peux pas voir mes patients autant que je voudrais », admet-elle désespérément.
Recrudescence de l’isolement et de la contention
Ce tri affecte en tout premier lieu les patients. Salim, 24 ans, fréquente l’hôpital parisien de Saint-Anne depuis quelques années. Accompagné d’Ines, 19 ans, « diagnostiquée maniaco-dépressive », il est venu battre le pavé pour alerter sur sa condition. « J’aimerais plus d’accompagnement. Il n’y a pas assez d’échanges, ni d’entretiens avec les médecins. On essaie de m’aider avec les médicaments, mais ça ne suffit pas », se plaint-il. Si la jeune fille assure bénéficier d’un bon accompagnement psychiatrique, la raison de sa présence est tout autre. Elle s’oppose aux hospitalisations contraintes, qu’elle a déjà vécues, et à la contention.
A l’heure où les structures d’accueil essuient un manque patent de personnel, le recours à l’isolement, à la contention et à la médication à outrance se fait de plus en plus récurrent. « Quand on a trois soignants pour s’occuper de trente patients, il faut aller au plus rapide. L’angoisse du patient qui n’est pas canalisée implique malheureusement plus de médicaments et plus d’enfermement », peste, écœuré, Mathieu Bellahsen. « On préfère nous former à des techniques de krav-maga plutôt que d’augmenter le personnel pour soigner », ironise un infirmier du syndicat SUD vêtu d’une blouse blanche sur laquelle est inscrit au feutre, « des sous, pas des coups ». Plus loin, Catherine Skiredj-Hahn, la mère d’une ancienne patiente diagnostiquée schizophrène, prône « l’abolition de la contention et de l’isolement ».
Présidente du Fil conducteur psy – une association regroupant patients, familles de patients, et soignants –, elle dénonce « des pratiques barbares qui sont aujourd’hui considérées comme des soins » en tant que tels. Cette sociologue, meurtrie par le suicide de sa fille, défend au contraire une approche humaniste et plurielle de la maladie mentale. Car pour elle, comme pour beaucoup d’autres manifestants, il ne s’agit pas d’une maladie comme les autres.
« Logique comptable »
« Les neurosciences souhaitent imposer un modèle avec une seule bonne approche pour répondre aux problèmes de pathologie mentale. Cette conception se focalise sur les symptômes au lieu de tenir compte d’une histoire et d’une personnalité », martèle Paul Bretcher, 69 ans, ancien psychiatre du service public. Et ce, souvent au détriment des thérapies insufflées par les psychologues. Patricia, psychologue en psychiatrie depuis 16 ans, constate une détérioration de son métier. « Je suis la seule à temps plein dans mon secteur », assure la quadragénaire. Se frayant un chemin entre les manifestants affublés de chapelets de fleurs autour du cou et d’entonnoirs accrochés sur la tête, elle est venue manifester avec un ancien collègue, aujourd’hui retraité. Jacques, 69 ans, se souvient d’une autre époque : « Avant, les hôpitaux proposaient beaucoup plus d’activités thérapeutiques. Maintenant on enferme, puis on met à la rue. Seule la logique comptable règne, alors que ces maladies nécessitent du cas par cas. »
Un avis que partage Violaine, 75 ans, mère d’une patiente tombée malade il y a vingt-cinq ans, qui a vu « la détérioration du service public en psychiatrie ». Pendant quinze ans, sa fille a consulté dix-sept psychiatres différents.