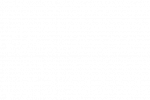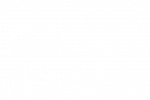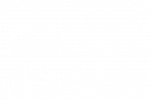En Algérie, Bouteflika a ramené la paix, pas la réconciliation

En Algérie, Bouteflika a ramené la paix, pas la réconciliation
Par Charlotte Bozonnet
Dès son arrivée au pouvoir en 1999, le président fait de la fin de la guerre civile une priorité. Une pacification sans vérité ni justice, dont les conditions ont été imposées aux Algériens.
Manifestation, en février 2000, contre la grâce présidentielle accordée par Abdelaziz Bouteflika aux membres de l’Armée islamique du salut. / AFP
C’est sans aucun doute sa principale réalisation, l’une des raisons de sa popularité persistante malgré toutes les difficultés. « Vous ne vous rendez pas compte : on a pu sortir à nouveau, voyager dans le pays, après des années de peur pendant lesquelles les parents nous interdisaient même d’aller au marché », confiait en 2015 un jeune habitant d’Alger, âgé d’une trentaine d’années.
Elu président pour la première fois en 1999, Abdelaziz Bouteflika aura fait du retour à la paix une priorité. Depuis le début des années 1990, l’Algérie est dévastée par un affrontement sans pitié entre l’armée et les groupes islamistes. En octobre 1988, des émeutes et des manifestations contre l’arbitraire du régime avaient éclaté dans plusieurs grandes villes du pays. Réprimées dans le sang, elles avaient néanmoins contraint le pouvoir à ouvrir le jeu politique et à autoriser le multipartisme.
Sans précédent, cette période d’ouverture fit toutefois long feu : en 1992, l’armée prend le pouvoir pour faire barrage aux islamistes du Front islamique du salut (FIS), en passe de remporter les élections législatives. Ceux-ci prennent le maquis. Le conflit commence : il fera, selon les estimations, entre 150 000 et 200 000 morts en une décennie.
Entrave au travail de mémoire
Dès le mois de juin 1999, soit deux mois après son élection à la présidence (appuyée par les militaires), Bouteflika présente un projet de loi dite « de concorde civile » : le texte pose le principe de l’amnistie pour les islamistes qui déposeraient les armes à la condition qu’ils n’aient pas commis de crimes de sang. En réalité, une brèche a été ouverte dès 1997 : alors que les discussions entre le pouvoir et la direction politique du FIS sont dans l’impasse, les militaires algériens négocient une trêve avec Madani Mezrag, le chef de l’Armée islamique du salut (AIS), le bras armé du FIS.
En septembre 1999, le texte est approuvé par référendum à plus de 90 % des suffrages. Les violences diminuent mais ne s’éteignent pas totalement.
En 2005, le président présente une charte pour la paix et la réconciliation : elle sera adoptée par référendum le 29 septembre, là encore à plus de 80 % des voix. Le texte reprend le principe de 1999 et l’élargit : amnistie pour les islamistes armés non impliqués dans « des massacres collectifs, des viols ou des attentats à l’explosif dans des lieux publics », soutien matériel à leurs familles en échange de leur reddition, indemnisation des familles de disparus, immunité pour les agents de l’Etat impliqués dans la lutte antiterroriste.
Son effet est incontestable : le conflit cesse. Selon les chiffres officiels, 15 000 islamistes armés ont bénéficié des dispositions de la charte (et 17 000 ont été tués pendant la guerre). Ce processus de pacification fait toutefois l’objet de vives critiques. Beaucoup estiment que la charte va très loin du côté de l’amnistie, laissant peu de place à la justice. Le texte entrave également tout travail de mémoire.
A la fin d’un conflit, certains pays ont choisi de donner plus de place au travail de vérité, comme l’Afrique du Sud, ou à la négociation, à l’image de la Colombie. En Algérie, le texte est adopté très rapidement, sans être discuté au Parlement, et ne fait pas l’objet d’un débat public. Evoquer même cette période sera désormais illégal. Selon la charte, « quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale » sera puni de trois à cinq ans de prison.
Régulièrement, à l’occasion d’une date anniversaire ou d’un événement politique, les blessures non refermées resurgissent. Lors des dix ans de l’adoption de la charte, en septembre 2015, les familles de disparus – ils seraient des milliers – ont une nouvelle fois dénoncé le trou noir qui entoure le sort de leurs proches.
Paix à marche forcée
En 2015 toujours, l’ancien commandant islamiste, Madani Mezrag, défraie la chronique en annonçant à l’été son intention de créer un nouveau parti, alors que la charte interdit toute activité politique aux repentis. L’épisode a provoqué l’indignation d’une partie des Algériens.
L’actualité est aussi régulièrement marquée par le mouvement de revendications des Patriotes, ces « civils » utilisés par l’armée pour lutter contre les islamistes dans les années 1990, et qui s’estiment aujourd’hui moins bien traités par l’Etat que leurs ennemis d’hier.
Les remises en cause de la charte de 2005 sont toutefois vite neutralisées par le contexte national – la persistance de foyers de terrorisme dans plusieurs zones du pays, notamment dans les montagnes du nord-est – et régional dans le monde arabe. Des menaces que le pouvoir ne manque pas de mettre en avant pour s’assurer un calme social.
Cette paix à marche forcée s’est accompagnée d’un implacable verrouillage politique. En quatre mandats présidentiels, Bouteflika aura vidé les partis de leur substance, par la cooptation et la fraude électorale, régulièrement dénoncée par ses opposants. Officiellement, le multipartisme est de mise mais, dans les faits, le Front de libération nationale (FLN), dont Bouteflika reste le président, continue à se comporter en parti unique avec l’appui de ses alliés, notamment le Rassemblement national démocratique (RND). Tous deux détiennent la majorité à l’Assemblée.
Près de quinze ans après la fin de la décennie noire, la peur d’un retour au chaos a été dépassée par les jeunes générations, en première ligne des manifestations de ce début 2019, mais personne n’oublie que l’histoire de cette sombre période reste à écrire.