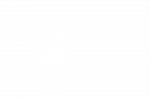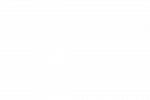L’art pour assumer et magnifier ses cicatrices

L’art pour assumer et magnifier ses cicatrices
Par Diane Regny
Ablations, cicatrices, brûlures…, des millions de personnes portent les stigmates d’un accident ou d’une maladie. Pourtant, certaines les assument, les aiment, voire les magnifient.
« A 16 ans, j’étais une petite blonde gymnaste qui s’aimait. Mais, après l’accident, je me suis réveillée chauve, maigre et brûlée », raconte Julie Bourges. Cette blonde de 22 ans, aux yeux bleus, a été brûlée au troisième degré sur 40 % de son corps, le 12 février 2013. Elle participait au carnaval de son lycée, près de Nice, déguisée en mouton, quand une cendre de cigarette a enflammé son costume, confectionné avec du coton et du scotch double face.
Elle parle de cet accident et de sa reconstruction sur son compte Instagram (et sa chaîne YouTube). Aujourd’hui, avec près de 300 000 personnes qui la suivent sur les réseaux, la jeune femme fait la promotion des corps différents. Au début, pourtant, elle cherchait simplement à connaître l’avis de personnes extérieures sur ses cicatrices. Et puis « rapidement, beaucoup de personnes m’ont envoyé leurs témoignages, des personnes brûlées, touchées par un cancer, handicapées, dépressives… J’ai réalisé que mon histoire et le message de résilience qui l’accompagnait pouvaient aider, alors j’ai continué. »
Sourire éclatant et nez qui se plisse quand elle rit, Julie respire la joie de vivre. Ses abonnés la considèrent comme un modèle, voire comme un sujet de « motivation quotidienne ». « On a tous nos différences, nos imperfections. Cela donne du courage. On s’identifie peut-être plus à moi qu’aux publicités », avance-t-elle en relevant ses cheveux avant de tempérer : « Ce serait mentir de dire que c’est facile. C’est un combat permanent. »
Après son accident, elle passe trois mois dans le coma pour les greffes de peau. S’ensuit une longue période où elle cache ses stigmates sous des couches de vêtements. Le regard des autres est douloureux.
Un jour, dans un restaurant, un homme l’observe fixement. Au bout d’une demi-heure, agacée, elle se lève et lui demande de cesser de la dévisager parce qu’elle est différente. L’inconnu s’excuse et explique : « Ma nièce est à l’hôpital parce qu’elle a été brûlée, et je me demandais si elle allait être aussi belle que vous avec vos cicatrices. » Un moment décisif qui conduit Julie à ne plus interpréter le regard des autres. « Parfois quand on me dévisage dans la rue, je me dis qu’il s’agit peut-être d’un abonné [Instagram] », dit-elle en riant.
Christèle Decker, psychologue à l’Institution nationale des Invalides, explique : « On met souvent dans le regard de l’autre ce qu’on pense nous-mêmes. Il s’agit d’une projection agressive. Certaines personnes sont paranoïaques et elles interprètent tous les regards comme une agression. »
Se réincarner en activiste
Aujourd’hui, Julie fait des partenariats avec de grandes marques, comme Yves Rocher, Dove ou Reebok. Elle milite pour que la société représente davantage les corps différents et, enfin, les accepte. « Il s’agit d’une sublimation combative, précise Mme Decker. C’est un mécanisme de défense qui permet de transformer un accident de la vie en activisme, ça le rend positif. »
Pour les personnes atteintes de stigmates très visibles, le simple fait de poster des photographies d’elles au naturel est une forme d’activisme. De nombreuses instagrammeuses commencent à assumer leurs corps, différents de la norme sociétale, comme o2her ou Isabella Santa Maria, qui a été renversée par une voiture lorsqu’elle avait 7 ans. Sur le réseau social, la jeune femme de 24 ans assume son visage, dont le côté droit a été brûlé dans l’accident.
« Il y avait beaucoup de choses que je voulais faire sans le pouvoir, à cause de mes insécurités et de ma peur du jugement des autres. J’ai décidé d’aller mieux, d’avoir confiance en moi, d’arrêter de me cacher, pour m’accepter », raconte-t-elle. Un processus qu’elle a mis en place sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie réelle. « Sur la plate-forme, les gens ne voient pas toutes ces fois où je pleure seule dans ma chambre, où j’ai une crise d’angoisse, ou tous ces moments où les gens me fixent, où que j’aille », confie-t-elle.
Le processus de guérison est long. « Nous nous transformons tous, chaque jour, progressivement, mais dans le cas d’un accident ou d’une maladie qui laisse des stigmates, il y a une rupture brutale. Or, quand on est atteint physiquement, l’identité est atteinte », précise Christèle Decker. Alors, il faut se réinventer, se réincarner. Une réincarnation que Julie a tatouée dans son dos sous la forme d’un phénix.
Isabella Santa Maria, elle, a choisi « la sublimation créative » en faisant du kintsugi sur son visage – une technique japonaise pour réparer la vaisselle cassée ; les morceaux sont assemblés avec de l’or. « C’est un processus de défense qui permet de passer du statut de blessé à celui d’artiste », décrypte Christèle Decker. Ce sont ces fissures qui font l’unicité et la beauté de l’objet. « C’était un rappel d’où je viens et une façon de célébrer ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui », précise Isabella.
De l’or sur nos cicatrices
L’artiste Hélène Gugenheim a aussi utilisé le kintsugi pour magnifier ces corps abîmés par des épreuves de vie. Dans son projet, « Mes cicatrices, je suis d’elles, entièrement tissé.e », débuté en 2015, elle a invité cinq personnes à se dénuder entièrement. Cinq doreurs et doreuses se sont succédé de mai 2015 à septembre 2016 dans cet atelier délabré pour appliquer des feuilles d’or sur les cicatrices des volontaires.
Antoine a participé à la performance privée de l’artiste. Atteint de mucoviscidose, il a été greffé du foie et des poumons en 2005, puis d’un rein quelques années plus tard. « J’avais besoin de me réapproprier mon corps et de faire de mon histoire quelque chose de positif », explique-t-il. Un corps avec lequel il était « sans cesse en lutte » et qu’il aurait voulu conserver indemne. Il avait même refusé la première greffe, effrayé par les stigmates physiques qui en découleraient.
Hélène Gugenheim, performance « Mes cicatrices, je suis d’elles, entièrement tissé.e », Antoine, 2016. Dorure : Martine Rey. Photo : Florent Mulot. ©Adagp 2019. / FLORENT MULOT / ADAGP
Pour lui, « c’est l’étincelle qui a débloqué la situation ». Alors qu’il se camouflait, Antoine va de nouveau à la plage, il tente même le naturisme et ses relations intimes s’améliorent. Il évoque un moment « libérateur » qui lui a permis de percevoir son corps différemment. La laqueuse qui s’est occupée de lui, Martine Rey, pratiquait déjà le kintsugi. Travailler sur une « matière vivante » l’a touchée : « L’or sur des blessures, c’est comme un soleil, c’est une très belle façon d’accepter ces passages difficiles de la vie. »
L’idée d’un « kintsugi corporel » est venu à Hélène Gugenheim en observant Marie Albatrice, qui a subi une mastectomie après avoir déclaré un cancer du sein. « C’était la première fois que je voyais un corps avec un seul sein. J’ai trouvé que c’était quelque chose de beau, une forme de métamorphose qu’il fallait souligner », explique l’artiste.
Si aujourd’hui, son sein a été reconstruit, Marie Albatrice estime que cette performance l’a aidée à accepter son corps. A l’époque, elle travaille avec plusieurs photographes. Elle tente plusieurs styles, devient plus androgyne, s’amuse avec les codes. « Quand on traverse ce genre de situation, soit on subit, soit on joue avec », lâche-t-elle.
Alors elle a « joué avec », comme Antoine s’en est servi de levier pour apprendre à s’accepter, Isabella d’exutoire pour toutes ses émotions douloureuses et Julie de tremplin pour faire accepter la différence. Car, comme les corps, les méthodes pour apprendre à les aimer sont uniques.