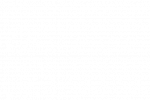« Toy Story 4 » : road trip endiablé au pays des jouets vivants

« Toy Story 4 » : road trip endiablé au pays des jouets vivants
Par Jacques Mandelbaum
Le quatrième opus, bâti autour de Fourchette, un jouet fait à partir de déchets, prolonge la magie de la saga.
Woody et Fourchette, deux des héros de « Toy Story 4 ». / PIXAR
Cette histoire, mine de rien, dure depuis vingt-quatre ans et on ne parvient toujours pas, en dépit du mauvais esprit prêté aux critiques et des efforts désespérés pour s’en montrer digne, à s’en lasser. Inauguré en 1995 avec un premier film de John Lasseter, ce fleuron des studios Pixar – entre-temps rachetés par l’empire Disney, qui était toutefois déjà présent comme coproducteur dès le premier opus – s’est transformé en une des franchises d’animation les plus appréciées et lucratives au monde.
Ce succès tient au principe de la franchise, qui rejoint une vieille rêverie enfantine, dont la magie animiste n’exclut pas la profondeur conceptuelle. On y dirait donc que les jouets se mettent à parler et à vivre leur propre vie.
Vous avez dit Pinocchio (Disney déjà, ramollissant Carlo Collodi) ? Oui, mais aussi La Révolte des jouets (Hermina Tyrlova, 1946), Chucky : Jeu d’enfants (Tom Holland, 1988) ou Small soldiers (Joe Dante, 1998). On ne sera pas surpris que ce retour à l’esprit d’enfance prenne deux grandes formes, celles de l’épouvante et de la féerie, revers de la même médaille infantile, selon que les jouets s’y révèlent persécuteurs ou protecteurs. Nul hasard, dès lors, si les enfants auxquels appartiennent le shérif Woody dans Toy Story et la poupée homicide dans Chucky portent le même nom (Andy).
Mais Toy Story, premier dessin animé intégralement réalisé en images de synthèse, présente cette particularité d’être intimement lié à l’avènement de la puissance numérique. Alors qu’il était le fruit d’un patient et pathétique apprentissage dans Pinocchio, le miraculeux passage de l’inanimé à l’animé, du pantin à l’enfant, de l’objet au personnage, il devient ici une routine incessamment réitérée, réversible à tout bout de champ, dispensatrice d’une nouvelle trivialité comique, où le vivant, pour inverser la formule d’Henri Bergson, se plaque sur du mécanique.
L’absence des humains y conditionne l’incarnation des jouets, leur présence induit le retour soudain à leur état d’objet. Il s’ensuit que les jouets sont dotés d’une conscience supérieure à celle des humains, qui est de se savoir vivants alors que les humains l’ignorent. C’est l’idée développée par Hervé Aubron dans son excellent Génie de Pixar (Capricci, 2011) : la conquête par l’artefact de la maîtrise du vivant traduit l’inexorable dérive solitaire des deux mondes, celui de l’humain et celui de la machine.
Syndrome d’abandon
Ce sont donc ici, autre grand leitmotiv de la saga, les jouets qui rappellent les humains à l’idéalisme de leur enfance oubliée, et plus fondamentalement aux devoirs de leur humanité même. Un véritable syndrome d’abandon ouvre à ce titre chaque film, taraudant des jouets qui craignent tout à la fois leur obsolescence temporelle et le tarissement affectif de leur propriétaire.
Ce premier paradoxe se double d’un second. Qui veut que le nec plus ultra de la technologie par ordinateur tel que Pixar l’incarne produise, de Toy story à Wall-E, une apologie de la résistance et de la décélération : charme du jouet ancien, pérennité des fictions d’antan, valeur de l’artisanat et de la pièce unique, recyclage des déchets.
Autant de motifs et de manières reconduites dans ce quatrième opus, qui s’ouvre, une nouvelle fois, sur l’inquiétude de Woody, le sympathique shérif aux vertus sacrificielles, alors que Bonnie – la fillette qui en a hérité en même temps que certains autres jouets d’Andy – le laisse moisir chaque jour dans le placard. N’y tenant plus, il se glisse dans son cartable à l’occasion du premier jour d’école de la fillette, si redouté.
C’est lui encore qui lui redonne sans se montrer du courage, en lui fournissant en douce les éléments propices à la fabrication d’un personnage. Une fourchette en plastique trouvée dans une poubelle, un bout de ficelle pour les jambes, un élastique pour la bouche, deux boutons disharmonieux pour les yeux, et le tour est joué. C’est Duchamp qui s’invite chez Pixar, le pixel qui se la joue ready-made, le retour sans les mains à l’art primitif de l’animation en volume.
Courses-poursuites d’anthologie
De l’avoir ainsi créée rend Bonnie passionnément attachée à Fourchette. Le problème, c’est que Fourchette ne se considère pas comme un jouet, mais comme un déchet. Il passe sa vie à se sauver pour sauter dans la première poubelle venue, avec Woody, qui veille au grain, sur ses talons. Celui-ci l’extirpe régulièrement des ordures ménagères et tente de l’intéresser, sans y croire tout à fait lui-même, aux gratifications de l’amour et de la fidélité qui couronnent une vie de jouet. Mais le jour où la famille part en camping-car pour un road trip, la désertion de Fourchette sur la route prend, soudain, d’autres proportions.
L’aventure, entre une fête foraine et un magasin d’antiquités, met désormais aux prises Woody, son ami l’astronaute Buzz l’Eclair – fidèle à sa mythomanie –, Bo, la jolie bergère aux trois moutons (Bi, Bop et Lulla) qui s’est émancipée et roule en sconcemobile, deux louches peluches de foire qui n’ont jamais échu à personne et qui valent les trois Pieds nickelés, Duke Caboom, un cascadeur canadien motorisé tendance Village People, droit sorti des seventies, mais qui souffre de n’avoir jamais eu de rôle à la hauteur de sa publicité, Gaby Gaby, une jolie poupée esseulée en raison d’un vice de fabrication sonore, qui kidnappe Fourchette pour que Woody lui cède sa boîte vocale, secondée dans ce projet par une nuée de marionnettes de ventriloque au mutisme et au faciès plus qu’inquiétants.
Courses-poursuites d’anthologie, idylle amoureuse touchante et gags intrépides seront donc au programme de ce quatrième opus où, plus que jamais, se célèbrent les noces orphelines des enfants sans jouets et des jouets sans enfants.
Toy Story 4 - Nouvelle bande-annonce | Disney
Durée : 02:29
« Toy Story 4 », film d’animation américain de Josh Cooley (1 h 40).