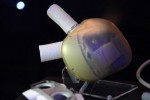« On ne soigne pas un malade d’Ebola comme un patient classique »
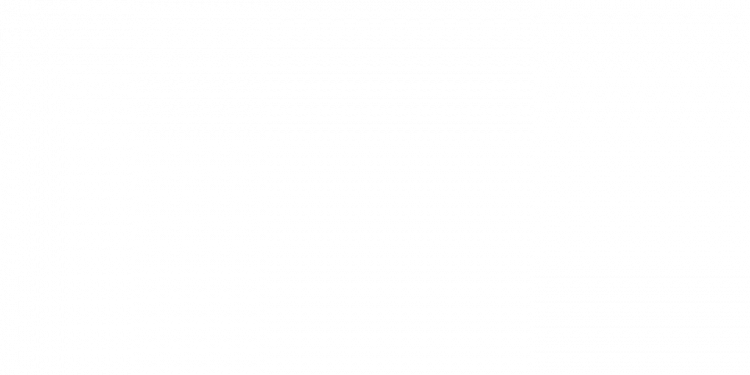
« On ne soigne pas un malade d’Ebola comme un patient classique »
Propos recueillis par Maryline Baumard
Le fondateur de l’ONG Alima exprime son « inquiétude » face à la propagation du virus en République démocratique du Congo, qui compte désormais trois épicentres.
Il y a juste un an, Ebola faisait ses premières victimes en République démocratique du Congo (RDC). Depuis le virus continue de sévir et, le 18 juillet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété l’« urgence sanitaire mondiale ». La maladie qui sévit dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri a déjà fait 1 700 morts, ce qui fait d’elle la deuxième plus importante épidémie de l’histoire après celle qui avait tué près de 11 000 personnes en Afrique de l’Ouest (Guinée, Liberia, Sierra Leone) en 2013-2 014.
En soutien du ministère de la santé congolais, en coordination avec l’OMS, une organisation non gouvernementale (ONG) intervient en première ligne. Moins connue en France que l’ONG Médecins sans frontières (MSF), présente de longue date sur la zone, The Alliance for International Medical Action (Alima), créée en 2009, gère aujourd’hui les deux plus grands centres de traitement de l’Est de la RDC, à Beni (61 lits) et à Katwa (commune de Butembo, 72 lits). Son fondateur, Augustin Augier, explique au Monde Afrique les raisons de son inquiétude.
Vous êtes présent à Beni et Katwa, au cœur même de la zone touchée par Ebola, comment définiriez-vous la situation ?
Augustin Augier Un an après la déclaration de la maladie, l’épidémie garde le même épicentre, ce qui signifie que nous n’avons pas réussi à en venir à bout. Plus grave, d’autres épicentres se sont développés, comme à Butembo et à Katwa et un cas a même été enregistré à Goma. Nous en sommes à plus de 2 500 cas confirmés et 1700 morts. Ce qui en fait, de loin, la seconde épidémie d’Ebola la plus longue et la plus intense de l’histoire.
Vous êtes inquiet ?
Oui, je suis inquiet pour trois raisons. D’abord parce qu’aujourd’hui la maladie a son épicentre dans une zone urbaine, avec une population dense et très mobile. Or cette concentration, comme les déplacements, augmente les risques de propagation du virus. Ensuite, il ne faut pas oublier, même si ce n’est pas nouveau, que les zones où se propage l’épidémie actuelle sont marquées par l’insécurité, ce qui complique considérablement notre travail. Plus de 140 attaques ont eu lieu contre des formations sanitaires, des ambulances ou des personnels de santé depuis le début de l’épidémie. Cela génère de grandes difficultés pour maintenir la continuité des activités de lutte contre Ebola et crée d’immenses besoins pour les populations de cette zone qui souffrent de bien d’autres maux.
Le centre Ebola de l’ONG Alima, à Bébi, dans l’est de la RDC, en août 2018. / John Wessels/Alima
Outre ces deux points importants, je dois avouer que je suis très inquiet de l’augmentation du nombre de cas à prendre en charge. Depuis mars ou avril, nous dépistons entre 10 et 15 nouveaux cas journaliers. Or pour chaque cas positif nous devons identifier, trouver et sensibiliser toutes les personnes que le malade a pu contaminer depuis l’apparition de ses symptômes. C’est un travail extrêmement qualitatif qui est mené par les équipes du ministère de la santé mais qui, au-delà d’une dizaine de cas par jour, est très difficile à faire correctement dans un endroit où la plupart des gens n’ont pas d’adresse et où la couverture téléphonique est partielle.
La maladie n’est donc pas du tout sous contrôle…
Pour notre part, nous gérons au mieux nos deux centres de prise, mais avons besoin de renforts. D’autant que nos équipes sont épuisées à force d’être quotidiennement confrontées à la mort et d’être la cible de menaces de groupes armés. N’oublions pas que 41 membres du corps soignant sont morts d’Ebola depuis un an et cinq ont été assassinés uniquement car ils faisaient partie des équipes de lutte contre Ebola.
Comment travaillez-vous ?
Nous prenons en charge les malades directement dans nos deux centres. Ce n’est déjà pas si simple, car les populations ne viennent pas volontiers. Sur dix malades, quatre préfèrent encore mourir chez eux. Un centre Ebola n’est pas un lieu qui fait rêver. C’est une clinique avec du personnel en combinaison, ce sont des espaces d’isolement, d’autres malades y sont confinés… Et même si nous y réduisons la mortalité du virus de 70 % (sans traitement) à 40 % en hospitalisation et que les soins sont gratuits, y venir ne va pas de soi. Pourtant, il nous faut instaurer cette confiance qui est la clé parce que lorsqu’on vient deux jours après une contamination, on a deux fois plus de chance de survivre que si l’on attend six jours.
Et que fait-on pour ceux qui ne sont que susceptibles d’avoir croisé la maladie ?
Ils sont gérés dans des centres de transit installés dans les centres de santé locaux. Ils y restent deux jours, le temps d’être testés. Nous avançons vers la mise en place d’un guichet unique, où tous les services de sensibilisation et de vaccination seraient disponibles ensemble, ce qui rendrait notre prise en charge plus efficace et plus lisible par une population qui doit s’approprier les structures.
Le vaccin est-il aujourd’hui efficace ?
Aucun vaccin n’a d’autorisation de mise sur le marché. En revanche, l’un d’eux, fabriqué par le laboratoire Merck, a déjà eu un essai de phase 3 en Guinée en 2015. C’est-à-dire qu’il a prouvé son innocuité et qu’on a de bonnes raisons de croire à son efficacité. Pour autant, nous ne vaccinons pas assez de personnes à risque. C’est pour cela qu’en mai un groupe d’experts de l’OMS a décrété qu’il fallait vacciner plus. Or, sur le terrain, nous manquons de doses et restons bloqués sur environ 15 000 personnes vaccinées chaque mois (170 000 depuis un an) alors qu’il conviendrait d’élargir le cercle autour de chaque malade comme le recommande le Professeur Muyembe, qui vient d’être nommé par la présidence congolaise coordinateur de la riposte pour le gouvernement.
Dans un centre Ebola de l’ONG Alima, à Butembo, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), en juin 2019. / Alexis Huguet/Alima
Alima regrette que le laboratoire, qui obtiendra une licence de vaccin en partie « grâce » aux informations qu’il aura obtenu au cours de cette épidémie, ne se mette pas en situation de fournir rapidement un nombre plus massif de doses aux praticiens de terrain.
Enfin, il existe bien un second vaccin, mais il n’en est qu’à la phase 2 de test et nécessite deux injections. Ce qui complique encore la prise en charge, même si, ensuite, sa couverture serait probablement plus durable que celle du premier vaccin.
Mais, vous êtes une ONG et vous testez un vaccin ?
Alima est une ONG particulière parce qu’elle conduit des projets de recherche sur tous ces terrains. C’est l’un de nos partenariats avec un consortium de recherche international qui a permis de réaliser le plus grand essai vaccinal contre Ebola, en Guinée, où la maladie a sévi entre 2014 et 2016. C’est là que nous avons testé le vaccin Merck.
Alors que l’Afrique représente plus de 13 % de la population mondiale, concentre la moitié des interventions humanitaires et fait régulièrement face à de nouvelles menaces sanitaires, elle reste le parent pauvre des essais cliniques avec seulement 2 % d’entre eux menés sur le continent. Ce qui a conduit à des traitements et à des protocoles bien souvent inadaptés.
Outre cette prévention, dispose-t-on de traitements médicamenteux ?
Comme avec le vaccin, nous sommes en phase de tests pour quatre molécules curatives prometteuses. Nous terminons de les expérimenter sur 500 patients et le Comité indépendant de suivi de la sécurité de l’essai vient d’accepter que l’on monte à 700 personnes testées, au vu des premiers résultats qui seront probablement rendus publics à la rentrée. Mais une chose est d’ores et déjà sûre, il n’y a pas de traitement miracle.
A-t-on réduit la mortalité depuis un an ?
Oui, bien qu’elle reste élevée. En général, on meurt en moins de dix jours et il est difficile d’abaisser ce taux de mortalité à moins de 40 %. Ebola est vraiment une maladie à part et il ne faut jamais oublier de la considérer comme telle. Elle décime des familles entières en quelques jours. Ceux qui en réchappent ont du mal à reprendre leur vie, car, outre les décès auxquels ils doivent faire face, ils souffrent souvent de séquelles physiques, sont régulièrement stigmatisés et certains hommes restent contagieux, via leur sperme, durant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Que faites-vous de la masse de connaissances que vous avez accumulées ?
Nous la partageons au sein d’une « école Ebola ». En Guinée, nous venons de faire intervenir nos meilleurs experts sur Ebola pour que, durant une semaine, ils partagent leur savoir avec une quinzaine de personnes qui vont partir prochainement en mission au Congo. On ne s’adresse pas à un malade Ebola et on ne le soigne pas comme un patient classique. Cette maladie a beaucoup de spécificités anthropologiques, médicales et opérationnelles qu’il faut davantage enseigner.
Manquez-vous d’argent pour faire votre travail ?
Non. Nous en refusons. Nous ne voulons plus être aussi seuls sur le terrain, ce qui est notre situation depuis le départ de certaines ONG suite à des attaques. Avec 700 salariés en RDC, Alima consacre un tiers de ses forces à ce combat. Nous ne pouvons délaisser le reste de l’Afrique. Dans le Sahel, nous sommes la seule ONG sur certaines zones et notre présence, moins médiatique, est toute aussi nécessaire. Même si nous avons cinquante fois plus d’argent pour prendre en charge un patient Ebola qu’un enfant qui souffre de malnutrition.
A Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo, un centre Ebola de l’ONG Alima, en août 2018. / John Wessels/Alima
Comment expliquez que les donateurs préfèrent soigner une fièvre hémorragique qu’empêcher un bébé de mourir de faim ?
Ebola frappe l’imaginaire plus qu’un enfant qui meurt en silence ou ne se développera pas normalement parce qu’il lui manque le minimum.