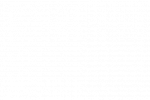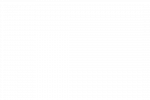Dak’Art 2016 : du chaos surgit une très belle exposition internationale
Dak’Art 2016 : du chaos surgit une très belle exposition internationale
Par Roxana Azimi (Dakar, envoyée spéciale)
Le commissaire Simon Njami, appelé en catastrophe pour sauver la 12e édition de la biennale de Dakar, n’a eu que sept mois pour relever le défi. Pari réussi.
Photographie tirée de la série "Nobody will talk about us", de la Tunisienne Mouna Karray, exposée à la Dak'Art 2016. | MOUNA KARRAY
C’est à peine croyable : bien qu’accouchée aux forceps, l’exposition internationale de la biennale de Dakar, conçue par le commissaire Simon Njami, est réussie. Les indicateurs n’étaient pourtant pas au vert. La veille de l’ouverture, les trois quarts des pièces n’avaient toujours pas été installées. D’autres œuvres ne sont pas arrivées à Dakar ou sont retenues à la douane. Lors du vernissage, mardi 3 mai, beaucoup de vidéos n’étaient pas visionnables, faute de projecteurs.
L’incurie organisationnelle se trouve toutefois compensée par la splendeur du Palais de justice, un nouveau site laissé dans son jus, lézardé de larges fissures qui lui donnent un charme déglingué. Le génie du lieu est néanmoins à double tranchant : il magnifie les œuvres les plus fortes, comme l’installation de Kader Attia autour des révolutions de pierre, mais écrase les plus anecdotiques.
Noirceur générale
Le « Réenchantement », titre de cette édition de Dak’Art 2016, se joue davantage du côté du bâtiment, qui jouit d’une seconde jeunesse, que des œuvres au noir qu’il abrite. Ni enchanteurs ni mages, les artistes invités sont plutôt des chroniqueurs lucides, voire désillusionnés, d’un monde cabossé. Cette noirceur générale, tavelée de quelques traits d’humour comme les affiches parodiques de cinéma du Marocain Yassine Balbzioui, n’est pas sans rappeler le désenchantement de la Biennale de Venise d’Okwui Enwezor en 2015. A ceci près que Simon Njami n’a disposé que de sept mois – et non deux ans – pour monter la sienne. Aussi son propos est-il plus flottant, la construction plus lâche, la liste des artistes plus inégale.
Une affiche parodique du Marocain Yassine Balbzioui, exposé à la biennale de Dakar, du 3 mai au 2 juin 2016. | YASSINE BALBZIOUI
Certaines œuvres sortent du lot, comme la vidéo de l’Egyptienne Heba Y. Amin, vraie découverte de cette édition. Celle-ci a collecté les messages vocaux porteurs d’espoir laissés par les Egyptiens pendant un mois, entre janvier et février 2011, sur une plateforme numérique baptisée SpeakTweet. Que reste-t-il aujourd’hui de ce souffle révolutionnaire ? Rien, si ce n’est une profonde amertume. « Aujourd’hui, j’ai beaucoup de mal à réentendre ces messages, admet Heba Y. Amin, la gorge serrée. Nous pensions que tout était possible, il y avait une excitation. Maintenant, il n’y a rien que nous puissions faire. Nous nous sentons totalement démunis. » Pourtant, certains messages diffusés dans le film exhortent à ne pas s’avouer vaincus : « Dieu nous interdit de flancher, parce qu’autrement l’Egypte cessera d’exister pour longtemps. »
Comme en écho, une double installation vidéo de 2003 de l’Egyptien Moataz Nasr appelle à ne pas baisser les bras. Sur un écran est projeté un film tourné en 1969 par le réalisateur Youssef Chahine à partir d’événements qui se sont déroulés en 1933. Sur l’autre, Moataz Nasr a fait rejouer par une conteuse une scène dans laquelle le personnage de Chahine secoue verbalement ses compagnons pour qu’ils recouvrent leur fierté.
« Contenir l’être humain »
Passivité et contrainte, voilà deux maux que l’artiste tunisienne Mouna Karray cherche à conjurer avec sa série de photos Nobody will talk about us, réalisée entre 2012 et 2015 dans le sud-ouest tunisien. Un corps emmailloté dans un sac en toile blanche s’infiltre dans le paysage, comme le spectre entêtant d’une parole bâillonnée mais insoumise. « Dans cette région où se trouvent des mines de phosphate, la richesse ne revient pas aux gens, qui vivent dans une pauvreté silencieuse », déplore la jeune femme. Pour autant, Mouna Karray refuse de perdre foi dans l’avenir. « Ce qui me rend optimiste, c’est la société civile », insiste-t-elle. Une société qui n’hésite pas à jouer les David contre Goliath.
C’est précisément la métaphore de la fronde que file Kader Attia dans son installation baptisée Les Rhizomes infinis de la révolution, composée d’arbres en tiges de fer à béton piquées de frondes. « On a beau le vouloir, on ne peut pas contenir l’être humain, insiste l’artiste franco-algérien. La révolte est le propre de l’homme. Et les révolutions commencent parfois avec un jet de pierre. » Ou un jet de dés, comme le suggère une installation de la Nigériane Modupeola Fadugba, en apparence ludique. En apparence seulement, car le thème qu’aborde ce Rubik’s Cube géant est celui de l’éducation, un défi pour toute l’Afrique, et tout particulièrement le Nigeria, où 276 lycéennes furent enlevées en 2014 par les islamistes de Boko Haram. « Certains prétendent que l’école n’est pas un lieu sûr. D’autres disent “A quoi bon mettre nos enfants à l’école alors que 20 millions de jeunes gens se trouvent au chômage ?” Du coup, 10,5 millions d’enfants ne sont pas scolarisés », regrette la jeune femme, qui fut elle-même enseignante.
Dans le jeu auquel elle invite le visiteur, tout est question de chance, mais aussi de stratégie. Comme pour montrer que chacun est libre de son destin.
Hommage à la « Revue Noire »
Placé sous le signe de l’hommage à des artistes défunts tels que la photographe marocaine Leila Alaoui, décédée en janvier lors d’un attentat à Ouagadougou, ou au souffle de Léopold Sedar Senghor, le Dak’Art de Simon Njami s’autorise aussi une séquence dédicace à la Revue Noire, publiée de 1991 à 2001. « Je voulais la présence de cette histoire, mais qu’on ne pense pas qu’il s’agissait d’un monument à ma gloire, précise Simon Njami, qui avait confondé la revue avec Jean-Loup Pivin. La formule la plus intéressante, c’était que le sujet soit traité par un artiste. »
Après le Camerounais Pascale Marthine Tayou, qui a autrefois empalé des exemplaires de la revue, c’est au tour de Joël Andrianomearisoa de se frotter à l’exercice. Au Manège, un lieu qui dépend de l’Institut français de Dakar, l’artiste malgache a orchestré un parcours sentimental rythmé au gré de sa biographie et des numéros marquants d’une revue dont il a fait la couverture à l’âge de 18 ans. Pas question pour autant de sombrer dans le sentimentalisme. En vis-à-vis de la frise reprenant les quatrièmes de couverture du magazine, Joël Andrianomearisoa a installé de grands ensembles de papiers de soie, comme autant de pages blanches à remplir.
Dak’Art 2016, 3 mai-2 juin 2016, www.dakart.net