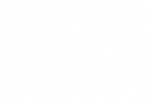Aziz Krichen : « La querelle identitaire n’a pas disparu en Tunisie »

Aziz Krichen : « La querelle identitaire n’a pas disparu en Tunisie »
Propos recueillis par Frédéric Bobin (Tunis, correspondant)
L’économiste et sociologue, ex-conseiller du président Marzouki, analyse les relations qui sous-tendent la coalition Nidaa Tounès-Ennahda au pouvoir.
Ancien conseiller politique de Moncef Marzouki, président de la République de Tunisie de décembre 2011 à décembre 2014, Aziz Krichen, 69 ans, a vécu aux premières loges l’expérience turbulente du gouvernement de la « troïka » dont le parti islamiste Ennahda était la principale composante.
Issu de l’extrême gauche étudiante – il était l’un des animateurs du mouvement Perspectives dans les années 1970 –, Aziz Krichen s’est rapproché du Congrès pour la République (CPR) de M. Marzouki au lendemain de la révolution de 2011. Economiste et sociologue, il est l’auteur du Syndrome Bourguiba (Cérès Editions, Tunis, 2012) et plus récemment de La Promesse du printemps (Script Editions, Tunis, 2016), un essai inspiré de son expérience au cœur du pouvoir dans les premières années post-révolutionnaires. Dans un entretien au Monde Afrique, il s’inquiète des risques que comporte pour le pluralisme en Tunisie le nouvel axe de pouvoir associant Ennahda et Nidaa Tounès, formations islamiste et anti-islamiste hier en conflit frontal, et aujourd’hui réconciliées.
Que pensez-vous de l’évolution stratégique du parti islamiste Ennahda, notamment après son Congrès d’Hammamet, en mai, qui a entériné la « spécialisation » du parti sur les seules activités politiques ? Ennahda se normalise-t-il ?
Aziz Krichen Il s’agit d’une évolution remontant loin dans le temps. Le 18 octobre 2005, par exemple, Ennahda avait signé avec d’autres formations d’opposition, de sensibilité démocrate, trois textes sur les droits et la liberté, sur l’égalité hommes-femmes et sur la liberté de conscience. Mais ce premier moment n’a pas duré. Car chacun poursuivait un objectif politique immédiat, il s’agissait de s’affirmer dans le rapport de forces avec le régime de Ben Ali.
Survient 2011 et la révolution. Chaque formation fait cavalier seul. A l’issue des élections d’octobre, Ennahda fait alliance avec deux autres partis, Ettakatol et le Congrès pour la République (CPR), au sein du gouvernement de la « troïka ». Mais la position d’Ennahda est trop dominante pour résister à une espèce de pulsion hégémonique. Cette pulsion n’est pas tant liée à l’idéologie qu’à la nature du jeu politique. Ennahda ne comprend le langage du compromis que lorsque l’évolution du rapport de forces l’y oblige.
C’est ce qui s’est passé avec la terrible année 2013 : mobilisation anti-islamiste à Tunis après les assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi et le coup d’Etat anti-Morsi en Egypte ?
Les résolutions du Congrès d’Hammamet sont le prolongement du fameux Dialogue national de l’automne 2013 qui permet à la Tunisie de sortir de la crise et de faire adopter à la quasi-unanimité de l’Assemblée la Constitution de janvier 2014. A l’époque, le contexte dans le monde arabe était défavorable aux Frères musulmans. Ennahda a dû faire profil bas et donner des gages. C’est ce qui explique la clarification entre le politique et le religieux décidée à Hammamet.
Cela signifie-t-il qu’Ennahda a vraiment changé ?
L’identité d’Ennahda, c’est l’islam. L’islam est le fonds de commerce avec lequel le parti recrute ses membres. C’est la structure identitaire fondamentale des troupes. Dans leur travail interne, les dirigeants islamistes ne se sont jamais écartés de cette démarche.
Parce que la distinction entre le politique et le religieux frappe le cœur de cette structure identitaire, ils vont faire comme ils font toujours. Il y aura un discours à l’attention de ceux qui, à l’extérieur, attendent cet aggiornamento. Et, en direction de leurs troupes, ils continueront de tenir un discours fondamentalement conservateur. Ils sont dans une contradiction. S’ils vont jusqu’au bout de l’évolution en cours, ils se suicident. S’ils ne font rien, ils se suicident aussi. Ils vont donc louvoyer.
Ennahda veut être le parti dominant au sein de la famille islamiste, ses dirigeants ne veulent pas couper les ponts avec les salafistes. Aussi ne s’agit-il pas d’une vraie rénovation mais plutôt d’un ravalement de façade.
Quel a été le rôle du président du parti, Rached Ghannouchi ?
En dépit de ses tensions internes, le parti arrive néanmoins à rester rassemblé, à renvoyer une image d’unité. Mais il le doit en grande partie à l’emprise qu’y exerce Ghannouchi. Lui seul est capable de maintenir l’unité. Mais, à 74 ans, il n’est plus tout jeune et n’a pas encore de remplaçant. Là est le principal élément de fragilité d’Ennahda.
Depuis début 2015, Ennahda est partie prenante de la coalition gouvernementale dirigée par le parti « moderniste » Nidaa Tounès, son adversaire d’hier. Cette alliance s’est renforcée depuis la crise interne à Nidaa Tounès. Assiste-t-on à une stabilisation durable de la scène politique tunisienne autour de ce nouvel axe ?
Il y a en ce moment une atténuation de la guerre idéologique en Tunisie entre islamistes et anti-islamistes. C’est le fruit du processus amorcé par le Dialogue national à l’automne 2013. On peut même dire que, depuis lors, il n’y a plus de guerre de religion en Tunisie. Sauf qu’il ne s’agit que d’un apaisement politique.
Ni Nidaa Tounès ni Ennahda n’ont fait le travail idéologique nécessaire pour justifier leur alliance auprès de leurs militants respectifs. Les racines de la querelle identitaire sont donc toujours là. Cette querelle ne s’exprime certes pas avec la violence des années 2012-2013, mais le potentiel d’animosité, de ressentiment et de rejet de l’autre est toujours là. Il faut faire une différence entre un apaisement assumé et un apaisement dicté par des considérations d’opportunisme politique.
Cette alliance Nidaa Tounès-Ennnahda est-elle une bonne chose ?
Oui, cela a permis de stabiliser la situation en la pacifiant. Imaginez que Nidaa Tounès, au lendemain des législatives d’octobre 2014, se soit plutôt allié avec les non-islamistes. Cela aurait rejeté dans l’opposition Ennahda qui se serait de facto rapproché des franges djihadistes. Cela aurait rallumé la guerre religieuse avec un vrai risque de guerre civile.
Mais le problème avec cette alliance est qu’elle n’a pas de vrai projet pour le pays et qu’il n’y a pas d’opposition en face. Le risque est que Nidaa Tounès et Ennahda s’arrangent entre eux pour se servir et verrouillent le système. Avant, le système était verrouillé par un seul parti, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RDC) de Ben Ali. Aujourd’hui, le risque est que le verrouillage se fasse au profit de deux partis. Pour la sauvegarde des libertés et des acquis de la révolution, il faut qu’il y ait une opposition digne de ce nom.
Nidaa Tounès a perdu son statut de premier parti représenté à l’Assemblée, au profit d’Ennahda, après une vague de défections. La crise est-elle profonde ?
C’est un peu la malédiction du sérail. Selon la Constitution d’inspiration parlementaire, le chef de l’Etat, Beji Caïd Essebsi, fondateur de Nidaa Tounès, ne dispose que d’un pouvoir limité. Il fait donc tout pour récupérer des marges de pouvoir.
D’une part, il a placé à la tête du gouvernement Habib Essid, un homme incapable de lui faire de l’ombre. D’autre part, il a cherché à prendre possession du parti en imposant à sa tête son propre fils, Hafedh Caïd Essebsi. Avant 2011, ce genre de pratique était « normale ».
Mais, depuis la révolution, ce n’est plus possible. C’est bien la preuve que le pays a changé. Mais le fait que le président Essebsi ne s’en soit pas rendu compte montre à quel point c’est un homme du passé.
La lutte anti-terroriste, intensifiée depuis les attentats de 2015, vous semble-t-elle efficace ?
La matrice sociologique du terrorisme se trouve dans les quartiers périphériques des grandes villes. C’est là qu’il y a le gros de l’économie informelle et de l’habitat sauvage. Les populations y sont concentrées. Elles sont dans une position charnière qui leur permet d’observer directement les différences de niveaux de vie.
A Tunis, les quartiers pauvres jouxtent les quartiers riches, il n’y a pas de mur de Berlin. La répression menée aujourd’hui contre les groupes terroristes et djihadistes est légitime et indispensable. Mais penser qu’on peut éradiquer le terrorisme sans s’attaquer au terreau sociologique des quartiers périurbains ni intégrer ces populations à l’économie légale, c’est de l’aveuglement.
Dans votre livre « La Promesse du printemps », vous déplorez que l’administration tunisienne soit aujourd’hui infiltrée par des réseaux affairistes et mafieux. La situation est-elle à ce point grave ?
Il y a en effet une dérive mafieuse en Tunisie. Des réseaux affairistes contrôlent aujourd’hui l’économie, l’administration, les partis, la presse… La crise au sein de Nidaa Tounès n’est pas étrangère au jeu de ces réseaux. Une nomenklatura mafieuse est en train d’asseoir sa domination sur le pays.
Grandie sous Ben Ali, cette nébuleuse n’a pas été beaucoup perturbée par la révolution. Le désordre de la transition lui a, au contraire, permis d’étendre ses tentacules. Le gouvernement de Habib Essid aurait dû rétablir l’autorité. Malheureusement, cela n’a pas été le cas.