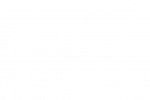Adrien Goetz : « Le passé est imprévisible »

Adrien Goetz : « Le passé est imprévisible »
M le magazine du Monde
[Série] A une époque de profondes mutations, le rapport au temps est chamboulé. Nous avons invité des personnalités et des anonymes à se confier sur ce vaste sujet. Cette semaine, l’historien de l’art Adrien Goetz.
Adrien Goetz est historien de l’art et écrivain. Il vient de publier Les oiseaux de Christophe Colomb (Gallimard, 96 pages, 11,50 euros), à l’occasion du 10e anniversaire du Musée du quai Branly. Dans cette nouvelle, il est question d’art, d’histoire, et de mystères… Adrien Goetz assume sa préférence pour les souvenirs, l’imagination, la rêverie, la connaissance qui s’extrait du temps présent mais sans se figer dans le passé !
Comment décide-t-on de devenir historien et passer son temps à se pencher sur le passé ?
J’ai toujours détesté l’avenir. Il suffit que j’entende le mot « projet » pour que je cesse d’écouter la suite. Je préfère les souvenirs. J’ai toujours aimé aller au musée avec mes parents. J’ai un contact très matériel avec le passé, et peut-être aussi avec le temps. C’est peut-être en réaction au culte actuel du présent. Il faudrait vivre avec son temps ! Or je suis un lecteur de Chateaubriand, j’aurais aimé vivre à la campagne sous Charles X, être abonné à La Quotidienne et sortir me promener en emportant un volume de Plutarque dans ma redingote. Là, j’aurais été heureux. Pourquoi devrions-nous être « de son temps » ?
La vocation d’historien vient de là ?
J’ai toujours préféré les langues anciennes aux langues vivantes. J’ai toujours pensé que c’était les choses les plus utiles qui soient. Tout ce que j’ai appris en étant un très mauvais élève en latin et en grec m’a marqué à tout jamais bien plus que les leçons d’allemand et d’italien. La langue permet d’entrer dans le fonctionnement mental de personnes très éloignées de nous et finalement peuvent nous séduire, nous parler. L’étude de la civilisation ne suffit pas.
N’est-ce pas une simple nostalgie reconstruite ?
Non car l’apprentissage des langues anciennes permet d’être de plain-pied dans le fonctionnement politique actuel, la démocratie, le monde des idées. On touche à l’universel. Je ne veux pas tenir un discours rétrograde ou réactionnaire. Mon propos n’est pas passéiste mais résonne avec mon amour des musées. Rien ne m’exaspère plus que les gens qui disent : « Il ne faudrait pas que Paris devienne une ville-musée ! ». Car quand j’arrive dans une ville étrangère, je commence toujours par les musées. Il n’y a rien de plus vivant ! C’est la porte d’entrée d’une ville !
Comment le musée réussit-il à se conjuguer au présent ?
Le Musée du quai Branly, par exemple, dit le Grand Paris. Les visiteurs ne viennent pas du 7e arrondissement [arrondissement dans lequel est situé le musée] et de l’ombre de la Tour Eiffel. Beaucoup viennent de la banlieue. Beaucoup sont issus de l’immigration et souhaitent retrouver des éléments de la culture d’origine de leurs parents ou grands-parents. Et tout cela est assez émouvant. Il suffit de s’y promener un après-midi pour le constater. Ce lieu est un lieu d’appropriation et pas un lieu de contemplation esthétique abstraite. Et les bibliothèques pleines d’étudiants, l’auditorium et ses concerts ou spectacles de danse en témoignent aussi. Et il en est de même au Louvre ou à Orsay. Rien n’est figé dans le passé et le musée joue un rôle essentiel pour l’avenir.
Ça, c’est la partie utile de l’Histoire.
Oui mais une fois que l’on a dit tout cela, il faut dire que l’art c’est aussi la rêverie, le besoin de faire quelque chose de totalement gratuit. Passer deux heures à ne rien faire, le vendredi soir, dans quelques salles du Louvre sans chercher à s’instruire ou apprendre mais simplement perdre son temps est un enrichissement merveilleux.
L’ennui apparaît à beaucoup comme une perte de temps.
Revenons au sens du mot latin otium. Perdre son temps en s’enrichissant. C’est le loisir au sens aristocratique. C’est la base de ce que l’on appelle la civilisation. Or c’est le negotium qui l’a emporté. Le négoce l’a emporté sur la gratuité des choses. J’aimerais qu’on apprenne des choses inutiles à l’école… Je conseille à mes étudiants de ne pas se contenter des fiches Wikipédia, même si elles s’améliorent, et d’aller voir les expositions qui ne les concernent pas. Voir ce qui n’est pas au programme. Tout ça est possible pour tout le monde. Ce n’est pas élitiste !
Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l’histoire de l’art. Est-ce parce que c’est plus incarné ?
Absolument. Pendant mes études d’histoires, j’avais le sentiment d’une histoire sèche, très statistique, faite de courbes et de chiffres. Or l’art permet de se frotter à des objets qui échappent au temps, qui ont traversé les époques, et suscité des émotions très différentes selon les regardeurs. Chaque génération a réinventé les significations. L’art est un anti-destin et échappe à la chronologie !
Pourquoi avoir écrit des romans ?
J’avais envie de remplir les lacunes de l’histoire. Dans La Dormeuse de Naples, j’étais parti à la recherche d’un tableau d’Ingres qui a disparu du vivant du peintre. Mon idée était que son œuvre est née de cette disparition. Qu’il avait peint les baigneuses car il avait perdu son chef d’œuvre. Comme on ne l’a jamais vu, c’est du roman !
L’art, c’est imaginé des histoires aux œuvres ?
Bien sûr mais on peut aussi retrouver des choses comme le visage de Baudelaire que l’on voit mieux grâce à la restauration du tableau L’Atelier du peintre, de Gustave Courbet. Cette restauration a lieu en public actuellement au Musée d’Orsay. Les œuvres peuvent répondre à des questions parce qu’elles sont vivantes. Le passé est imprévisible.