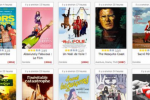Un combat pour la vie (1) : les sages-femmes volantes des routes de Casamance

Un combat pour la vie (1) : les sages-femmes volantes des routes de Casamance
Par Matteo Maillard (Makarissa, Sénégal, envoyé spécial)
Elles sont 17 pour 171 000 habitants. Tous les mois, ces spécialistes sillonnent les 7 000 km2 de la région pour soigner femmes, enfants, vieux. Tout le monde.
La « case de santé locale » près du hameau de Dionie, où les sages-femmes volantes organisent une fois par mois des consultations gynécologiques et de médecine générale. | Mattéo Maillard
Aux confins du Sénégal, une ambulance soulève un épais nuage de poussière sur une piste de latérite. A l’arrière, tout brinquebale. Les boîtes de tests paludéens se renversent, les registres médicaux perdent leurs feuilles, la glacière de vaccins rebondit et l’eau purifiée clapote dans les jerricanes. Malgré le cahot incessant qui ballotte les corps, Ngor Gueye Touré sourit. Le temps est clément, la nature est belle. Aujourd’hui, comme tous les jours, avec son chauffeur, elle a chargé son matériel médical dans la camionnette, donné un tour de clé dans la serrure du poste de santé du village de Marakissa et démarré sa tournée de sage-femme itinérante.
Chaque mois, elle visite au moins une fois les quatorze villages qui composent sa « zone de responsabilité », comme elle l’appelle. Elle prend en charge les grossesses et prodigue des soins élémentaires à près de 8 500 habitants. Ils sont dispersés dans cette nature dense et abondante qui fait de la Casamance un paradoxe. Le grenier du Sénégal mais aussi l’une de ses régions les plus pauvres. Près de 75 % de ses habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. L’accès aux soins est restreint. Un tiers des femmes accouche sans assistance médicale et la mortalité infantile frappe 55 naissances sur 1 000, contre 4 pour 1 000 en France. Aux difficultés du quotidien s’ajoute un conflit indépendantiste débuté en 1982. Bien que silencieux aujourd’hui, il a laissé dans la terre ses fruits mortels. Ces dernières années, plus de 150 personnes sont décédées en ayant marché sur une mine.
Grand détour en cas de boue
A travers le hayon se découpent, dans la poussière, de majestueuses palmeraies. Elles s’érigent au-dessus d’une terre noircie par des feux de brousse. Nous sommes en avril, la saison chaude. Ce qui ne gêne pas Ngor, dont la tête balance doucement dans les secousses de la route. Bien que les 40 °C fassent suer à grosses gouttes, la situation reste plus appréciable que durant la saison des pluies, lorsque les moustiques propagent le paludisme et que les pistes boueuses deviennent impraticables. « Il faut alors faire un grand détour pour rejoindre les villages, perdre du temps et du carburant », explique-t-elle. Deux ressources précieuses quand l’urgence d’un accouchement difficile n’attend pas. Parfois, le véhicule s’embourbe avant d’atteindre les hameaux les plus reculés. Ce qui oblige Ngor à poursuivre à pied avec son chauffeur, les cartons de matériel et la glacière de vaccins sur les épaules.
Il n’est pas rare que la nature reprenne ses droits sur la piste. Un tronc en travers de la route. Des herbes et des branches qui poussent sur la voie. « Alors le chauffeur descend pour les couper à la machette, raconte Ngor. Mais ces barrières géographiques sont surtout un problème pour le déplacement des habitants de la région. C’est pourquoi nous sommes obligés d’aller vers eux. »
Deux mois et 4 000 km de route le long de ce « combat pour la vie »: la santé maternelle et infantile en Afrique de l’Ouest | Infographie "Le Monde"
Sept kilomètres séparent les postes de santé de Marakissa du village de Dionie où nous nous rendons aujourd’hui. Ce trajet abrupt, de nombreuses femmes l’ont tenté en sens inverse, à pied ou à moto, afin d’accoucher au poste dans de meilleures conditions. Certaines n’ont pu atteindre leur but. Elles ont donné naissance à même la terre ocre de la route. Ce qui a coûté la vie aux plus malheureuses, ou celle de leur nouveau-né. « Marcher sur de longues distances enceinte peut être très grave, explique Ngor. Elles peuvent faire une hémorragie et se vider de leur sang. Au contact du sol, l’enfant risque l’infection ou l’asphyxie. On ne pourra pas le réanimer s’il y a un problème. »
Jour de consultation à Makarissa. Les femmes parcourent des kilomètres à pied pour voir les sages-femmes « volantes » de passage dans leur zone « de responsabilité ». | Matteo Maillard
D’autres ont été victimes d’accidents, comme Mbassi Dramé. A 24 ans, elle porte son cinquième enfant mais redoute désormais chaque grossesse. La dernière fois qu’elle était enceinte de trois mois, elle a tenté de rejoindre le poste de santé de Marakissa en moto-taxi. Un virage trop serré, la boue, elle a chuté sur le ventre et s’est brûlée le pied, écrasé par le pot d’échappement. L’accident ne l’a pas arrêtée pour autant. Elle a terminé le trajet à pied. Arrivée au poste de santé, la sage-femme était absente. Partie en ville.
« Je pensais que c’était le jour des visites, raconte-t-elle. Je venais pour effectuer ma première consultation prénatale. » De retour au village, les douleurs au ventre avaient amplifié. Elle saignait abondamment. Le lendemain, c’est la fausse couche. « S’il y avait une ambulance ou de bonnes routes, ces histoires n’arriveraient pas », se désole-t-elle.
Bénédiction de l’imam
Si de bonnes routes il n’y en a toujours pas, désormais une ambulance existe. Et aujourd’hui elle arrive au village. C’est un vieux Kangoo Express beige sur lequel est peint en lettres rouges : « Poste de santé de Marakissa ». Nous freinons au centre de Dionie, soulevant un nuage de poussière devant la maison de l’imam. Avant de soigner qui que ce soit, une visite de courtoisie s’impose « afin de recevoir sa bénédiction et établir un lien de confiance », explique Njama Loly, coordinatrice des sages-femmes itinérantes de Sédhiou qui nous accompagne. Une étape qui ne doit pas être négligée, car « le chef peut intervenir dans le cas d’un refus de vaccination », poursuit-elle. Et les réticences à être vacciné sont nombreuses dans ces villages reculés. En particulier chez les femmes les plus âgées.
« Ce sont les plus dures à convaincre, affirme Njama. Elles ne comprennent pas la nécessité de la vaccination, car elles ont déjà eu de nombreux enfants non vaccinés qui ont eu la chance de ne pas tomber malades. Elles ne retiennent bien souvent que les effets secondaires désagréables, les douleurs, les vertiges, les vomissements… Mais nous leur expliquons que ces effets secondaires peuvent être traités gratuitement. » Un fait nouveau dû à l’application depuis 2013 au Sénégal de la couverture santé universelle qui garantit la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans. Progrès indéniable pour la santé infantile, son application n’atteint pas encore l’intégralité des structures de santé. Trop souvent les approvisionnements en médicaments manquent et les remboursements tardent.
Les deux sages-femmes et le chauffeur déchargent le matériel. Ils le portent en bordure de Dionie, à la « case de santé locale ». « La seule pour les trois villages environnants », résume Ngor. C’est une bâtisse jaune d’une pièce, au toit de tôle, devant laquelle nous attendent cinq femmes à l’ombre d’une bâche. Bientôt elles seront une trentaine. Après avoir terminé de préparer le repas, elles sortiront des maisons de briques ou des cases en torchis alentour, dans des vêtements de bazin éclatants, cinabre, cobalt ou corail, leurs nouveau-nés sur le dos.
L’argent, un frein important
Sur le perron, Madame Daffé. La matrone qui gère la case de santé en l’absence de la sage-femme, nous ouvre la porte. La pièce est sale, l’équipement spartiate. Un lit, une balance, un bidon à robinet, un seau, une table, quelques chaises et c’est tout. Ngor referme les volets rouges afin d’offrir aux patientes de l’intimité et leur épargner la chaleur. Elle chasse d’une injonction les gamins curieux qui s’agglutinent en riant à la fenêtre. À l’intérieur, il fait noir. Depuis longtemps qu’il n’y a plus d’eau ni d’électricité. Alors les sages-femmes pratiquent l’accouchement à la lampe frontale, dans une obscurité de cellier.
Cela exige une attention sans faille. Une maîtrise absolue de ses outils et de ses mouvements. « Question d’habitude », glisse avec humilité Ngor. Elle sort son matériel. Entoure sa nuque d’un stéthoscope et ouvre sur la table les registres où sont inscrits le nom des patientes, leurs informations personnelles, leurs antécédents médicaux, les vaccins reçus, le nombre d’enfants et de consultations suivies. « Ici nous sommes tout : le médecin, le gynéco, le pédiatre, tout ! s’exclame-t-elle avec un peu de fierté. Aujourd’hui je suis chanceuse puisque ma cheffe, Njama Loly, m’appuie dans ma tâche. D’habitude, je suis toute seule. »
Consultation gynécologique à l’abri des regards et de la chaleur. Les sages-femmes « volantes » oscultent à la lampe frontale. | Mattéo Maillard
La porte s’ouvre, et les patientent défilent les unes après les autres dans la pièce. D’abord une silhouette frêle, le visage entouré d’un voile poussin qu’un rai de lumière fait scintiller. Kadiata a 18 ans et c’est sa première grossesse. Sur les quatre consultations prénatales, elle a manqué la deuxième. Ngor et Njama l’auscultent mais la grossesse semble ne pas avoir évolué. « Je ne sais pas si elle a avorté, puisqu’elle n’est pas venue la dernière fois », glisse Ngor. « Il faut une échographie de confirmation, surenchérit Njama. Elle va devoir prendre le bus pour la ville. Mais difficile de savoir si elle va vraiment le faire. » S’engage alors un dialogue en mandingue pour sensibiliser la jeune fille qui répond en cliquetant de la langue. « Ça veut dire qu’elle a compris », indique Njama, à demi-convaincue. L’argent est un frein important dans ce genre de cas.
Bien souvent, les sages-femmes fournissent des ordonnances dont les traitements ne seront pas suivis, faute de moyens. Certains médicaments coûtent plus de 5 000 francs CFA (7,60 euros). Au-dessus de ce qu’une famille dans cette région peut espérer gagner une année de mauvaise récolte. Dans les rizières, les femmes ne cultivent que ce qui servira de subsistance à une famille nombreuse. Les hommes, eux, font de l’arachide. Ils en vendent une partie au marché afin d’économiser pour les mois suivants. Un pécule qui tient rarement plus de quelques mois.
Contraception et vaccinations
Comparés aux médicaments, les compléments comme le fer sont moins chers. Ngor en prescrit souvent aux femmes enceintes. En particulier aux femmes qui ont eu plus de cinq enfants et ont davantage de risques de faire une hémorragie, à l’instar de cette femme de 30 ans, qui a déjà fait deux fausses couches et vient aujourd’hui pour sa onzième grossesse. Elle s’appelle Mousso Luba (« grande dame » en mandingue) et a des contractions. « C’est dû au travail, explique Ngor. Ces femmes travaillent beaucoup. » Elle débute son neuvième mois de grossesse. « C’est le moment de la sensibiliser sur les méthodes contraceptives, poursuit-elle. Nous devons éviter qu’elle soit à nouveau enceinte car elle court le risque d’une grave hémorragie. » Mousso écoute. Elle est réticente à prendre des comprimés de fer. « Je la préviens de ne pas le cacher sous le lit. On retrouve souvent les boîtes non ouvertes lors des enquêtes à domicile. Ce sont les maris qui les dénoncent. Ils n’aiment pas payer un traitement et découvrir que leur femme ne le prend pas à cause des nausées. »
Au tour d’Aminata Baro, 30 ans, qui est en retard. Elle vient pour l’examen prénatal. Elle en est à 6 mois et demi de grossesse. Sa sixième. Elle se plaint de maux de tête. Njama l’allonge sur la table. Elle promène le faisceau de la lampe frontale de la gorge jusque sous le pagne, avant de relever la tête d’un air satisfait. « Elle a les muqueuses colorées, ce qui signifie qu’elle n’est pas anémiée. Elle n’a pas d’œdème non plus. » Sur son ventre, elle pose un stéthoscope afin d’écouter les battements du cœur du bébé. « Ils sont… réguliers ! » Elle baisse à nouveau la tête. « Le col est médian. Les mollets sont souples, pas de thrombophlébite. » Aminata se rassied. « On profite de la consultation prénatale pour vérifier qu’elle n’est pas malnutrie en prenant son poids et périmètre brachial », explique Njama pendant que Ngor sort un vaccin antitétanique de la glacière et pique le bras d’Aminata qui se crispe de surprise. « Vu que c’est son premier contact avec nous, on lui propose un test VIH », embraye-t-elle. Deuxième piqûre, au doigt cette fois. Aminata reste stoïque. Trois minutes suffisent pour voir le résultat… négatif ! « Il arrive souvent qu’il soit positif même dans ces petits villages, à cause de relations sexuelles extra-conjugales parce que les femmes partagent leur rasoir ou des aiguilles », déplore Ngor.
Pas de frontière
En Casamance, il est commun qu’une famille vive des deux côtés d’une frontière. Les Peuls, les Mandingues, les Dioula sont des peuples nomades. Ils mènent leurs troupeaux où l’herbe pousse. Ne se préoccupent que peu des frontières étatiques, poreuses de fait, peu adaptées aux ethnies, aux tribus et au nomadisme. A Dionie, Aissatou Daffé, 25 ans, est une Gambienne venue s’installer avec son mari sénégalais. Ils sont de la même grande famille Daffé. Elle l’a rencontré alors qu’il rendait visite à ses proches du côté gambien. Séduit par Aissatou, il l’a emmenée à Dionie pour la marier. Aujourd’hui elle est enceinte de trois mois et demi. Ce sera son quatrième enfant. Le fœtus est en bonne santé. Si elle est venue voir les sages-femmes aujourd’hui, c’est surtout pour recevoir son vaccin antitétanique et se faire dépister pour le VIH. Le résultat sera négatif comme pour Aminata.
Le jour décline derrière les fromagers centenaires et les manguiers. Depuis le matin, plusieurs dizaines de femmes sont passées entre les mains de Ngor et Njama, mais la journée n’est pas terminée. Heureusement, il n’y a pas eu d’urgence cette fois. Quand cela arrive, il faut glisser un matelas à l’arrière du Kangoo pour y charger la patiente. Quand il n’y a pas assez de place, on laisse le matériel au village. Si l’urgence exige une césarienne ou une prise en charge complexe, il faudra aller jusqu’au centre de santé de Sédhiou. Un voyage qui peut prendre plusieurs heures si le terrain est boueux.
L’imam reste une personnalité centrale dans la vie des villages. Même les médecins doivent avoir leur accord pour soigner. Il est appelé à trancher en cas de désaccord ou de différend. | Matteo Maillard
Ngor se dit bien souvent épuisée par l’ampleur de la tâche. Son premier souhait ? Etre assistée par du personnel qualifié : « Mais il nous faudrait aussi de l’électricité, des frigos. Aujourd’hui ils sont à gaz, c’est dangereux. Ils tombent en panne quand les bonbonnes sont terminées alors nous devons transférer en urgence les vaccins. » Njama complète : « Et aussi une ambulance plus adaptée ! Dans le district, il n’y a que cinq postes avec des ambulances en état de marche. Les zones les plus enclavées n’en ont pas et il est impossible d’évacuer les malades graves. »
Dans le district de Sédhiou où Ngor et Njama exercent, elles sont 22 sages-femmes employées par l’Etat, dont 17 qui travaillent en itinérance. C’est bien peu pour couvrir une population de 171 000 habitants sur un territoire d’environ 7 000 km2, traversé d’innombrables forêts, rivières, rizières, savanes et marécages qu’elles parcourent sans relâche. Les populations les considèrent comme leurs anges gardiens. Ici on les appelle les sages-femmes volantes.
Prochain épisode : Portrait d’Aïcha, 13 ans, « tombée enceinte par erreur »
Cet article est le premier de la série d’été du Monde Afrique, « Un combat pour la vie », qui va nous mener du Sénégal aux rives du lac Tchad, 4 000 km que notre reporter Matteo Maillard a parcourus entre avril et juin 2016.