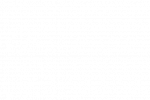Le Festival d’automne s’achève sur une jolie note de « nô »

Le Festival d’automne s’achève sur une jolie note de « nô »
Par Pierre Gervasoni
La création d’un opéra de Toshio Hosokawa a constitué le temps fort du concert de clôture.
La 46e édition du Festival d’automne, à Paris, s’est achevée, pour sa partie musicale, vendredi 1er décembre, par un concert entièrement voué au Japon. Pas le Japon d’importation, du genre « année culturelle », mais ce Japon « hors les murs », représenté par des compositeurs qui, depuis un bon demi-siècle, participent au développement de la musique occidentale dite « contemporaine ». Qu’ils soient restés actifs dans leur pays d’origine, comme Toru Takemitsu (1930-1996), ou installés en Europe après y avoir complété leur formation, comme Toshio Hosokawa (né en 1955 à Hiroshima et fixé en Allemagne depuis 1976).
La programmation de ces deux compositeurs dans un concert de l’Ensemble intercontemporain (EIC), à la Philharmonie de Paris, s’inscrivait donc dans une des démarches qui ont forgé l’identité du Festival d’automne : la mise en perspective. Qualité à laquelle on pourrait ajouter la volonté d’offrir au public des conditions optimales de perception, de l’immerger dans un espace où tout est régi par le son. C’est ce qui se produit dans l’ancienne salle de la Cité de la musique plongée dans le noir à l’amorce d’Atem-Lied (1997), pièce pour flûte basse de Toshio Hosokawa. La soliste, Emmanuelle Ophèle, ne sort de l’obscurité qu’au moment d’émettre le premier souffle (Atem, en allemand) d’une expression qu’elle va livrer, sur scène, au centre d’un cercle de lumière, comme une performance d’arts plastiques. Intimement associés dans le lent tracé de ce lied (mélodie chantée, au sens de Schubert ou de Mahler) sans paroles, les bruits (émis par la bouche ou par les clés de l’instrument) et les notes (parfois simultanément jouées et chantées par l’interprète) aboutissent à une véritable incantation. Tout le contraire de la partition mille fois entendue à partir de semblables « effets ».
Aux ondulations, brèves et insolites, du solo de Toshio Hosokawa, succèdent les vaguelettes, furtives et référencées, d’Archipelago S. (1993), de Toru Takemitsu. Sur le plateau, trois groupes d’instruments évoquent des îles tandis que, de part et d’autre du public, deux clarinettistes « éclairent » périodiquement l’ensemble à la manière de phares.
Histoire d’amour du XIIe siècle
Périlleuse pour les interprètes (que de solos à risque pour les membres de l’EIC, qui s’en tirent toujours bien !) et vaporeuse pour l’auditeur (lassé, à la longue, par cette diffusion à base de « sprays » esthétisants), la partition paye élégamment sa dette debussyste sous la direction hédoniste de Matthias Pintscher. L’influence de Debussy sur Takemitsu est encore plus marquée dans le numéro suivant du concert, And Then I knew’twas Wind (1992), un trio qui reprend l’effectif de la mythique Sonate pour flûte, alto et harpe, de « Claude de France ». Du Takemitsu évanescent. Hautement raffiné mais creux.
Pour retrouver de la chair, des formes – bref, un corps – dans la musique, il faudra attendre la création, donnée après l’entracte, d’un opéra d’environ quarante minutes composé par Toshio Hosokawa en collaboration avec le dramaturge Oriza Hirata, auteur du livret et de la mise en espace. Futari Shizuka, the Maiden From the Sea s’inspire d’une pièce de théâtre nô qui fait écho à une tragique histoire d’amour du XIIe siècle. Le frère aîné d’un invincible samouraï se venge des succès guerriers de son cadet en emprisonnant l’amante de ce dernier, Futari Shizuka, et en se débarrassant de leur enfant nouveau-né. Selon la légende, Futari Shizuka se réincarnerait à chaque apparition d’une jeune femme souffrant des mêmes maux.
Dans l’opéra, il en va ainsi d’Helen, échouée sur une plage de la Méditerranée au terme d’une expédition de migrants qui s’est soldée par la mort de son jeune frère. Blonde aux pieds nus, droite dans une longue robe blanche, Helen a tout de l’héroïne nordique (la Solveig de Peer Gynt) sous les traits de Kerstin Avemo, soprano suédoise à la voix ferme et aux aigus faciles. L’esprit qui vient l’habiter est figuré par Ryoko Aoki, actrice nô, vêtue d’un kimono blanc aux manches aussi amples que ses imprécations dans le registre grave. La passe d’âme, de Shizuka à Helen, intervient lors d’un magnifique épisode a capella. Tantôt fracassant, tantôt immatériel, l’accompagnement orchestral définit un cadre dramatique idéal pour cet opéra-mirage légitimement ovationné par une salle replongée dans le noir.