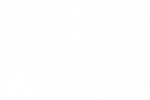« Au vu de l’ampleur et l’ancrage des mobilisations, le Soudan tient son printemps »
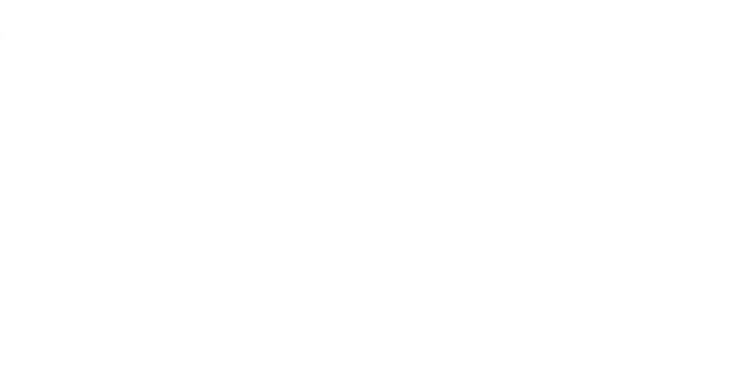
« Au vu de l’ampleur et l’ancrage des mobilisations, le Soudan tient son printemps »
Propos recueillis par Joan Tilouine
« Aujourd’hui, le Conseil militaire n’est pas légitime aux yeux de ceux qui ont risqué leur vie depuis des semaines », estime le chercheur Jean-Nicolas Bach, coordinateur du CEDEJ et de l’Observatoire de l’Afrique de l’Est, à Khartoum.
Les manifestations au Soudan ne faiblissent pas. Après trente ans de pouvoir, le président soudanais Omar Al-Bachir a été destitué par l’armée, jeudi 11 avril. Depuis, un Conseil militaire dirigé par le ministre de la défense, Aouad Ibn Aouf, a été mis en place, promettant qu’il ne « gouvernera pas, il se contentera d’être le garant d’un gouvernement civil ». Les manifestants continuent toutefois de maintenir la pression, et réclamer le départ des généraux accusés de confisquer cette « transition » et d’exiger un « Conseil civil ».
Vendredi, dans la soirée, M. Ibn Aouf a annoncé sur la télévision publique qu’il renonce à sa tâche et que le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahmane le remplace. Nouvelles scènes de liesse à Khartoum, la capitale soudanaise avant que le lendemain, Saleh Gosh, chef du puissant service de renseignement (NISS), ne démissionne à son tour. En dépit de sa répression brutale et son couvre-feu, les manifestants ont maintenu les rassemblements devant ses locaux obligeant à s’interroger sur le système « post-Bachir ».
De Khartoum où il coordonne le CEDEJ et l’Observatoire de l’Afrique de l’Est, le chercheur Jean-Nicolas Bach, livre son analyse sur ce mouvement populaire et les bouleversements politico-militaires à l’œuvre au sein de l’appareil d’Etat.
Comment expliquez-vous la longévité de ce mouvement de protestation et son « efficacité » ?
Jean-Nicolas Bach : L’ampleur et l’ancrage dans le temps de ces mobilisations sont des caractéristiques fortes. On peut avancer quelques pistes pour expliquer la ténacité et le courage dont font preuve les Soudanais depuis décembre 2018, dans des conditions extrêmes dans les rues, et ces derniers jours sur les places.
Le premier élément d’analyse tient précisément à l’histoire des manifestations et des révolutions au Soudan, qu’on peut situer à plus court terme dans la lignée de ce qui fut appelé les « printemps arabes ». Depuis, de nombreuses autres manifestations ont eu lieu sous différentes formes : des mouvements étudiants, les tristement fameuses manifestations réprimées dans le sang en 2013 - on parle de 200 morts - jusqu’aux mouvements de désobéissance civile en 2016 qui ont glissé vers une grève générale.
Ces épisodes se révèlent significatifs des modalités de manifestations innovantes des organisateurs, qui agissent désormais via les réseaux sociaux, comme cette opération ville morte en 2016 pensée pour éviter de répéter les violences survenues trois ans plus tôt. Ce sont ces modes d’action que l’on retrouve aussi en partie dans les mobilisations actuelles.
Les actions sont plutôt sporadiques - jusqu’à la semaine dernière du moins -, organisées en plusieurs cortèges de taille réduite en différents lieux de la capitale. Si cela complique le travail de la police, l’absence de mobilisation de masse rend aussi les manifestants plus vulnérables aux gaz lacrymogènes lancés à foison et aux tirs à balle réelle. En résumé, l’histoire de la contestation continue donc de se construire et s’accélère depuis décembre, avec son lot de martyrs, de moments forts, et une place particulièrement importante donnée aux femmes.
Quelle analyse faites-vous des réactions du régime qui s’est montré incapable de prendre en compte les revendications de la rue ?
L’incapacité du gouvernement à proposer la moindre réponse crédible et durable à la crise profonde dans laquelle le pays s’est enfoncé est la deuxième spécificité de ce mouvement. Pour comprendre, il faut analyser cette crise à l’aune d’un temps plus long. Le régime a développé des politiques qui ont conduit à la dégradation générale de la situation socio-économique du pays dans les années 1990, et n’a pas su profiter des revenus pétroliers des années 2000 et en faire le levier d’une restructuration de l’économie qui aurait permis de sortir d’une économie majoritairement agricole.
Les sanctions commerciales imposées par les États-Unis entre 1997 et 2017 n’ont sans doute pas aidé, mais tout part d’une mauvaise gestion nationale et du choc que représente la perte des deux tiers des revenus pétroliers suite à l’indépendance du Soudan du Sud en 2011. Cette conjonction de facteurs internes et externes explique la crise actuelle face à laquelle le régime n’a plus de réponse. Il n’a plus non plus beaucoup d’amis prêts à le soutenir à l’international, et est à cours de « poudre de perlimpinpin » à l’intérieur.
L’année 2018 cumule une inflation de plus de 70 %, une grave crise des liquidités, des pénuries répétées d’essence et de diesel, et une augmentation très forte des produits de base. On entend souvent, sans doute à juste titre, que l’augmentation du prix du pain, multiplié par trois en décembre 2018 après avoir déjà doublé en début d’année serait l’élément déclencheur de ces manifestations. Ce n’est pas faux, mais c’est plutôt cet ensemble de difficultés quotidiennes qui explique l’explosion de colère, sur fond de crise structurelle.
Réduire ce mouvement à des « révoltes du pain » n’occulte-t-il pas, en plus, les revendications multiples, notamment d’ordre politique ?
Effectivement, le facteur économique ne doit pas cacher le caractère profondément politique du mouvement. Omar Al-Bachir n’est pas tombé pour le prix du pain. Plutôt qu’un mouvement contre la vie chère qui aurait pris une tournure politique, c’est une crise politique profonde qui a conduit au 11 avril.
Les ressorts profondément politiques de la révolte sont particulièrement perceptibles dans les slogans les plus récurrents : « Liberté, paix, justice. La révolution est le choix du peuple ! », ou encore « Qu’il tombe [le régime], un point c’est tout ». « On écrase les KOZ sous nos chaussures » [gobelet en fer se référant au parti au pouvoir, nom donné du temps où Hassan Al-Tourabi, idéologue islamiste, y jouait un rôle prédominant]. Pendant la matinée du jeudi 11 avril, lorsque les manifestants célébraient ce qu’ils croyaient alors être la chute du régime, on pouvait entendre : « Ils sont tombés ! Le Ramadan sans les Kaizan » [pluriel de KOZ]. Dès le début de la révolte les chants ont été profondément politiques.
Comment le gouvernement a-t-il géré la situation, au début, en décembre ?
D’abord, une réponse violente a tenté de masquer l’absence de réaction économique ou politique.
Les premières semaines de manifestations de décembre 2018 - janvier 2019 ont été marquées par plusieurs dizaines de morts, le plus souvent par balle. Pressentant que la révolution commençait à produire ses martyrs et qu’elle avait peu de chance de s’essouffler, le gouvernement a dans un second temps changé de discours et refréné la répression visible.
Il a donc tenté de l’invisibiliser en continuant à arrêter massivement, à maltraiter voire à torturer tout sympathisant, en remontant les listes des téléphones portables et des groupes WhatsApp. D’autre part il a appelé au calme, déclarant comprendre la jeunesse soudanaise soumise à des lois injustes imposées par les islamistes dans les années 1990.
Des manifestants réunis à Khartoum, près du ministère de la défense, le 12 avril. / STRINGER / REUTERS
Quel rôle a joué l’Association des Professionnels Soudanais (SPA), en pointe dans la structuration et la mobilisation du mouvement ?
Cette association a joué un rôle essentiel. Elle s’est imposée progressivement en appelant à manifester via les réseaux sociaux. En parallèle, elle a maintenu ses activités clandestines de sorte que, jusqu’à ce jour, elle n’a pu être neutralisée par le régime et échappe totalement aux partis dits classiques.
C’est précisément cette association qui appelle à se rendre au Quartier Général des Forces Armées Soudanaises le 6 avril, date anniversaire de la chute du régime militaire de [Gaafar Mohammed] Nimeiry en 1985. Ce sera un moment déterminant pour la suite de la révolution puisque les manifestants sollicitaient depuis des mois l’armée pour faire tomber le régime et redonner le pouvoir au peuple, comme elle l’avait fait en 1964 et en 1985.
L’armée hésitante et sans doute bloquée par des clivages internes, n’avait pas encore pris position, se contentant de déclarer à plusieurs reprises qu’elle ne participerait pas à la répression des Soudanais. En se rendant au QG des Forces armées soudanaises (FAS), il s’agissait de pousser les militaires à se positionner clairement en faveur du peuple.
Les FAS sont les seules à disposer d’une image protectrice, contrairement aux autres branches sécuritaires armées qui effraient pour leurs exactions et leurs modes d’action violents. Le NISS ou encore les Rapid Support Forces constituées d’anciens djanjawid connus pour leurs exactions au Darfour sont, elles, perçus comme des unités de persécution du peuple.
Quelle est l’histoire du SPA et comment se positionne cette association sur l’échiquier politique ?
Le SPA n’est pas né avec cette révolution mais remonte aux manifestations de 2012-2013, moment où elle coalise des associations de professions libérales - médecins, pharmaciens, journalistes -. Il faudra mener davantage de recherche sur cette association, mais ce que l’on sait aujourd’hui, c’est qu’elle a été réactivée en décembre pour progressivement occuper un rôle central, qu’elle a agi comme un catalyseur, organisant les appels et définissant les parcours.
Elle a su se superposer ou s’articuler avec des initiatives prises dans les quartiers et ses liens avec la diaspora semblent forts , mêmes si son ancrage reste soudanais. Le SPA puise notamment son inspiration et son influence dans l’héritage de la gauche soudanaise. L’association s’est récemment alliée, au National Consensus Forces [coalition de partis d’opposition], à l’Unionist Gathering et au Sudan Call [alliance de partis d’opposition et de mouvements armés], au sein d’une coalition appelée les Forces de la Liberté et du Changement.
Comment l’alliance entre le « bas de l’armée » et le peuple s’est-elle consolidée ?
Depuis le 6 avril, les Soudanais qui opéraient jusque-là de façon relativement sporadique disposent de ce qui leur manquait : une place de ralliement, et la protection d’une partie de l’armée qui a fait le choix de la mutinerie pour protéger le peuple.
Soldats et manifestants partagent désormais une communauté de destin car le peuple a besoin des soldats pour repousser les attaques de la police ou des milices politiques - ce qui s’est produit les premières nuits -, mais les soldats rebelles ont besoin du peuple pour les protéger d’un régime qui résiste et qui sera sans doute sans pitié pour les mutins.
Des soldats de l’armée soudanaise se joignent aux manifestants, le 13 avril, à Khartoum. / STRINGER / REUTERS
Sait-on comment se gère cette séquence au sein de l’armée, à l’heure où le « Conseil civil » réclamé par les manifestants se fait encore attendre ?
C’est une question absolument centrale. La suite des événements va largement dépendre de l’issue de la crise au sein de l’armée, qui pourrait même la diviser des autres forces de sécurité.
Si l’on remonte les faits, le samedi 6 avril, les manifestants se rendent au QG de l’armée pour lui demander d’opérer un coup d’état et d’assurer le passage immédiat à une transition dirigée par des civils. Les soldats sur place, dont le nombre et les grades ne sont pas encore bien clairs, ne s’engagent pas dans un tel scénario mais prennent cette initiative formidable de proposer au peuple de rester sur place, leur assurant une protection et leur distribuant à manger et à boire.
Les FAS ont au départ la réputation de soutenir le peuple pour avoir assuré le passage à une transition démocratique en 1964 et en 1985, mais il faut néanmoins souligner le caractère inédit de ce qui se déroule là. C’est le peuple qui est venu chercher l’armée dans les casernes, lui demandant protection. Il ne s’agit donc pas d’un mouvement militaire encerclant le palais présidentiel comme en 1964, mais au contraire, les forces mutinées sont elles-mêmes encerclées, protégées à leur tour par la foule.
Autre différence de taille : les présidents Ibrahim Abboud et Gaafar Mohammed Nimeiry - déchus respectivement en 1964 et en 1985 - sont tombés rapidement face à un corps militaire certes multiple, mais unique. Aujourd’hui, les Forces armées soudanaises représentent une force parmi d’autres, à côté du NISS et des RSF.
En retrait depuis le début des manifestations, Mohamed Hamdan Doglo plus connu comme « Hemeti », le chef des RSF, qui avait dans un premier temps refusé d’engager ses forces contre le peuple, a fini par confirmer son ralliement aux militaires, après avoir exprimé des excuses publiques pour son soutien initial au Conseil militaire d’Ibn Aouf. Le 12 avril au soir, après avoir déclaré qu’il quittait le Conseil militaire, ses troupes ont rejoint le QG de l’armée et les manifestants auprès desquels il tente de se refaire une image. Saleh Gosh, le patron du NISS a quant à lui démissionné le 13 avril. Ce qui laisse entrevoir une reconfiguration des rapports de force.
Quel rôle ont joué les « classes moyennes » autrefois privilégiées par le régime d’Omar Al-Bachir, dans les années 1990 ?
Un aspect intéressant du mouvement, c’est qu’il n’échappe pas seulement au pouvoir en place mais aussi aux partis classiques fondés sur des familles ou des confréries qui ont des difficultés à se positionner. On se rend compte du rôle central joué par les classes moyennes dans la contestation du régime, les capacités d’innovation technologiques, communicationnelles et organisationnelles qui sont essentielles au succès du mouvement. Et il semblerait que ce soit bien le cas dans les événements que nous vivons aujourd’hui. En revanche, on sait aussi la volatilité de la catégorie « classe moyenne » et les réalités sociales complexes qu’elle recouvre, ce qui invite à l’utiliser avec prudence au-delà de ce que les événements nous donnent à voir.
Alaa Salah, devenue une icône du mouvement de protestation, le 10 avril, à Khartoum. / AFP
Quid de la mouvance plutôt bien structurée d’associations et de partis prônant un islam politique ?
Une ligne de réflexion importante à explorer concerne l’émergence ou la réémergence d’un groupe politique séculaire d’une part, et l’affaiblissement, voire l’échec du projet islamiste soudanais d’autre part. Le SPA peut en effet être situé dans la ligne historique de la gauche soudanaise. Cela ne signifie pas que le travail avec certains groupes islamistes soit inenvisageable dans un contexte spécifique, mais cela pourrait annoncer le dernier souffle d’un islamisme d’État autoritaire et vertical, hérité des années 1980 et 1990.
La probable arrestation - à prendre avec prudence, car les informations manquent encore - de leaders islamistes de haut rang, ralliés à Omar Al-Bachir à la fin des années 1990, pourrait confirmer le fait que l’on vit aussi un moment historique pour la reconfiguration du champ politique et, peut-être, la mort de cette interprétation soudanaise de l’islam politique.
En dehors de Khartoum, comment cette contestation s’est-elle exprimée ?
Plusieurs villes ont été agitées par ces mouvements sociaux, au départ desquelles Atbara (nord-est) dont on a beaucoup parlé, peut-être parce qu’elle a été la première à subir l’augmentation du prix du pain en décembre. D’autres villes du nord (Dongola, par exemple), de l’Est (Gedaref et Kassala), du Kordofan (El-Obeid), ou du Darfour (Nyala) auraient également « bougé », à des degrés différents. Mais la dimension d’ensemble du mouvement est encore difficile à évaluer.
En dehors de Khartoum, le SPA a également appelé les manifestants à demander protection aux casernes. Ce qui semble avoir été suivi dans certaines villes même si la situation paraît plus tendue au Darfour, où des unités du NISS auraient ouvert le feu tentant de prendre leur siège. Ces types de violence sont beaucoup moins visibles qu’à Khartoum mais sont révélateurs des enjeux pour la suite des mouvements. Ces derniers jours, les violences se sont multipliées au Darfour où le rôle du NISS et des RSF, malgré leur ralliement à la révolution, reste trouble.
Tout comme on doit évaluer l’élargissement social du mouvement, on doit également prendre en compte son expansion régionale. Quid du positionnement des mouvements rebelles qui persistent au Darfour et que l’on entend peu s’exprimer ?
Il n’est pas rare d’entendre à Khartoum des Four [communauté non-arabe du Darfour] exprimer leur distance vis-à-vis de ces mobilisations. ils rappellent que la capitale du Soudan et les « populations de la vallée du Nil » - entendre les élites historiques de la formation de l’État - n’avaient « pas bougé » lorsque les massacres se déroulaient au Darfour dans les années 2000. En parallèle, on a aussi vu défiler des manifestants aux cris de « Nous sommes tous Darfouri ! ». Tout cela laisse la question ouverte la question de la jonction entre les mouvements opposés au régime, malgré leurs profondes divergences.
Omar Al-Bachir, président destitué par l’armée le 11 avril 2019, ici photographié un mois plus tôt, à Khartoum. / ASHRAF SHAZLY / AFP
Qu’a fini par incarner la figure d’Omar Al-Bachir ?
Dès le départ de ce mouvement, la question de la destitution de Bachir est apparue comme primordiale et non négociable. Qu’il soit jugé par la Cour pénale internationale (CPI), qu’il trouve refuge en Arabie Saoudite ou qu’il soit emprisonné au Soudan est finalement secondaire : « qu’il tombe, c’est tout ! », s’est très rapidement imposé comme le principal slogan de la lutte.
Nous avons pu entendre des commentaires selon lesquels l’« armée avait mis fin au régime », ou qu’une « transition » avait été enclenchée. En réalité, Omar Al-Bachir est tombé, mais le régime reste en place, ses problèmes et blocages également. Il n’y a donc pas de transition, mais a priori une tentative plutôt grossière de sauver ce qui reste à sauver du régime. C’est ce que doit dissiper aujourd’hui, et au plus vite, le nouveau responsable du Conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahmane.
La question du « départ » d’Omar Al-Bachir reste elle-même sujette à caution puisque le Conseil militaire a déclaré que le président destitué avait été placé en « sécurité ». Il a même précisé, vendredi 12 avril, qu’il resterait au Soudan, où il devrait donc a priori répondre des accusations qui pèsent sur lui.
On a néanmoins quelques difficultés à saisir le sens de tout cela, dans la mesure où le ministre de la défense initialement choisi pour lui succéder, le général Aouad Ibn Aouf est lui aussi impliqué dans les exactions commises au Darfour, comme l’a rappelé le département d’Etat américain. Il en va de même du commandant des RSF, « Hemeti », initialement membre de ce Conseil militaire jusqu’à ce qu’il en annonce sa sortie. Le général Ibn Aouf a fini par démissionner.
Il reste deux interprétations possibles quant au départ d’Omar Al-Bachir : Soit il s’agit d’une mise en scène bien préparée dans laquelle il continue à jouer un rôle dans l’ombre en conservant sa résidence au Soudan et donc en se protégeant de la CPI avec les « nouveaux » leaders. Soit, ce qui est plus probable, ces derniers ont saisi une occasion de marginaliser le président gênant, pour prendre la relève. Mais cela n’est certainement pas suffisant pour répondre aux attentes des manifestants.
Dans les deux cas, cette stratégie semble intenable à très court terme et il y a fort à parier que ce Conseil militaire se délitera rapidement à partir de pressions à la fois internes et externes.
A l’échelle régionale, peut-on attendre des changements de la politique soudanaise sur des dossiers sensibles comme la répartition des eaux du Nil, l’implication de soldats au Yémen, la relation avec l’Egypte, la Turquie et certains pays du golfe ?
L’Union africaine a émis le jour même du coup d’état une déclaration sévère à l’égard du Conseil militaire. Sans surprise, l’Égypte, a immédiatement déclaré son soutien au Conseil militaire. Plusieurs déclarations égyptiennes avaient déjà affiché ces derniers mois un soutien très fort à Omar Al-Bachir face aux manifestants.
Les eaux du Nil sont un dossier sensible, et le président égyptien sera plus enclin à négocier avec des généraux soudanais qu’avec des révolutionnaires ou des islamistes. La Turquie et la Russie ont, eux, appelé au calme, sans toutefois marquer leur opposition au Conseil militaire. Ces deux pays ont en commun d’avoir ouvert d’importants dossiers commerciaux et sécuritaires au Soudan, pays clé pour leur stratégie africaine, où des concessions portuaires leur ont notamment été garanties l’an dernier.
Quant aux pays du Golfe, on pourrait assister à un alignement sur le camp de l’Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis, plutôt que sur le Qatar. Le général Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahmane étant réputé proche d’Abu Dhabi et très impliqué dans la gestion de l’envoi des troupes soudanaises qui combattent les Houthis au Yemen.
Dans l’ensemble, je reprendrai les mots très justes de mon collègue Clément Deshayes récemment interrogé au sujet du positionnement international à l’égard du Soudan : « personne ne veut faire tomber le régime, mais personne n’ira voler à son secours non plus ». Aujourd’hui, le Conseil militaire n’est pas légitime aux yeux de ceux qui ont risqué leur vie depuis des semaines. Sa durée de vie même paraît extrêmement limitée, la défection de « Hemeti » étant symptomatique de cela. Le Soudan tient son printemps. Mais des facteurs inquiétants demeurent : quelle place pourra occuper le NISS ? Comment éviter les purges à l’échelle du pays ? Comment concilier militaires de hauts rangs et civils au sein d’une transition dont les contours se font attendre ?