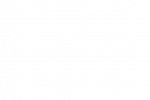En école de commerce, les étudiants boursiers et leur épée de Damoclès

En école de commerce, les étudiants boursiers et leur épée de Damoclès
Propos recueillis par Marine Miller
Ces étudiants se sentent souvent « en situation de porte-à-faux social au milieu d’étudiants majoritairement issus des classes supérieures », analyse le sociologue Arnaud Pierrel. Les prêts que certains contractent ont souvent un impact sur leur choix de carrière.
A l’ESCP, une année de master « grande école » est facturée 16 000 euros. / ESCP Europe
Les écoles de commerce, où les frais de scolarité avoisinent les 10 000 euros par an, et jusqu’à 16 000 euros pour certaines, accueillent des publics majoritairement favorisés. Les étudiants boursiers – 14 % des effectifs de ces établissements, selon les chiffres du ministère –, issus de familles aux moyens financiers limités, se retrouvent souvent en porte-à-faux dans cet univers. Une situation difficile à évoquer dans leur entourage, qui peut créer des tensions familiales, et influence des choix de carrière ou de spécialité. Arnaud Pierrel, sociologue, doctorant à l’université de Poitiers, a consacré ses recherches à ces étudiants « transfuges ».
« Je venais de passer vingt ans de ma vie à faire tout ce qu’il faut, classes prépas et admis parmi les trois [grandes écoles] parisiennes, t’arrives à la banque, on te rappelle boum que ton père n’a pas gagné sa vie comme il faut pour que tu aies le droit d’[avoir un prêt] et d’aller à l’école. » Vous citez le récit de cet étudiant dans vos travaux de recherche sur les boursiers dans les écoles de commerce. Comment analysez-vous ce témoignage ?
Arnaud Pierrel : On a tendance à évaluer l’ouverture des grandes écoles de commerce à l’aune des origines sociales des admis aux concours, du poids des diplômes dont sont titulaires leurs parents. Mais on oublie de penser le volet économique : celui des frais d’inscription, et ce qu’ils signifient. En prépa, la plupart des étudiants n’ont pas d’idée précise concernant le financement de leurs études, et ne connaissent pas bien le montant des frais de scolarité auxquels ils devront faire face. On leur dit : « Ce ne sera pas un problème parce que vous aurez accès aux prêts bancaires ». C’est partiellement vrai, dans la mesure où contracter un prêt nécessite de pouvoir trouver un garant dans son entourage, ce qui n’est pas toujours possible. L’une des étudiantes que j’ai rencontrée m’avait dit : « C’est ma tante qui est garante, enfin de ce que j’ai compris, parce que ma mère est assez mystérieuse sur ça. Elle vit très mal le fait de ne pas pouvoir nous aider financièrement, donc du coup, elle ne nous en parle pas trop. »
Dans son livre blanc sur l’ouverture sociale, la Conférence des grandes écoles estime qu’il n’y a « pas ou plus » de problème d’ordre matériel et que « chaque étudiant qui intègre ces écoles trouve une solution ». Peut-être, mais ces solutions peuvent être source de tension dans les relations familiales, engendrer des sentiments d’humiliation sociale comme dans les cas de refus de prêt, ou encore être très fortement contraintes et subies. Par exemple pour ceux qui n’ont pas d’autre choix que de poursuivre leur cursus par la voie de l’apprentissage, afin que leurs frais de scolarité soient pris en charge par leur employeur.
Les frais de scolarité dans les écoles de commerce ont beaucoup augmenté. Quel a été l’impact de cette évolution ?
Les frais de scolarité ont connu une hausse continue depuis 1980. Aujourd’hui la moitié des formations ont des frais de scolarité totaux supérieurs à 35 000 euros [pour l’ensemble du cursus en trois ans]. Les écoles se sont lancées dans une course à l’accréditation, elles ont cherché à se constituer des corps professoraux prestigieux et très bien rémunérés qui publient dans des revues scientifiques, ce qui leur permet de briller dans les classements internationaux et donc d’être attractives. Certaines écoles octroient des primes – supérieures à 10 000 euros selon un rapport de la Cour des comptes de 2013 – à ceux qui parviennent à publier dans les revues de gestion les mieux classées. On touche là aux limites du modèle de développement de ces établissements privés, qui sont sur la corde raide. D’un côté, les accréditations privées et la reconnaissance publique de leur diplôme comme « grade master » sont des conditions nécessaires pour remplir leurs salles de cours – comme le montrent a contrario les cas récents de chutes drastiques d’effectifs dans les écoles s’étant vues retirer ce grade master –, de l’autre, cette mécanique contribue à faire exploser les frais de scolarité, qui deviennent une véritable barrière à l’entrée, franchissable, mais non sans peine, pour les étudiants aux petits moyens financiers.
Une fois que ces étudiants sont entrés dans ces écoles de commerce, la question de l’argent et de l’emprunt est-elle un facteur discriminant ?
Evoquer ses difficultés financières ne constitue pas un sujet légitime de discussion pour les étudiants boursiers ou d’origine modeste, et n’est avouable qu’auprès de ceux qui connaissent une situation similaire. Une étudiante, fille d’ouvrier, me disait : « Tu vois tout de suite sur ton répertoire [téléphonique] les gens auxquels tu peux parler de ça, c’est vachement réduit. » Pour expliquer cette illégitimité à évoquer ces problèmes, une autre étudiante me disait : « C’est plus logique quand on est en école de commerce d’être un “fils de” et, du coup, de ne pas avoir à payer. » Ces étudiants que j’ai interviewés ont conscience de leur position de porte-à-faux social au sein de ces groupes majoritairement issus des classes supérieures.
J’ai observé aussi une sorte d’ascétisme dans leur gestion financière. Pour certains, cela passe par le fait de ne pas participer par exemple aux soirées du BDE (bureau des élèves), au gala de l’école, au week-end au ski. Ils ont un rapport soucieux à l’argent qui tranche avec le rapport d’insouciance voire d’ostentation de beaucoup de leurs camarades. L’un de mes interviewés évoquait les week-ends d’intégration à 300 euros, qui prévoient toute une série d’activités coûteuses, et où il s’agit de mettre en scène l’argent dépensé.
Les écoles ne prennent pas suffisamment en compte les problèmes financiers des élèves. Rares sont les établissements accordant des exonérations (le plus souvent partielles) de frais de scolarité pour les boursiers – alors que c’est la norme dans les universités. Au quotidien, l’absence d’assistante sociale, le manque de renseignements sur le montant précis des frais d’inscription viennent rappeler à ces étudiants d’origines populaires qu’ils sont entrés dans un autre univers social.
Votre travail porte aussi sur la difficulté des étudiants boursiers à se fondre dans le moule des écoles…
Ce qui est sûr, c’est que cela nécessite un travail d’adaptation. Il s’agit premièrement de faire le deuil de ce qui a constitué le support de leur trajectoire d’ascension sociale jusqu’alors, à savoir leur attachement au sérieux scolaire. Ces bons élèves qui se sont laissés porter par le courant scolaire doivent désormais comprendre que les logiques sont de plus en plus professionnelles, relationnelles, et de moins en moins scolaires.
Les choix de stage, le type de séjour à l’étranger, les certifications (TOEIC, GMAT, etc.) comptent désormais davantage que les résultats académiques. Il ne suffit plus d’être un bon élève pour réussir en école de commerce. C’est un choc pour ces jeunes qui ont foi dans le mérite scolaire, qui leur a profité jusqu’ici. Une des étudiantes que j’ai rencontrée, fille d’ouvrier immigré marocain, m’expliquait que ses relevés de notes en école continuaient d’être examinés en famille. A cet égard, le choix de la finance comme filière de spécialisation constitue pour ces étudiants, loin de l’image du jeune loup de Wall Street, une niche pour réinvestir le sérieux scolaire. En effet, par son contenu mathématique, la finance leur apparaît plus solide que, par exemple, le marketing.
Comment l’engagement financier auprès d’une banque influe sur l’orientation des jeunes boursiers ?
On constate une forme de rationalisation des aspirations professionnelles. Certains m’ont confié se sentir pris au piège du remboursement de leur prêt, et se sont orientés dans des secteurs rémunérateurs, comme la banque et la finance et plutôt que dans des secteurs plus risqués. Parfois à contrecœur. D’autres ont eu envie d’arrêter leur scolarité en ESC et changer complètement de voie pour se libérer des mensualités. Un étudiant m’avait dit qu’il regrettait de passer des entretiens d’embauche dans des banques, pour des emplois qu’il aurait « haïs dans d’autres circonstances ». Lors de l’une de nos rencontres, il revenait d’un entretien d’embauche et, enlevant sa veste de costume qu’il avait gardée sur lui jusqu’ici, il me montra avec fierté que sa chemise était amplement déchirée au niveau des coudes. Une manière pour lui d’adresser un pied de nez dissimulé à ses potentiels employeurs, malgré l’épée de Damoclès du prêt à rembourser. A contrario, celles et ceux n’ayant pas contracté de prêt disposent de marges de manœuvre plus amples. Si le prêt étudiant permet de régler une fois pour toutes la question des frais de scolarité, il constitue une vraie contrainte à la sortie.