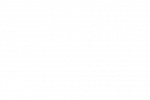Femmes de chambre : « Nous ne travaillons pas pour être esclaves »

Femmes de chambre : « Nous ne travaillons pas pour être esclaves »
Par Victoire Chevreul
Les employées de l’hôtel Ibis des Batignolles, à Paris, ont déposé un préavis de grève illimitée. Elles dénoncent leurs conditions de travail.
Le hall de l’Hôtel Ibis Batignolles, a des airs de salle des fêtes ce mardi 23 juillet, une trentaine de femmes de chambre danse sur de la musique africaine, elles ont revêtu leurs boubous les plus élégants. Mais sous la liesse apparente, c’est un combat salarial qui s’est installé depuis mercredi 17 juillet « pour une durée illimitée », lâche le directeur de l’établissement, propriété du groupe Accor, Emmanuel Estrem.
A l’appel de la CGT, vingt-huit femmes de chambre de cet hôtel – le plus grand de France avec ses 700 chambres – ont posé leur préavis de grève pour dénoncer la sous-traitance de la société STN qui les « exploite en les poussant à faire jusqu’à 50 chambres par jour pour un salaire misérable », dénonce au mégaphone leur collègue équipier Aboubakar Traoré. Leurs revendications : que STN ralentisse la cadence pour passer à deux chambres par heure contre plus de trois en temps normal et surtout « que la sous-traitance s’arrête ».
Le slogan CGT du jour, « Du vol des salarié.e.s au viol d’une femme de chambre », interpelle les syndiqués. Ils se battent aussi contre la maltraitance au travail. « Nous ne venons pas travailler pour être esclaves et nous faire violer ! », renchérit dans le porte-voix Rachel, elle aussi en grève, avant de raconter le drame vécu par une de ses collègues deux ans plus tôt. En mars 2017, Beby une des femmes de chambre de l’hôtel, travaillant en sous-traitance pour STN, a été agressée sexuellement par l’ancien directeur de cet établissement Ibis, alors qu’elle préparait une chambre. L’affaire est en cours d’instruction, l’homme a été mis en examen.
Harcèlement moral
« Ça suffit ! », « Plus jamais ! », lancent les grévistes indignés. « Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas eu de suivi de la victime de la part de l’hôtel après », réagit Aboubakar Traoré. Le drame dont a été victime Beby, ses collègues ne l’ont pas vécu, mais certains d’entre eux dénoncent des faits de harcèlement de la part de l’entreprise de sous-traitance. En particulier Aboubakar Traoré, que l’on a essayé de « licencier à trois reprises », depuis qu’il se mobilise pour revendiquer ses droits. « J’ai eu pleins de courriers », souffle-t-il. « Quand ce n’était pas pour une mutation non désirée, c’était pour m’accuser de mal faire mon boulot », explique l’homme qui est équipier depuis sept ans. Pour lui, il s’agit de harcèlement moral. « Parfois STN vous prête de l’argent puis le déduit d’une prochaine paie en prenant 20 % d’intérêt », dénonce-t-il.
Sur des banquettes au milieu des confettis qui jonchent le sol, un groupe de cinq femmes de chambre abordent leurs conditions de travail. « Moi je dois faire jusqu’à cinquante chambres en sept heures et demie ! », se révolte Blanche-Parfaite, sous-traitée par STN depuis dix ans au groupe Accor. En moyenne, la trentenaire est payée entre 800 et 900 euros brut par mois. « Parfois on pleure, tellement nous sommes fatiguées ou à cause du mal de dos », murmure-t-elle en regardant sa collègue Maryam.
Cette dernière s’apprête à accoucher de son troisième enfant. Dans son état, STN lui permet de « faire 21 chambres par jour contre 35 à 40 en temps normal ». Un groupe de grévistes avance à côté criant à tue-tête « Ibis complice ! » Une autre femme de chambre, Aminata trouve déjà que 21 chambres c’est trop, « quand on ne m’en fait pas faire 30 ou 40 » en quatre heures de travail.
Courriers d’avertissement
Outre, les conséquences physiques et les répercussions familiales – « on est tellement fatiguées que lorsqu’on rentre chez nous on n’a plus d’énergie pour rien » –, la sous-traitance précarise ces femmes. « Il m’est arrivé de ne pas être payée même quand je le réclamais à la société », se révolte Aminata. Elle dénonce aussi « la pression et l’infantilisation » de la société STN, du fait de leurs courriers intempestifs qui sous forme d’avertissements lui « rappellent de ne pas mâcher de chewing-gum ou de ne plus oublier sa blouse ».
Malgré la chaleur extérieure, le cortège de grévistes sort en dansant dans la cour de l’hôtel, sous le regard médusé des clients. Ils sont déterminés à poursuivre leur mouvement social : « Notre combat on va le gagner contre les violeurs, les harceleurs, contre le système mafieux de sous-traitance », s’exclame Aboubakar Traoré. Au milieu des drapeaux rouges de la CGT, la sénatrice communiste Laurence Cohen (Val-de-Marne) est venue apporter son soutien. L’élue communiste l’assure : « Ce conflit doit être entendu jusque dans l’Hémicycle, je ferai une question écrite à la ministre du travail, Muriel Pénicaud. Et on va secouer Marlène Schiappa ! »
Dans une interview le 23 juin au Parisien, la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes s’est engagée à améliorer les conditions de travail des femmes de chambre. Elle a annoncé qu’elle confierait en septembre une mission au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle qui devra lui faire des propositions avant la fin de l’année.
Un directeur d’hôtel accusé d’agression sexuelle par une employée
Recluse dans son appartement parisien, Beby n’a pas souhaité participer à la grève des femmes de chambre à l’hôtel Ibis des Batignolles, où elle travaillait il y a encore quelques années. Elle refuse que son histoire personnelle illustre une cause syndicale. La femme de chambre, en « arrêt pour accident de travail », sursaute au moindre bruit, elle souffre d’un lourd stress post-traumatique. Sous antidépresseurs depuis près de deux ans, elle se réveille chaque nuit.
Pendant plus de quinze ans, Beby a été femme de chambre et travaillait en sous-traitance pour la société STN dans cet hôtel du 17e arrondissement de Paris. Mais son quotidien de mère de famille a basculé en mars 2017, lorsqu’elle a été agressée sexuellement alors qu’elle faisait le ménage dans une chambre.
La vidéosurveillance de l’hôtel montre « le directeur rôder dans le couloir et rentrer dans la chambre », puis en ressortir, indique son avocate, Me Durrieu Diebolt. Après les faits, elle sort en hurlant de la chambre mais ne pense qu’à une chose : « Rentrer chez elle pour s’occuper de son fils. » Ses collègues appellent immédiatement la police qui la conduit à l’Hôtel-Dieu où les médecins constatent les blessures, « hématomes, déchirure vaginale et traces de contrainte ». Beby porte plainte dans la foulée.
Le directeur de l’hôtel a été licencié. Mis en examen pour agression sexuelle, il nie les faits. « Il a dit qu’elle l’avait attaqué », s’insurge Me Durrieu-Diebolt. L’homme présentait des traces de griffures qui correspondaient davantage « à des traces de défense ». « Mon client proclame son innocence face aux faits dont on l’accuse et espère un non-lieu », précise Me Doumic, qui le représente. L’affaire n’est pas sans rappeler celle qui avait secoué le Sofitel de New York en 2011. Elle embarrasse le groupe Accor, qui assure être « très réactif dans ce type d’affaire »