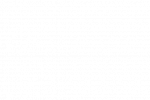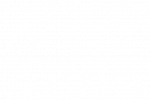Collèges : « Comparer l’enseignement public et le privé du point de vue de la mixité est illusoire »

Collèges : « Comparer l’enseignement public et le privé du point de vue de la mixité est illusoire »
Propos recueillis par Mattea Battaglia
Des expérimentations seront lancées à la rentrée pour casser les ghettos scolaires. Entretien avec le sociologue Choukri Ben Ayed.
Peut-on accroître la mixité dans les collèges par une « démarche » plutôt que par une « réforme » ? C’est le pari pris au ministère de l’éducation nationale. « Je ne vais pas engager une énième refonte de la carte scolaire, avait déclaré Najat Vallaud-Belkacem à l’automne 2015. Finissons-en avec les postures idéologiques. L’idée est plutôt d’impulser une dynamique, de mobiliser les territoires pour les amener à trouver des solutions concrètes. »
A moins de trois mois de la rentrée des classes, quelque 25 territoires volontaires – dans 21 départements et 16 académies – se sont engagés dans des « expérimentations ». Pour les y aider, appuyer les acteurs locaux et diffuser les « bonnes pratiques », le gouvernement a appelé à la rescousse une douzaine de chercheurs. Parmi eux, Choukri Ben Ayed, professeur de sociologie à l’université de Limoges, auteur, entre autres, de La mixité sociale à l’école. Tensions, enjeux, perspectives (Armand Colin, 2015). Il livre ici ses premières impressions sur la mise en œuvre de ces chantiers.
Les initiatives pour améliorer la mixité dans les collèges démarrent à peine dans une vingtaine de territoires volontaires, à un an de la présidentielle. Vont-elles selon vous dans le bon sens ?
Choukri Ben Ayed : Ces expérimentations sont menées avec beaucoup de bonne volonté. Il y a encore quelques années, peu d’acteurs étaient sensibles à cet enjeu. Cependant ce type d’objet s’inscrit dans la durée. Plus de trois ans se sont écoulés entre l’élection présidentielle et le début de l’expérimentation. Un démarrage plus tôt aurait gagné en efficacité afin de tester ce qui sera mis en œuvre sur plus d’une rentrée.
A quel rythme le chantier avance-t-il ?
Le pluriel est de rigueur : on a affaire à des problématiques hétérogènes, avec des disparités très marquées entre les territoires d’expérimentation. Certains – Clermont-Ferrand, Nancy Metz, Nantes – sont plutôt en avance. D’autres commencent à travailler. Le volontarisme politique peut certainement stimuler les initiatives locales, donner du souffle à des dynamiques préexistantes, mais je doute qu’on puisse aller au-delà sans un cadre légal plus appuyé à l’avenir. Tout ne peut pas être réglé au niveau local. Dans un cadre expérimental cela se comprend, mais s’il s’agit de généraliser, ce problème va inéluctablement se poser.
Il n’est pourtant pas question de « cadrage » mais d’« accompagnement » dans la logique défendue par le ministère de l’éducation…
Peu importent les mots. Il y a un peu les deux à la fois. Reste que transposer ce mode d’action à tous les territoires va nécessairement rencontrer des limites, notamment dans les territoires rétifs à l’idée de mixité sociale. Il y en a encore…
Quelles sont les principales difficultés ?
Le centre de gravité de l’action en matière de mixité sociale repose sur les épaules des départements. Une assemblée élue… alors que le sujet de la mixité sociale est très clivant politiquement. Comment, à terme, les départements pourront-ils tenir face à leur électorat rétif ? J’avais alerté sur ce risque il y a longtemps. A terme, je pense que le cadre législatif actuel devra être profondément repensé en ce qui concerne la répartition des compétences. On ne peut pas ériger la mixité sociale comme un enjeu national et renvoyer son traitement quasi exclusivement à l’échelle locale.
Autre écueil : les modalités de la participation de l’enseignement privé aux expérimentations…
Ecueil oui et non. L’enseignement privé, c’est vrai, n’est pas soumis à la sectorisation et contribue à alimenter fortement l’évitement scolaire. Le ministère a fait le pari du dialogue plutôt que de la marginalisation. Il est trop tôt pour tirer les enseignements de cette stratégie. A titre personnel, il me semble que si le privé doit être associé à l’avenir à une politique globale de la mixité sociale, cela ne pourra se faire sans une modification de son cadre légal.
Une enquête que vient de publier l’Edhec Business School, sous la plume de l’enseignant-chercheur Pierre Courtioux, entend démontrer que « le privé fait plutôt mieux que le public » à partir de calculs statistiques centrés sur des établissements définis comme socialement mixtes. Refaire le « match » public-privé a-t-il un sens ?
C’est une équation simpliste. On a affaire à deux systèmes qui n’ont pas du tout le même fonctionnement : l’un, public, accueille tous les élèves avec une sectorisation (un quartier d’habitation, un collège) ; l’autre, privé, n’est pas soumis aux mêmes contraintes puisqu’il peut sélectionner son public. On peut les dire concurrents, mais les comparer du point de vue de la mixité est illusoire. D’autant qu’entre la 6e et la 3e, nul n’ignore les « effets de déperdition » – la logique d’écrémage – à l’œuvre dans le privé.
Il existe un consensus scientifique autour de l’augmentation de la ségrégation scolaire ces dernières années, alimentée notamment par le secteur privé qui, avec l’assouplissement de la carte scolaire [2007], accueille des élèves n’ayant pas obtenu satisfaction dans le public. Il n’empêche qu’il me semble pertinent d’interroger notre perception du privé.
Peut-on répondre à ce type de questionnement en opposant, à l’échelle nationale, public et privé ?
Raisonner par agrégation de moyennes, avec d’un côté tous les établissements publics, de l’autre tous les établissements privés, n’a aucun sens. C’est faire comme si l’on pensait encore que le secteur public est entièrement populaire et le privé entièrement bourgeois. La ségrégation est, étymologiquement et historiquement, une variable spatiale. Elle s’étudie à des échelles fines, ville par ville, quartier par quartier.