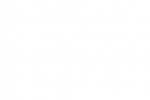Recherche : un système décourageant

Recherche : un système décourageant
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO
Tribune. Alors que la recherche vient d’échapper in extremis à certaines coupes budgétaires, le physico-chimiste Guillaume Miquelard-Garnier évoque la démotivation engendrée par les difficultés de financement des travaux.
Le budget de la recherche et de l’enseignement supérieur a, une fois n’est pas coutume, fait parler de lui ces derniers jours dans les médias : coupe annoncée de 256 millions d’euros, suivie de rétropédalages successifs – le dernier en date concernant l’annulation par François Hollande de la ponction de 134 millions d’euros sur les crédits des organismes de recherche, sans que l’on sache très bien ce qu’il advient des 122 millions restants, notamment la part concernant les universités. Quoi qu’il en soit, la situation reste pour le moins morose dans les laboratoires.
D’un point de vue personnel, mon recours concernant la non-sélection en deuxième phase du projet que je portais vient d’être rejeté par l’Agence nationale de la recherche. Les évaluations de mon projet, dont les notes s’étalaient entre 23/45 et 45/45, n’ont pourtant, d’après la commission de recours de l’instance, révélé aucun dysfonctionnement.
Depuis le début de l’année scolaire, j’ai déposé pour évaluation deux projets en tant que porteur, un autre en tant que partenaire, et deux demandes de financement de thèses à divers organismes financeurs. Toutes ces demandes ont pour l’instant échoué pour des raisons variées. C’était déjà le cas l’an dernier. L’espoir pour celles encore en cours d’évaluation est minimal.
Plus de fonds propres
Je ne pense pourtant pas être parmi les plus à plaindre des jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs en France. Pour commencer, en ces temps de précarité accrue dans l’enseignement supérieur comme ailleurs, je suis titulaire d’un poste permanent. Je travaille dans une unité mixte de recherche, plutôt bien évaluée. L’environnement, parisien et francilien, est stimulant : même avec des moyens limités, il est possible de collaborer avec nombre de gens brillants situés dans un périmètre restreint. J’enseigne dans un cadre relativement privilégié où je suis plutôt épargné par les heures supplémentaires, ce qui me laisse du temps pour la recherche. Mon domaine de recherche, assez appliqué, intéresse les industriels, qui peuvent parfois financer directement certaines de nos études.
Depuis six ans que je suis enseignant-chercheur, parce que c’est désormais la seule solution pour travailler (les crédits récurrents alloués au laboratoire n’étant aujourd’hui plus suffisants pour permettre une redistribution vers les chercheurs), je dépose, comme la majorité de mes collègues, entre 2 et 5 demandes de financement par an (pour financer les salaires d’un doctorant ou d’un postdoctorant, pour l’achat de matériel courant ou d’équipement, ou pour tout à la fois). J’ai eu la chance d’avoir un projet financé par l’Agence nationale de la recherche lors de ma première année en poste (à une époque où le taux de succès était de 20 % et non de 10 %, comme aujourd’hui) : cela m’a permis de payer un postdoctorant pendant deux ans et également de disposer d’environ 60 000 euros pour faire fonctionner nos activités pendant quatre ans. J’ai obtenu un contrat doctoral pour financer un doctorant (environ 90 000 euros sur trois ans en salaires) il y a deux ans, ainsi qu’une bourse permettant l’échange d’un autre doctorant entre un laboratoire américain et le nôtre, via l’établissement d’une cotutelle.
Globalement, le travail en équipe permet également de mutualiser un certain nombre de ressources et d’équipements, et donc de continuer à pouvoir travailler. Des formations directes pour des industriels, mises en place via le Conservatoire national des arts et métiers, nous rapportent aussi de quoi financer ou entretenir certains équipements servant tant à la formation qu’à la recherche.
Grâce à mon environnement de travail, à mes collègues et collaborateurs, mais aussi grâce à ces financements, je suis à même de faire mon travail de recherche. Bon an, mal an, je publie deux à trois articles par an, dans des revues bien considérées de mon domaine d’expertise. Ces articles, pour ce que je peux voir, sont, sans impliquer de bouleversements majeurs dans la science des matériaux (je l’admets volontiers), correctement perçus par mes pairs, lus et cités par la communauté.
Je m’implique dans la formation initiale mais aussi continue, dans l’administration de l’enseignement et de la recherche, dans la communication au grand public, j’aide à l’évaluation du travail de mes collègues ou d’industriels par des activités d’expertise ou d’édition scientifique. Bref, je pense, si ce n’est brillamment, faire au moins honorablement mon travail.
Mais l’an prochain, selon toute probabilité, je ne disposerai plus de « fonds propres » : je ne pourrai pas recruter (même pas payer la gratification d’un stagiaire de master), mais je serai également redevable de l’aide de collègues, directe ou indirecte, pour pouvoir financer l’accompagnement de la dernière année de thèse du doctorant que j’encadre. Cela nous ramène à une tribune que j’ai écrite il y a deux ans déjà… « Qui fait la recherche publique en France ? »
On m’explique qu’il faut déposer des projets au niveau de l’Europe (ERC, H2020…) : à quoi bon, quand ses idées et son CV sont déjà jugés trop moyens en France pour être régulièrement soutenus, se tourner vers un système encore plus compétitif où il faut par ailleurs souvent demander l’aide (payante) d’agences pour rédiger les projets et travailler le lobbying (alors qu’on n’a déjà pas d’argent) ?
Je vois autour de moi beaucoup de découragement, et je vois aussi nombre de collègues plus âgés qui finissent par délaisser la recherche pour se consacrer à d’autres tâches (administration, enseignement, vulgarisation…), quand ils ne quittent pas ce métier définitivement. Il y a aujourd’hui largement de quoi s’occuper à l’université sans pratiquer la recherche, entre la mise en place des communautés d’universités et établissements (Comue) et autres réorganisations permanentes, la multiplication des couches administratives, les besoins en enseignement, etc. Et soyons même cyniques : beaucoup de ces activités peuvent rapporter des petits (ou moins petits) compléments de salaire.
Un système à trois vitesses ?
Alors, comment ne pas comprendre ces collègues ? Et comment puis-je savoir combien de temps je vais moi-même tenir avant de suivre leurs pas, malgré tout l’amour que j’ai pour ce métier, ou plutôt l’idée un peu romantique que je m’en faisais ?
Plutôt que de blâmer ces collègues, qui n’ont pas la chance d’avoir été jugés « excellents », de faire un choix qui apparaît de plus en plus raisonnable, il faudrait sans doute s’interroger sur ce système si décourageant. Ce n’est hélas certainement pas ce gouvernement qui s’y penchera.
On peut lire dans leur document d’orientation que Les Républicains proposent de scinder l’enseignement supérieur et la recherche en France en trois blocs : l’un constitué de cinq à dix centres de « rayonnement mondial », l’autre des universités de proximité, et le dernier des établissements dédiés à l’enseignement supérieur de courte durée (bac + 2 ou + 3, sur le modèle des colleges américains).
J’ai tendance à ne pas pleinement adhérer a priori à cette vision qui consiste à croire que l’on peut séparer le bon grain de l’excellence de l’ivraie du tout-venant, mais elle a au moins le mérite d’être explicitée et assumée (et elle existe dans d’autres pays du globe). Aujourd’hui, on ne peut s’empêcher de penser que c’est néanmoins vers cela que l’on se dirige, tout en s’en défendant pourtant. Pour paraphraser Goethe, la négligence est souvent cause de plus de souffrances que la malveillance.
Guillaume Miquelard-Garnier, maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers