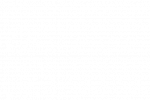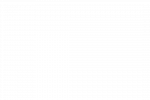Malek Boukerchi : « Dans le désert, le temps n’existe plus, il faut simplement survivre »

Malek Boukerchi : « Dans le désert, le temps n’existe plus, il faut simplement survivre »
Par Anne-Sophie Novel
A une époque de profondes mutations, le rapport au temps est chamboulé. Nous avons invité des personnalités et des anonymes à se confier sur ce vaste sujet. Cette semaine, l’ultramarathonien Malek Boukerchi.
La passion de ce grand sportif : traverser le désert en courant. | Antoine Seiter pour M Le magazine du monde
S’il se définit comme un guetteur de rêves, Malek Boukerchi est surtout connu pour ses exploits d’ultramarathonien. D’origine kabyle, ce sportif longiligne, également passionné de contes, travaille comme expert en intelligence relationnelle entre Paris et La Réunion.
L’ultramarathon, c’est un entraînement permanent et une volonté de fer. Qu’est-ce qui vous pousse à fournir de tels efforts ?
J’ai commencé à courir à l’âge de 28 ans. A l’époque je n’avais jamais chaussé de baskets, sauf sur le terrain de foot, et on venait de me dire que j’étais trop vieux pour continuer ma carrière : j’étais un vétéran ! A 28 ans ? Un vétéran ? C’est dire la notion du temps dans ce milieu !
Alors j’ai commencé par courir, j’ai fait du 10 kilomètres au départ. Je n’y allais pas dans une approche de performance, mais pour être dans la rencontre humaine. C’est à la fin d’une course qu’on me suggère de faire un marathon, on me promet d’y rencontrer des gens extraordinaires. J’y vais comme un footeux, avec une simple règle de base : finir c’est réussir, sans aucune contrainte de temps. Je n’ai d’autre objectif que de dépasser la ligne d’arrivée car pour moi le courage c’est non seulement de commencer, mais surtout de terminer. Et le vrai courage, de recommencer. Or je finis mon premier marathon en 3 h 30, et à l’arrivée je saute, je rigole, j’encourage ceux qui arrivent… Un monsieur s’approche de moi et me dit alors d’arrêter : « Ne faites pas ça, à l’arrivée ils n’en peuvent plus, si vous n’êtes pas fatigué, c’est que vous n’avez pas donné le meilleur de vous-même ! »
Cela marque le début de mon entrée dans la performance : je vais de plus en plus vite, je dépasse mes chronos, et c’est en 2002, à la fin d’un marathon à Amsterdam, qu’un coureur me parle d’ultramarathon, des courses qui vont de 300 à 1 500 kilomètres et qui vous plongent dans d’autres profondeurs.
Moi qui ne suis pas scientifique ni glaciologue, mais passionné par les déserts, je réalise rapidement que ce type de course peut m’aider à réaliser mon rêve d’enfant : parcourir les déserts, ces maisons aux parois de néant. C’est un bonheur ineffable d’y courir, éloigné de la férocité, du chaos social. Dans le désert, le temps n’existe plus, tout est suspendu, il faut simplement survivre, on est dans l’essentiel, dans les fonctions primaires de l’être humain : courir, dormir, manger… la vie dans toute son intensité première. On se reconnecte avec la terre, avec le monde. En somme l’ultramarathon me permet de sortir de la course folle de la société, je reprends possession du temps, de mon être, de l’essentiel. Ici la performance n’est pas de faire un temps, mais de traverser le désert.
Comment gérer l’exigence des entraînements avec la vie familiale et professionnelle ?
Je ne suis pas un professionnel de l’ultramarathon, si bien que j’intègre ce temps au reste de mon agenda. Plus globalement, je pense que la problématique du temps, et de sa gestion, pose la question de la décision : comme le veut l’aphorisme berbère, « les gens dorment bien à l’auberge de la décision ».
J’ai aussi vécu une expérience au début de ma carrière, quand je travaillais dans une grosse entreprise en Allemagne. J’adorais mon travail et je partais souvent tard, entre 19 heures et 21 heures. Or un jour, je reçois un blâme : on me reproche d’empêcher la femme de ménage de nettoyer mon bureau, si bien que son supérieur, croyant qu’elle faisait mal son travail, l’a sanctionnée… Sanction qui me retombe dessus : le directeur de la médiation sociale, avec qui je m’entendais bien, m’explique alors qu’il ne faut pas oublier qu’il y a une vie essentielle après le travail, qu’il faut sortir du « mythe du challenge de la dernière lampe » pour cerner les enjeux prioritaires, s’organiser, faire des choix, etc. Depuis, j’ai appris à marcher avec le temps et à ne jamais courir avec. Quand on marche avec le temps, on se le réapproprie.
Si bien qu’au quotidien, je respecte surtout les incompressibles : récupérer ma fille et passer la fin d’après-midi avec elle, jusqu’au dîner. Puis la pause déjeuner – durant laquelle je ne mange pas, je cours. Cela me permet d’évacuer mes soucis, de faire le vide ou de trouver des réponses. Mais surtout d’ouvrir une autre temporalité dans la journée : quand je suis sur les sentiers, les pieds dansent et la tête pense ! Si je ne peux pas courir à l’heure du déjeuner, je cours de minuit à deux heures, une fois que tout le monde dort… Courir de nuit est fabuleux, je découvre la ville de manière différente. Puis comme je ne dors que quatre heures par nuit, cela me permet d’être assez libre de le faire !
Quatre heures par nuit… c’est peu ! Cela suffit-il pour récupérer de tous ces efforts ?
Je connais mon rythme circadien et je sais me lever au bon moment de mon cycle. On devrait d’ailleurs créer des écoles de sommeil, pour apprendre à le maîtriser… Lorsque l’on dort, on reçoit de faibles signaux que l’on ne sait pas capter, tant on est bien sous la couette. Mais si on y prête attention, ce langage du corps est précieux. Pour récupérer son temps, il faut connaître son sommeil. Comme il est nécessaire pour bien préparer une course d’arriver reposé, à son pic de forme. D’ailleurs, les ultramarathoniens ont une technique pour durer : ils courent en arrière. C’est symboliquement important. Beaucoup m’arrêtent pour me dire que je me trompe de sens, or on est tous dans une course vers l’avant ! Courir en arrière permet de se tenir droit, de rééquilibrer ses muscles. Pratiquée à deux, cette course permet aussi de tester sa confiance…
Et les contes, votre autre passion, que disent-ils du temps ?
Comme le veut l’adage touareg, « les peuples qui n’ont pas d’histoires n’ont jamais vécu ». Le conte est à l’humanité ce que le parfum est à la fleur. Il faut se laisser transporter par la mélodie des mots et des sons. Quand on le raconte, le temps n’existe plus ! Alors dès que j’ai un doute, un souci, une question, je vais puiser dans la force narrative des contes. En tout, je dois passer deux jours par mois à relire les 1 500 contes que je connais.
Je tiens cette passion des contes de ma mère, qui nous racontait nombre d’histoires berbères quand nous étions petits. Je ne pensais pas conter un jour car cela est très intime, mais je suis devenu un explorateur invétéré des contes du monde entier. Quand ma mère est partie, retourner dans les histoires qu’elle nous racontait fut un moyen de me reconnecter avec elle. Puis j’ai exploré plus largement le spectre : les contes s’appuient sur la vie, ils s’adressent aux grands enfants que nous sommes. Intemporels, ils sont dans l’arborescence du temps sans contenir ni présent ni passé.