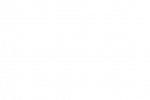Alep, le drame et l’impasse

Alep, le drame et l’impasse
Editorial. Depuis cinq ans, les Occidentaux sont incapables de trouver une solution pacifique à un conflit qui a déjà fait près de 300 000 morts et jeté des millions de personnes sur les routes de l’exil. La bataille d’Alep est le symbole de cette impuissance
Omran, 4 ans, victime d’un bombardement à Alep, le 17 août, et dont l’image a fait le tour des médias internationaux. | MAHMOUD RSLAN / AFP
Editorial La bataille d’Alep est devenue l’épicentre de la tragédie syrienne. Mais son enjeu va bien au-delà de la Syrie elle-même et du Moyen-Orient en général. Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a évoqué à raison « une catastrophe humanitaire sans précédent ». Près de 300 000 civils survivent assiégés et pilonnés en zone rebelle, comme l’ont montré de nouveau les images d’un jeune garçon victime des bombardements – images qui ont choqué le monde entier.
Mais ce qui se joue dans les ruines de cette ville, la deuxième du pays, concerne l’Europe au premier chef. Si les forces d’Assad, avec leurs alliés russes et iraniens, parviennent à achever l’encerclement des quartiers orientaux de la vieille cité, contrôlés depuis juillet 2012 par la rébellion, a fortiori si elles réussissent à les reconquérir, ce sont des centaines de milliers de personnes qui fuiront vers la Turquie voisine. Elles s’entasseront à la frontière dans des camps de fortune, avant qu’Ankara, peut-être, les laisse entrer et grossir les rangs des quelque 3 millions de Syriens qu’elle héberge déjà.
Enlisement du conflit
Or, depuis l’accord conclu avec les Européens au printemps, la Turquie est la gardienne des marches orientales de l’Union européenne face aux flux de réfugiés. En échange, l’UE a promis une relance du processus d’adhésion et la levée du régime des visas pour les citoyens turcs. Mais, depuis le coup d’Etat manqué du 15 juillet et la réaction autoritaire du président turc, ce compromis bancal est menacé. Les réfugiés d’Alep pourraient fort bien, demain, se presser aux portes de l’Europe.
Mais, surtout, Alep met de nouveau à l’épreuve le peu de crédibilité qui reste aux Occidentaux dans un conflit qui a fait, au bas mot, 290 000 morts et quelque 7 millions de réfugiés. Après avoir lui-même fixé comme « ligne rouge » pour une intervention l’emploi de l’arme chimique par le régime de Damas contre sa propre population, Barack Obama a finalement renoncé, à l’été 2013, aux frappes annoncées. Les Russes ont pu, alors, sauver la mise d’Assad. Et ils ont franchi une nouvelle étape, en septembre 2015, avec une intervention aérienne, mais aussi avec des hommes au sol, destinés à éviter la déroute militaire du régime bien plus qu’à combattre effectivement l’organisation Etat islamique.
Depuis cinq ans, l’impuissance et l’inaction occidentales, à commencer par celles de Washington, n’ont pas seulement conduit à l’enlisement du conflit. Elles ont contribué au renforcement des groupes les plus radicaux au sein de la rébellion, ceux-là mêmes qui sont au premier rang de la résistance à Alep.
Il n’existe pas de solution militaire à cette guerre. La bataille d’Alep, avec son bilan toujours plus lourd de pertes civiles, le rappelle tous les jours. Malgré l’aide des bombes russes, le régime n’est pas capable de tenir les zones reconquises, tandis que la rébellion n’arrive pas à briser durablement le siège. La solution ne peut être que négociée. Washington et Moscou sont les coparrains du processus de Vienne, lancé en novembre 2015 sous l’égide de l’ONU pour tenter de jeter les bases d’une transition politique. Les négociations ont buté sur le sort d’Assad.
Sans un cessez-le-feu à Alep, elles n’ont aucune chance de reprendre. Mais comment l’imposer ? Face à un Poutine toujours plus déterminé à pousser ses pions, l’administration américaine en fin de mandat a levé le pied. Et les Européens ne peuvent pas grand-chose, même s’ils sont, après les pays de la région, les premiers concernés par les conséquences de cet interminable carnage.