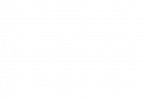Serge Hureau : « La chanson française est un patrimoine à faire vivre et à transmettre »

Serge Hureau : « La chanson française est un patrimoine à faire vivre et à transmettre »
Propos recueillis par Sylvain Siclier
Selon Serge Hureau, directeur du Hall de la chanson, à Paris, un titre devient œuvre quand il peut être transmis par différents interprètes.
Après des études de philosophie et de sciences de l’éducation à l’université Paris-VIII de Vincennes, Serge Hureau a fait ses débuts d’artiste au sein d’une troupe italienne puis est passé par le Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine. Chanteur, metteur en scène, acteur et créateur de spectacles (son premier, Les Habits du dimanche, en 1983), il a fondé et dirige depuis 1990 le Hall de la chanson, Centre national du patrimoine de la chanson, soutenu par l’Etat et la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem).
A la fois structure de production de spectacles et de contenus multimédias, lieu de conférences, de formation, de transmission et de médiation, le Hall de la chanson est installé depuis 2013 au Pavillon du Charolais, dans le Parc de La Villette, à Paris. Serge Hureau enseigne également l’interprétation de chanson au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris depuis 2009.
Est-ce que l’on peut définir ce qu’est une chanson ?
De toutes les disciplines artistiques, je pense que c’est celle qui est d’abord la plus rassembleuse, la plus populaire. Un objet, constitué d’une mélodie, d’un texte et d’une (ou plusieurs) voix, qui même quand il est écrit reste lié à l’oralité et peut se transmettre facilement. Jean Cocteau, qui avait un grand intérêt pour la musique et la chanson, la voyait comme une peinture qu’on emportait dans sa poche. Pour ma part, j’aime l’idée que cela s’apparente à un théâtre en réduction. Le rideau se lève, il y a une histoire en quelques actes, les couplets, et il se ferme à la fin. L’alliance du sens et du son qui permet, en l’espace de quelques minutes, de parler des choses les plus insignifiantes comme les plus horribles. Certaines sont un reflet d’un éphémère petit moment, d’autres traversent les siècles.
Justement, est-il possible d’établir une chronologie ?
On peut remonter très loin dans l’histoire avec les chansons, mais c’est, en gros, à partir du Moyen Age, vers le Xe siècle, que l’on commence à avoir des traces de ce que chantaient les troubadours : les exploits des chevaliers, l’amour courtois. Les chansons de fête de village se transmettent oralement, les berceuses aussi, les chants des métiers, des paysans, les chants religieux sur des airs de chanson… Avec des variations selon les régions, les langues de France, les époques. Elles nous disent comment le pouvoir était perçu, comment les hommes et les femmes se considéraient, comment on traitait les enfants, comment s’exprimaient le deuil, le désir…
Ensuite, je dirais que dans la mouvance du théâtre de la foire et des académies de chansonniers, Pierre-Jean de Béranger, à qui nous avons consacré un cycle il y a une dizaine d’années, peut être considéré comme la première grande référence de la chanson « moderne ». Mort en 1857, il a été très populaire à partir du début des années 1800, avec des chansons satiriques, des charges contre les magistrats, les prêtres, des textes sur les gens du peuple, des chansons presque déjà « réalistes »… Georges Brassens le connaissait très bien, Jean-Louis Murat a repris plusieurs de ses textes.
Et puis il y a l’apparition et l’essor des cafés-concerts et des cabarets…
C’est un moment très important, en même temps que se construit la ville moderne, l’industrie triomphante, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Les bals et cafés-concerts se développent après 1860, les cabarets un peu plus tard, avec l’ouverture, en 1881, du Chat noir, sur le boulevard de Rochechouart, à Paris, premier au monde.
Qu’est-ce qui fait leur particularité ?
Les cafés-concerts sont plutôt des grandes salles, qui se nomment L’Alcazar, L’Eldorado, La Scala, à Paris ou dans les grandes villes, certaines de mille, voire deux mille places. Il y a un orchestre, des danseuses, des numéros d’acrobatie, de magie… On est dans la suite du théâtre, avec une mise en spectacle de la chanson. Il y a ce que l’on appelle des « emplois », des rôles qui correspondent à des genres de chansons, l’idiot et ses inepties, le chanteur à voix et ses romances, la gommeuse et son pendant masculin qui aguichent… L’aristocratie et la bourgeoisie viennent s’y frotter au charme impertinent du prolétaire.
La grande vedette en est Yvette Guilbert, qui porte les textes les plus scabreux comme les plus raffinés avec une présence des plus provocantes. Maurice Chevalier, Mistinguett, Jean Gabin, chanteur avant d’être acteur, et plus tard Yves Montand sont les héritiers directs du café-concert.
Le cabaret est beaucoup plus petit (quelques dizaines de places), plus élitiste, plus intellectuel. Ses artistes sont au milieu des spectateurs. On y va pour entendre des chansons politiques, de la poésie, parfois macabre, des monologues, voire du théâtre d’ombre érotique. Ceux qui ouvrent les premiers cabarets se rapprocheraient des punks. Par leur âge ou leur esprit, Barbara, Anne Sylvestre, Juliette Gréco, Georges Brassens, Jacques Brel, en Belgique, Serge Gainsbourg ou Léo Ferré viennent de là.
Sur le plan musical, le swing des années 1930, les yé-yé dans les années 1960, sont-ils des moments de rupture ?
Dans les deux cas, il y a un rapport au corps, à la danse, une légèreté, un entrain adolescent. En France, où il y a cette culture forte de la chanson réaliste – le drame, le pathétique, ça meurt à la fin –, c’est un contraste. Ils arrivent avec la joie de vivre, physique et participative. Le swing du jazz américain, c’est Mireille qui le fait connaître, avant et après un séjour aux Etats-Unis, et Ray Ventura avec son orchestre Les Collégiens. Trenet, que l’on identifie souvent au swing, a régulièrement mentionné qu’il considérait que Mireille en avait été la première ambassadrice en France.
Avec les yé-yé, au début des années 1960, on est à nouveau dans quelque chose de participatif par la musique rythmique, le rock cette fois, après les années 1950 de la chanson dite « à texte » ou « rive gauche » et parallèlement à Piaf et ses élèves, Aznavour, Bécaud. C’est l’onomatopée qui compte, quand on reprend en chœur « yé-yé, wo-wo » avec Johnny Hallyday, Sheila, Claude François, Les Surfs… Les gens sérieux se moquent, mais savent-ils que c’est la même chose que dans les chansons traditionnelles où il y a souvent un refrain réduit à quelques sons – « et lon lon la lon lère » −, qui sert de lien entre les couplets.
Ensuite viennent Michel Polnareff, William Sheller, Michel Berger, Laurent Voulzy, Alain Souchon… et avec eux l’auteur-compositeur-interprète est à nouveau mis en avant, mais dans l’imprégnation de la pop amorcée par les yé-yé. S’ils ont à peu près le même âge, ils débutent plus tard, autour de la fameuse année 68. Il y a de la grâce et un peu de désespoir, un regard plus littéraire, mais sans faire de littérature. Puis arrivent Francis Cabrel et Jean-Jacques Goldman, qui écrit aussi beaucoup pour les autres.
Qu’est-ce qui fait une ou un grand interprète de chanson ?
Tout le monde peut chanter, vaguement, en chœur, sous la douche, à un repas de famille. Mais porter une chanson, porter son sens, c’est une autre histoire. Ce qui identifie un grand interprète, c’est ce qu’il va transmettre, par la voix et le corps : le sens, l’émotion, même sans chanter très juste ou pas très en rythme. La jolie voix, c’est relatif, cela dépend aussi des pays, des cultures, des traditions. Un grand interprète connaît les trésors de ses singularités, parfois fruits de ses faiblesses ou défauts. C’est aussi quelqu’un qui accepte de servir les œuvres des autres, qui n’est pas obsédé que par sa propre personne, qu’il soit auteur-compositeur ou non.
Selon moi d’ailleurs, l’épreuve ultime de la valeur d’une chanson, en tant qu’œuvre, est qu’elle puisse être interprétée par d’autres. En quoi les chansons écrites et chantées par Barbara sont-elles attachées à sa personne ? Est-ce que chantées par d’autres, sans aucune évocation d’elle pour des gens qui ne la connaîtraient pas, elles résistent, elles sont intéressantes ? C’est vrai, L’Aigle noir c’est d’abord Barbara, La Bohème, c’est d’abord Charles Aznavour. Mais Avec le temps, de et par Léo Ferré, tient toujours quand elle est portée par des dizaines d’autres interprètes très différents, Dalida, Bernard Lavilliers, Henri Salvador, Sapho, la chanteuse de jazz Abbey Lincoln ou le chanteur espagnol Amancio Prada…
Le répertoire de la chanson bénéficie-t-il d’une reconnaissance suffisante selon vous ?
C’est l’un des combats de ma vie depuis des années. Parce qu’elle est devenue une industrie, avec le disque et un large public qui remplit les salles, la chanson n’est pas considérée comme un objet d’art et de culture, à l’instar du théâtre, de la musique classique, des beaux-arts ou du cinéma, qui est aussi une industrie. Elle est vue comme une petite chose jetable, qui n’a d’importance que comme illustration de l’air du temps et des générations qui passent.
Mais la chanson, en tant que patrimoine culturel, exige l’aide et l’attention de l’institution, tous styles et tendances rassemblés. La transmission du répertoire ne doit pas se borner à ce dont on se souvient pour un hommage ponctuel ou pour faire de la sociologie sentimentale lors d’une émission de télévision ou de radio. Il faut le faire jouer, le faire chanter. En un mot, le faire vivre, en précieux héritage pour le futur.
Le Hall de la chanson, Parc de La Villette, 211, avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.
Tél. : 01-53-72-43-00. Lehall.com.
Début de la saison avec « Voix Ferré », samedi 10 septembre, à partir de 18 h 30 et « Chansons de terre et de table », vendredi 16 septembre, à 20 h 30.
« Ce qu’on entend dans les chansons. Des berceuses aux grands succès du répertoire français », de Serge Hureau et Olivier Hussenet, éditions Points, 198 p., 9,90 euros, à paraître le 22 septembre.