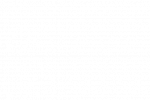« La sociologie de la violence contre l’école reste une sociologie de l’exclusion »

« La sociologie de la violence contre l’école reste une sociologie de l’exclusion »
Par Mattea Battaglia
Le chercheur Eric Debarbieux, expert ès violences scolaires, analyse la vague d’agressions dans et aux abords de lycées. Il publie, jeudi 19 octobre, un livre référence sur la question.
Il a été « Monsieur violence scolaire » sous des gouvernements de droite comme de gauche. Ancien délégué ministériel à la prévention de la violence à l’école, redevenu chercheur et libre de parole, Eric Debarbieux revient sur la succession d’agressions et de rixes dans et aux abords de lycées en cette veille des congés de la Toussaint. Il a publié, jeudi 19 octobre, un ouvrage qui réunit les meilleurs chercheurs internationaux sur le sujet : L’Ecole face à la violence, décrire, expliquer, agir (Armand Colin).
On a eu le sentiment, en cette veille de vacances de la Toussaint, d’une succession de violences visant des établissements scolaires – cinq lycées concernés en Seine-Saint-Denis, un à Calais, un autre à Toulouse… Les personnels de l’éducation sont-ils confrontés à une exacerbation de tensions ?
Je ne voudrais pas relativiser, d’un point de vue qualitatif, ce qui vient de se passer : les proviseurs, les enseignants agressés, en réalité toute la communauté éducative des lycées concernés ont besoin d’être entendus. Tous ont le droit à un suivi post-traumatique, au déploiement de cellules d’écoute, à une prise en charge psychologique. Symboliquement, le coup porté est fort, mais sur le plan quantitatif, les chiffres dont on dispose appellent à manier la nuance : parmi les 12 000 personnels de l’éducation sur lesquels porte ma dernière enquête – qui devrait être dévoilée en janvier 2017 –, 0,8 % ont été victimes d’une agression physique. La gravité des faits est souvent relative, et l’on recense très peu d’incursions de jeunes extérieurs dans les établissements.
Pas de phénomène à la hausse, donc ?
La même enquête, menée il y a cinq ans, faisait état de chiffres tout à fait semblables. Non, on n’est pas face à une augmentation de la violence scolaire… en moyenne. Car il faut regarder dans le même temps localement, lycée par lycée, ce qui est en jeu : une attaque réglée en bandes avec des cocktails Molotov n’a rien à voir avec le tabassage d’un instituteur sous les yeux de ses élèves. Il peut s’agir dans tel lieu d’une explosion de violences en lien avec des trafics de drogue, l’économie souterraine ; là, plus simplement d’un élève qui perd son sang froid face à un dépositaire de l’autorité. Rien n’est vraiment comparable.
On peut avoir le sentiment que c’est parce que ces agressions ont lieu en « banlieue » qu’on s’en émeut autant…
Le discours d’exclusion ambiant, qui devient un argument électoral, révèle une hypersensibilité à ce type d’événements. La vraie question qui se pose est de savoir si les enseignants risquent plus d’être agressés dans les zones d’exclusion que dans un établissement ordinaire. C’est effectivement le cas. On sait depuis des enquêtes de 2011 au primaire, de 2013 dans le secondaire, que le risque d’agression d’un membre du personnel double en éducation prioritaire. Si l’on compare les 10 % d’établissements les plus favorisés socialement, avec les 10 % les moins privilégiés, le risque est même cinq fois plus important.
La sociologie de la violence contre les personnels en milieu scolaire reste une sociologie de l’exclusion, et ce n’est pas le cas qu’en France. Un des principaux facteurs de risques pour les personnels – qui explique près de 50 % de la « variance » du taux d’agression – relève de variables socio-économiques. C’est moins vrai côté élèves.
On a coutume de souligner la situation difficile des collèges. L’actualité récente concerne pourtant les lycées. Est-ce une évolution ?
On a moins de données sur les lycées que sur les collèges, mais c’est vrai que les lycées semblent plus sensibles aux violences extérieures – plus, d’ailleurs, les établissements professionnels que ceux d’enseignement général et technologique. L’explication la plus souvent avancée est qu’ils sont moins implantés dans les quartiers du fait de leur recrutement qui ne relève pas de la carte scolaire. De là à affirmer qu’ils sont de plus en plus touchés, alors que les acteurs de l’éducation savent bien que les manifestations de violence diminuent avec l’âge – à 15-16 ans –, il y a un pas qu’on ne peut franchir sans faire appelle à la recherche.
Peut-on en conclure que la violence scolaire évolue peu ?
Elle a surtout évolué au tournant des années 1990-2000. A l’époque, on a beaucoup publié sur la violence « anti-scolaire » et l’« ethnicisation » de la violence : une pensée en termes de « eux » et de « nous » reprise à leur compte par certains jeunes, très minoritaires certes, mais qui s’exprime parfois très violemment. Dans cette logique, on s’en prend à l’école comme à la police ou aux transports urbains ; cela recoupe aussi les difficultés parfois ressenties par les pompiers ou les médecins : la violence qui s’exprime chez cette frange de la jeunesse est très liée à la délinquance d’exclusion. Des petits groupes s’identifient contre l’école, contre les institutions, contre les « inclus ».
Quelles sont les réponses qu’apporte l’institution ? Evoluent-elle ?
On brode beaucoup sur la violence d’intrusion dans les établissements – du fait de bandes de jeunes mais aussi, en cette rentrée, de la menace terroriste. La formation de chefs d’établissement à la gestion de crise, le déploiement d’équipes mobiles de sécurité sont une bonne chose, et on a fait des progrès en la matière ces quinze dernières années. Mais on reste un peu enfermé dans un discours caricatural : il n’y aurait qu’une démarche sécuritaire pour répondre aux questions de sécurité. Or, une fois géré le moment de la crise, une fois géré son suivi, il faut interroger, réfléchir collectivement au travail de fond que peut faire l’école.
L’école ne peut pas tout. Elle ne résoudra pas tous les accès de violence ni les problèmes géostratégiques du djihadisme. Mais elle a un défi fondamental à relever : ne pas se couper du lieu où elle se déploie et développer chez les jeunes le sentiment d’appartenance, alors qu’une petite frange la perçoit comme une ennemie plutôt que comme une alliée, un capital social. Les premières victimes en sont l’immense majorité des élèves qui habitent ces quartiers. Sans sentiment d’appartenance à l’école, le climat scolaire ne peut être bon.