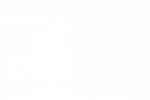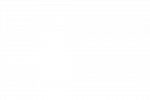Cédric Villani : « Les étudiants africains sont très intéressants, on sent l’appétit, l’enthousiasme »

Cédric Villani : « Les étudiants africains sont très intéressants, on sent l’appétit, l’enthousiasme »
Propos recueillis par Serge Michel
Le chercheur, Médaille Fields 2010, s’investit dans le projet des instituts AIMS, des centres d’excellence africains en mathématiques.
On apprend beaucoup de choses en parlant avec le plus célèbre mathématicien français. Que les Béninois sont les plus performants dans la discipline, ou que la France est en train de rater une opportunité. Car Cédric Villani, Médaille Fields 2010, multiplie les voyages en Afrique. Il est notamment très investi dans le projet des instituts AIMS, pour African Institute for Mathematical Sciences, des centres d’excellence lancés par le cosmologiste sud-africain Neil Turok en 2003. Ainsi que dans une initiative parallèle, le Next Einstein Forum, qui n’hésite pas affirmer que le prochain Einstein sera africain.
Vous êtes donc coutumier du continent ?
Cédric Villani Je pratique surtout l’Afrique francophone, avec déjà seize ou dix-sept voyages, et au Sénégal plus qu’ailleurs. Quand on veut faire les choses sérieusement, ce qui compte n’est pas d’être allé partout, mais le suivi et les relations sur le long terme. J’enseigne dans les centres AIMS au Cameroun et au Sénégal. Je vais aussi en Algérie et au Bénin. Là, il n’y a pas de centre AIMS, mais je suis président du conseil scientifique de l’Initiative béninoise, financée par la Banque mondiale. Les Béninois sont ceux que je connais le mieux, ce sont les plus performants. C’est lié à leurs traditions. Quelques mathématiciens béninois sont très reconnus internationalement. Dans chaque pays, je vais dans les universités, je vois les ministres, les ambassadeurs, je donne des coups de main, j’écris des lettres de recommandation.
Comment sont les étudiants ?
Les étudiants africains sont très intéressants. Ils n’ont pas accès à la littérature, ils manquent d’accès à des professeurs de niveau international mais on sent l’appétit, l’enthousiasme que l’on a tendance à oublier dans les pays plus développés. Il y a beaucoup de questions dans les cours. Un mélange étonnant de gens ultra motivés et d’autres plus passifs. Certains ont tout appris par cœur, d’autres sont plus imaginatifs. Un prof de Paris VI que j’ai convaincu d’aller au Cameroun est revenu très content, disant que l’engagement des étudiants était supérieur à celui de ses élèves parisiens.
Les universités sont-elles à la hauteur de ces étudiants ?
Elles souffrent toutes de la malédiction du nombre. En Europe, on parle tellement d’excellence que ça devient écœurant. Ici, au contraire, c’est un mot qui n’a pas été assez entendu. Le problème des universités africaines est d’arriver à sélectionner les quelques élèves qui peuvent passer à l’échelon supérieur, qu’il faut diriger vers des centres performants. C’est l’ambition d’AIMS, un modèle vraiment remarquable lié aux universités mais avec une certaine indépendance. Après, sur le terrain, c’est une course d’endurance. Il faut surmonter mille obstacles, trouver les bons directeurs, les bonnes relations avec le gouvernement.
Le monde académique africain anglophone est-il très différent ?
La différence est considérable. Le monde anglophone est plus pragmatique, mais les francophones ont un meilleur niveau en mathématiques. Les programmes africains francophones sont plus exigeants qu’en France, ils sont restés à ce que nous avions il y a quelques années. Pour l’instant et pour très longtemps encore, le monde africain des sciences est partagé entre les deux pôles, des anglophones plus praticiens et des francophones plus théoriciens. L’un ne va pas absorber l’autre mais le mariage des deux est une équation importante à résoudre pour le continent, d’autant qu’il y a des poids lourds côté anglophone : le Nigeria aligne une centaine d’universités, il y a des équipements de qualité en Afrique du Sud, et un pays comme le Rwanda progresse très vite.
Les mathématiques, qui exigent peu d’équipements coûteux, ne sont-elles pas une discipline idéale pour les pays pauvres ?
C’est vrai, mais d’autres facteurs sont à prendre en compte. Le plus important pour travailler les mathématiques, c’est un bâtiment. Et ce n’est pas rien. C’est souvent le souci numéro un. Il faut le trouver, le défendre contre ceux qui le veulent aussi, faire du lobbying, éviter qu’il se dégrade. Ça prend des années et, parfois, cela ne se résout pas. L’autre chose, quand vous avez de bons mathématiciens africains, c’est l’exil et le voyage qui sont une étape indispensable pour leur développement. Et s’ils rentrent après, ce qui est un choix personnel, il faut les bonnes conditions locales. Il faut des salaires, des infrastructures. J’ai un collègue africain de Harvard qui est rentré au Nigeria et se demande pourquoi : le salaire n’est pas fameux et le courant est parfois coupé de 10 à 18 heures. Financer une recherche, une personne, une bourse, ça va, mais financer un écosystème propice aux mathématiques, ça coûte cher !
Pourquoi le voyage est-il indispensable aux mathématiciens ?
Parce que sans discussions, sans contacts avec les autres, ce ne sont pas les bons problèmes, les bonnes questions, les bons réflexes qui sortent. Un mathématicien n’est rien sans son environnement. Nous passons notre temps à nous rencontrer, à voyager.
Par Skype, cela ne marche pas ?
Non, parce que, sur Skype, les conversations sont dirigées. On parle d’un truc précis, on écoute la conférence d’untel parce qu’il y a un outil qui sera utile. Mais on a aussi besoin de discussions informelles. Si vous écoutez les conversations des mathématiciens entre eux, c’est très frappant, ils se demandent qui est là, physiquement, qui a été engagé, qui est parti, sur quoi telle personne travaille. L’espace reste extrêmement structurant. Les universités virtuelles pour les mathématiques, on peut oublier, cela ne marche pas. Il faut quatre murs, un toit, être ensemble.
Est-ce que vous voyez parfois des étudiants sortis de nulle part, qui ont appris tout seul, par Internet ?
Non. Travailler sur des problèmes de recherche mathématique, ça s’exerce par des années de dur labeur. Si vous n’êtes pas dans un environnement, dans une classe, avec un prof qui vous donne des contraintes, vous ne faites pas les exercices. Dans tous mes voyages, je n’ai rencontré qu’un seul cas, exceptionnel : un étudiant argentin qui était à l’université de Buenos Aires mais avait trouvé ses problèmes de recherche tout seul, sur Internet.
La France ne semble pas très impliquée dans le programme AIMS…
C’est vrai. Et il n’y avait aucun représentant institutionnel français au Next Einstein Forum de Dakar, en mars 2016. Cela tient peut-être à l’architecture de la gouvernance idéale à la française : c’est bien organisé, chacun a de quoi s’occuper, mais si un truc nouveau apparaît, ça tombe entre les silos. AIMS a aussi commencé plutôt côté anglo-saxon et certains Français ont bloqué, parce qu’en anglais, mathematical sciences n’a pas vraiment le même sens. Côté français, c’est juste les mathématiques, alors qu’en anglais c’est plus général, cela comprend la physique, etc. Cela a dérangé une partie des mathématiciens français qui sont très à cheval sur les terminologies. A mon avis, ce débat est dépassé. L’enjeu, c’est la façon dont la France va se positionner pour les années à venir. En 2100, il y aura 4 milliards d’Africains. Ce sera le plus gros réservoir d’étudiants du monde. Est-ce que la France aura les filières ? Sera-t-elle prête à assumer les besoins de formation, ou est-ce que tout sera passé du côté des universités américaines ? C’est un vrai sujet ! J’ai plusieurs exemples de filières françaises qui perdent du terrain par rapport aux filières anglo-saxonnes. Et avec AIMS, la France est en train de manquer une opportunité.
L’enseignement supérieur en Afrique : les chiffres
Durée : 02:04
Y compris du côté des entreprises privées ?
Oui. La seule qui est représentée [dans AIMS et le Next Einstein Forum], c’est Orange, parce que je suis dans leur conseil scientifique. Les entreprises anglo-saxonnes sont moins timides, peut-être parce qu’elles ne sont pas, comme souvent en France, des anciennes entreprises publiques. Elles prennent des risques, elles comprennent le long terme. Un ministre de l’enseignement supérieur qui fait bien son boulot ne doit pas espérer une quelconque récompense durant son mandat. C’est pareil pour une entreprise qui investit en Afrique : ce n’est pas le patron qui prend la décision qui en profitera, mais son successeur, ou le suivant.
Le Monde Afrique organise les 27 et 28 octobre, à Dakar, la troisième édition de ses Débats avec pour thème, cette année, les défis de l’éducation supérieure en Afrique. Il y sera question des universités, de l’adéquation des filières actuelles avec les besoins des entreprises, de l’innovation technologique au service de l’éducation et de la formation des leaders africains, de la formation des grands mathématiciens de demain. L’entrée est libre, sur inscription. Cliquez ici pour consulter le programme et vous inscrire.