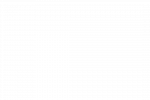Russell Banks : « J’ai commencé à imaginer tout ce que je n’ai plus le temps de faire »

Russell Banks : « J’ai commencé à imaginer tout ce que je n’ai plus le temps de faire »
M le magazine du Monde
À une époque de profondes mutations, le rapport au temps est chamboulé. Nous avons invité des personnalités et des anonymes à se confier sur ce vaste sujet. Cette semaine, l’écrivain américain Russell Banks.
A 76 ans, Russell Banks est l’une des figures les plus importantes de la littérature américaine. Avant la publication d’un recueil de chroniques prévue début 2017, Actes Sud sort une nouvelle traduction de son best-seller Continents à la dérive paru en 1985. À cette occasion, Russell Banks confie une certaine vision de son métier et des années qu’il lui restent à écrire.
Parlez-nous de votre processus d’écriture.
C’est difficile de savoir par quoi commencer car le temps est une notion abstraite mais je vais essayer de rendre cela concret. L’écriture d’un roman représente une grande période de temps. C’est un projet de long terme comme un mariage. C’est un vrai engagement. Quand je me lance, je sais que j’en ai pour trois ans.
Si l’on fait une analogie, le temps d’un roman est comme un mur à construire. Il se compose de petites briques de temps plus court posées les unes après les autres. Ça commence avec un petit Moleskine que j’ai toujours avec moi dans lequel je consigne mes notes. Puis j’écris sur un plus grand Moleskine avant de transférer tout ça dans l’ordinateur beaucoup plus pratique pour les corrections. Je travaille chaque matin jusqu’à environ 14 heures dans mon petit studio en dehors de chez moi. Je ne fais rien d’autre qu’écrire. Et j’essaie d’aboutir chaque jour à un paragraphe, une page au mieux.
Je viens de commencer un nouveau roman. J’ai 76 ans. Je sais que j’aurai presque 80 ans quand il sera terminé. Je ne pourrai plus me lancer dans une autre période de trois ans après. C’est donc le dernier. Je sais que j’aurai encore envie d’écrire après. Je me concentrerai donc sur des nouvelles qui ne me prennent qu’une ou deux semaines.
C’est amusant car vous semblez calculer le temps qu’il vous reste en permanence comme pour mieux l’organiser.
Oui.
Avez-vous toujours fait ça ?
Non. Quand j’étais jeune, je pensais avoir un temps illimité. Je n’avais pas à m’inquiéter du nombre de livres que j’aurais le temps d’écrire. Ce besoin de planifier est arrivé récemment. J’ai commencé à imaginer tout ce que je n’ai plus le temps de faire.
Et s’il vous restait encore vingt ans ou plus à vivre ?
Vous avez raison mais si l’on regarde l’histoire, combien d’écrivains ont écrit des choses importantes après 80 ans ? Pas beaucoup.
Ne pensez-vous pas que l’on s’améliore avec le temps ?
Il faut laisser l’histoire et les lecteurs le dire. Laisser le temps passer après sa mort. Regardez Hemingway. On accorde aujourd’hui plus de valeur à son œuvre de jeunesse qu’à son œuvre plus tardive. Et c’est souvent le cas des romanciers. Certains poètes produisent, eux, des œuvres merveilleuses sur le tard. Je pense à Yeates ou Robert Frost.
Qu’est-ce qui explique cela d’après vous ?
Pour écrire un roman, il faut être capable de retrouver un très haut niveau de concentration jour après jour pendant une très longue période, 1 000 ou 1 500 jours d’affilée. Cela demande une énergie physique et mentale très importante. Cela devient donc difficile en vieillissant.
Et pourtant, en vieillissant, on peut imaginer que la technique s’aiguise et permet de produire des œuvres de plus en plus parfaites.
Je pense, en effet, qu’avec l’âge on en sait plus que jamais sur notre art. C’est pareil pour les réalisateurs, les peintres, les compositeurs, etc. Mais c’est beaucoup plus difficile de s’en extraire et l’on se répète. La naïveté est l’un des plus beaux cadeaux de la jeunesse. On se lance dans des projets sans en maîtriser forcément la technique.
Vos personnages symbolisent souvent leur époque. Est-ce une façon de les rendre très politiques ?
En effet. Je conçois toujours les gens selon leur histoire, leur genre, leur origine ethnique ou sociale. Ces éléments disent qui nous sommes et déterminent souvent ce que nous faisons. Pourtant, lorsque les lecteurs français découvrent aujourd’hui Continents à la dérive, écrit au début des années 1980, ils pensent à la crise des migrants, à la crise économique en Europe. Les personnages réussissent à voyager à travers le temps. Pourquoi nous intéressons-nous encore à Madame Bovary ou à Anna Karénine ?
Parce que le lecteur fait le travail.
Exactement. Nous les amenons dans notre temps. C’est aussi parce qu’ils transcendent le temps. Ce sont des personnages universels. C’est le bonheur d’écrire de la fiction : s’extirper du temps pour le rendre universellement compréhensible. Nous lisons Homère car les êtres humains qu’il décrit semblent faire partie de notre époque.
Y pensez-vous quand vous écrivez ?
(Rires) Non. Je suis focalisé sur le moment. Celui de l’écriture et celui de mes personnages.
Est-ce qu’ils évoluent pendant l’écriture en fonction des changements qui interviennent dans votre vie ?
J’essaie de leur laisser un peu de liberté. L’écriture est un processus de découverte. Il faut rester ouvert.
On entend beaucoup que le temps s’accélère et notamment à cause de la communication. Comment voyez-vous cela ?
Nous vivons une époque d’accélération des changements. Auparavant les périodes de grands changements étaient précédées de longues périodes très stables. Aujourd’hui, les changements se succèdent sans ces longues périodes.
Il faut donc s’adapter, se réajuster très rapidement et très souvent. Revoir nos relations sociales et économiques. Quand on pense au monde des années 1980, quand j’ai publié Continents à la dérive, il n’y avait ni téléphones portables, ni Internet. Ce sont les conditions de vie qui ont beaucoup changé pas la vie elle-même.
L’époque nous conditionne-t-elle ?
Je suis né dans les années 1940. Hemingway, Faulkner étaient encore vivants et Fitzgerald venait de mourir. Cette part de l’histoire de la littérature était mon présent. Elle a forgé le type d’écrivain que je suis devenu. À cette époque, le roman était la forme majeure pour raconter des histoires. Si j’avais 20 ans aujourd’hui, je ne suis pas sûr que je deviendrais romancier. C’est très archaïque ! Je crois que je serais réalisateur pour Internet car c’est la forme dominante pour raconter des histoires. Et c’est ce que je fais avant tout.
Quelle vision avez-vous de votre carrière ?
Si je suis renversé par un bus en sortant de cette interview, je sais qu’il restera mes livres pour le pire ou le meilleur. Je ne sais pas s’ils traverseront les époques.
Vous le souhaitez n’est ce pas ?
Bien sûr, mais je ne serai pas là pour en profiter (rires). C’est très plaisant de se dire que ce que l’on a fait a une valeur pour les autres.
À lire « Continents à la dérive », de Russell Banks, Actes Sud, 23 €.
À écouter, l’émission de France Inter : « L’Heure bleue » consacrée à Russell Banks