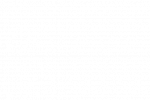Le rêve déçu de la Cour pénale internationale

Le rêve déçu de la Cour pénale internationale
Editorial. La crise profonde qui touche la CPI, suite aux décisions de plusieurs pays africains de quitter l’institution, montre les limites du statut de la Cour de La Haye
A l’ouverture du procès, devant la Cour pénale internationale de La Haye, de l’ancien président de la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, et de son ex-ministre à la Jeunesse, Charles Blé Goudé, le 28 janvier. | PETER DEJONG / AFP
Editorial. Après le Burundi puis l’Afrique du Sud, la Gambie a annoncé, le 26 octobre, qu’elle quittait la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye. Le coup est rude, car la procureure de la Cour, Fatou Bensouda, elle-même de nationalité gambienne, avait tenté de lui donner un nouveau souffle. Au-delà de la volonté de se mettre à l’abri de poursuites, ces défections en série traduisent une profonde crise de l’institution chargée, selon son préambule, « de juger les crimes qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine » : crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide.
Parmi les 124 Etats parties à la CPI, 34 sont africains. Mais les élites de bon nombre d’entre eux accusent désormais la CPI de « chasse raciale ». De fait, la quasi-totalité des procédures ouvertes jusqu’ici ont visé des pays africains, et la première condamnation, prononcée au bout de dix ans, visait un chef de milice congolais, Thomas Lubanga. Certes, une enquête a été ouverte sur les crimes commis en Géorgie lors de l’attaque des forces russes en 2008, et d’autres pourraient l’être en Colombie ou en Palestine, mais elles ont peu de chance d’aboutir.
Depuis son entrée en fonctions en juillet 2002, la CPI est victime des limites de son statut. Après la création de deux tribunaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie en 1993, puis pour le Rwanda en 1994, la Cour de La Haye a concrétisé le rêve d’une justice pénale universelle et permanente. D’où la prudence des Etats.
Pas les moyens de faire exécuter ses mandats d’arrêt
Selon ses statuts, la CPI ne peut lancer des poursuites que pour des crimes commis sur le territoire de pays ou contre des ressortissants de pays qui en sont membres. Ceux qui craignent de devoir rendre des comptes comme la Russie, la Chine, les Etats-Unis, la quasi-totalité des pays arabes et Israël ont donc rejeté cette juridiction. Si le Conseil de Sécurité peut saisir la CPI contre un Etat non-membre – ce fut le cas pour le Darfour en 2005 ou la Libye en 2011 –, les bourreaux bénéficiant de la protection d’un ou plusieurs des cinq membres permanents ne risquent pas grand-chose. C’est aujourd’hui le cas pour la Syrie.
Il n’est donc pas étonnant que les procédures se soient concentrées sur l’Afrique et sur des responsables subalternes, sauf quand l’émotion suscitée par l’ampleur des crimes a empêché tout veto. Ainsi, en 2009, le président soudanais Omar Al-Bachir a été le premier chef d’État en exercice poursuivi pour « crimes contre l’humanité » et « génocide » au Darfour.
Mais ce coup d’éclat du procureur de l’époque, l’Argentin Luis Moreno Ocampo, a eu un effet inverse de celui recherché : il a décrédibilisé un tribunal qui n’a pas les moyens de faire exécuter ses mandats d’arrêt. En se posant en victime de l’Occident, l’homme fort de Khartoum a continué à parader aux sommets de l’Union africaine, de la Ligue arabe ou de l’Organisation de la Conférence Islamique.
Malgré ces difficultés, la CPI n’en reste pas moins un symbole pour tous ceux qui luttent pour la fin de l’impunité pour les dictateurs et massacreurs de haut vol. Il a fallu plus de trois décennies pour que la Cour européenne des droits de l’homme gagne la crédibilité qui est aujourd’hui la sienne pour les 800 millions de citoyens des 47 pays membres du Conseil de l’Europe. Mais les Etats concernés ont joué le jeu, et les opinions publiques aussi. Au contraire, la CPI semble encore incarner une justice hors sol, avec toutes les limites qui en découlent.