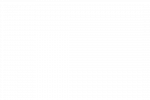Peut-on « décoloniser » la pensée africaine en se réunissant à l’Institut français de Dakar ?

Peut-on « décoloniser » la pensée africaine en se réunissant à l’Institut français de Dakar ?
Par Yann Gwet (chroniqueur Le Monde Afrique)
Notre chroniqueur pose la question, entre autres, de la pertinence du choix du centre culturel par les organisateurs des Ateliers de la pensée.
L’Institut français de Dakar, où se sont déroulés du 28 au 31 octobre 2016 les premiers Ateliers de la pensée, organisés par Felwine Sarr et Achille Mbembe. | DR
Que penser de la première édition des Ateliers de la pensée, qui s’est tenue du 28 au 31 octobre à Dakar et à Saint-Louis, et a réuni une poignée d’intellectuels et artistes africains ?
En Afrique, les intellectuels sont un peu comme les hommes d’église : qu’on les apprécie ou pas, on se sent contraints de leur témoigner une forme de respect. Ils jouissent d’une certaine aura. Ils sont à leur manière un pouvoir.
Peut-être est-ce la raison pour laquelle relativement peu de critiques ont émergé suite à cet événement. La plus audible est le reproche que l’on peut adresser aux organisateurs quant au choix de l’Institut français de Dakar comme lieu de débat parmi d’autres plus consensuels. Dans l’absolu, pourquoi pas cet endroit, après tout ? On peut imaginer que des raisons pratiques expliquent cette option. Mais il se trouve que l’un des objectifs des organisateurs des Ateliers était d’initier un processus de « décolonisation mentale ». Dans ces conditions, le choix de l’Institut français autorise en effet à se demander s’ils ne souffrent pas du mal dont ils veulent nous débarrasser.
Incarner le « réel »
Mais cette question du lieu d’où l’on parle est aussi importante, car elle pose la question du rapport de nos intellectuels au « réel ». Une autre critique qui aurait été formulée à l’endroit des Ateliers est l’applicabilité de toutes les réflexions produites. En clair, comment permettent-elles de changer le réel africain ? De ce point de vue, le lieu est une réponse symbolique – et les symboles comptent. Car, en l’occurrence, l’Institut français de Dakar, l’Université Gaston-Berger, et le Codesria, un centre de recherches panafricain, ne sont pas des lieux où le « réel » africain, dans toute sa gravité et son urgence, se manifeste. Au Sénégal, 56,3 % de la population est rurale, 77,5 % est dans l’agriculture, et plus de 40 % vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, si le « réel » est présent dans le discours de nos penseurs, il est permis d’interroger leur conception et leur attachement à ce « réel ». Etait-il impossible d’organiser ces Ateliers dans un lieu qui incarne le « réel » sénégalais ?
Cette critique n’est pas purement formelle. Sur le fond, certains signaux laissent penser que le « réel » africain n’est pas nécessairement la priorité de nos intellectuels. Par exemple, dans une interview récente, Felwine Sarr, l’un des initiateurs des Ateliers, explique que « fondamentalement, ce sont les représentations du réel qui sont problématiques. Le réel est ce qu’il est, mais si on convainc la majorité d’une représentation du réel, on est dans un enjeu de pouvoir ». Le « on » est ici probablement les penseurs, souvent occidentaux, qui « représentent » l’Afrique. Cette lecture pose deux problèmes. Se focaliser sur les « représentations » du réel, c’est se situer sur le terrain de l’Autre, et c’est justement s’éloigner du « réel » africain – qui devrait être notre obsession. Ensuite, il a raison de souligner que le savoir est un enjeu de pouvoir. Mais justement, résoudre le problème des « représentations » du réel (la manière dont l’Autre nous définit) exige au préalable de renverser la balance du pouvoir. C’est en effet celui qui a le pouvoir, à la fois économique, politique et culturel, qui dicte ses « représentations ».
Un pouvoir à interroger
L’intérêt relatif que nos intellectuels portent au « réel » africain se devine aussi dans leur adhésion à l’idéologie multiculturaliste dominante. Dans une interview au Monde Afrique, Achille Mbembe, autre initiateur des Ateliers, déplore la « militarisation de nos frontières » et les « idéologies de la différence », et peint une Afrique au confluent du monde. Les victimes de Boko Haram au Nigeria et au Cameroun savent le coût de frontières abandonnées. Par ailleurs, le sans-frontièrisme qu’il défend est aussi le cadre idéal du « néolibéralisme » dont l’intellectuel souhaite par ailleurs la critique. Il suffit pour s’en convaincre de voir le destin des petits commerçants africains exposés à une concurrence qui se nourrit de l’effacement des frontières.
En outre, s’il est vrai que le différentialisme peut conduire au racisme, il me semble tout aussi vrai que l’indifférentialisme est une illusion qui, elle aussi, sert les intérêts d’un « néolibéralisme » qui nous voit tous comme des consommateurs et non comme des individus porteurs de cultures et d’identités différentes. Les différences existent. Les revendiquer n’empêche pas d’être ouvert aux autres.
Il en est de même de l’Etat-nation, que M. Mbembe compare à un « carcan » dont il faudrait « sortir ». L’Etat-nation est pourtant le cadre de la démocratie, et la seule protection dont disposent les petits, ceux qui subissent le « réel » africain. Démanteler l’Etat-nation, c’est éradiquer le peuple.
Ces Ateliers sont une belle idée. Il faut les encourager. Mais comme tous les pouvoirs, celui des intellectuels ne doit pas être seulement célébré, mais aussi interrogé, et parfois mis face à ses paradoxes.
Yann Gwet est essayiste camerounais.