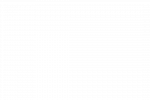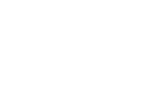Fidel Castro, l’intransigeant père de la révolution cubaine, meurt à 90 ans

Fidel Castro, l’intransigeant père de la révolution cubaine, meurt à 90 ans
Par Marcel Niedergang
Le leader cubain est mort, vendredi soir, à La Havane.
Fidel Castro devant l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York, le 26 septembre 1960. | TOMMY WEBER / AFP
Entré au « Monde » en 1952, Marcel Niedergang (1922-2001) a été grand reporter en Amérique latine. Ce texte, écrit peu avant sa mort et mis à jour, raconte un Fidel Castro déterminé, habité par l’anti-impérialisme. Le père de la révolution cubaine est décédé vendredi 25 novembre, à La Havane.
A Cuba, Fidel Castro a été, pendant presque cinq décennies de pouvoir absolu – le plus long règne de l’histoire contemporaine –, la « parole qui oriente ». Comment juger sereinement un oracle qui s’ingénia tant à brouiller les pistes ? Il a toujours été attentif à protéger ses vraies motivations, personnelles et politiques, tout en étalant complaisamment en public, devant ses intimes ou les hôtes étrangers, ses passions, ses curiosités innombrables, voire ses petites manies : la lecture, le sport, les recettes de cuisine ou les méthodes d’élevage, il était l’éclectisme poussé au paroxysme. Il avait un avis définitif sur presque tout et aimait tenter de l’imposer aux autres.
Etre le premier, le meilleur, le plus ferme. « Fidel a toujours raison », disait Celia Sanchez, la compagne très affectionnée dans le maquis de la sierra Maestra, gouvernante efficace, puis secrétaire du gouvernement qui, plus qu’aucun autre de l’entourage du monarque Fidel, a tenté d’ordonner l’emploi du temps débridé du Lider Maximo. « Chef suprême » : ce titre résumait la totalité des pouvoirs politiques et militaires qu’ il a exercés sans partage et si longtemps.
On sait tout de ce qui importait le moins. De ses performances à la pêche sous-marine, sport préféré qu’il pratiquait à Cayo Piedra, un îlot préservé dans la baie de Guantanamo, où il recevait parfois ses hôtes de marque. Du record de coupe de la canne à sucre établi en un seul jour par Fidel, à la fin des années 1960, lorsqu’il s’agissait d’inciter les macheteros à se surpasser : anecdotes largement reproduites par la presse cubaine à la dévotion du numéro un, depuis son arrivée à La Havane, en janvier 1959, jusqu’à la fin.
Médias « aux ordres »
De façon peu convaincante, Fidel n’a cessé de critiquer ces médias « aux ordres », de réclamer formellement une presse plus audacieuse… En vain, bien sûr. A moins que ce décalage étonnant entre les injonctions du commandant en chef et des médias immuablement monocordes n’ait illustré ce goût profond pour l’ambiguïté de Fidel.
Castro était un disciple et admirateur de José Marti, héros des guerres d’indépendance, qui recommandait de dissimuler le plus longtemps possible le coup que l’on voulait porter. Un « conspirateur dans l’âme », selon Tad Szulc, journaliste du New York Times, reçu plusieurs mois à Cuba et autorisé exceptionnellement à consulter les archives du gouvernement pour rédiger une biographie du Lider Maximo. « Un maître dans l’art de se dissimuler aux yeux des autres », ajoutait-il. Entre Machiavel et Marx.
En politique, comme dans l’action, dans la lutte armée à Cuba comme à l’extérieur – en Angola, en Ethiopie, en Amérique latine –, Fidel s’est efforcé de dissimuler ses intentions et ses objectifs. Il est souvent parvenu à transformer un échec militaire en victoire politique. Quel meilleur exemple, dès le début, que l’assaut manqué lamentablement contre la caserne Moncada, le 26juillet 1953 ? Ou que le débarquement raté du Granma – « un naufrage », disait Ernesto Che Guevara – sur la côte orientale de Cuba, en décembre1956 ?
Castro s’est avancé masqué pendant la guérilla et dès son entrée en héros à La Havane, triomphant de la dictature de Fulgencio Batista. « La révolution cubaine est une démocratie humaniste », disait-il lors de son voyage de vainqueur aux Etats- Unis, en avril 1959. Il a attendu deux ans pour se proclamer marxiste-léniniste et plus encore pour créer, du jour au lendemain, un « nouveau » Parti communiste cubain, dont le comité central de cent membres – tous anciens compagnons de guérilla dans la sierra Maestra, le massif montagneux du sud de l’île – a été composé par ses soins.
Puis, il a lâché des semi-confidences, des allusions qui embrouillaient plus qu’elles n’explicitaient. « J’étais presque communiste » avant de prendre le pouvoir, a-t-il ensuite assuré. Szulc a affirmé que Castro avait, dès son arrivée au pouvoir, mis en place un gouvernement « parallèle » secret, qu’il avait signé un pacte, également secret, avec les vieux communistes du Parti socialiste populaire et rencontré, dès l’automne 1959, un émissaire soviétique. Le même auteur, pourtant, a conclu que Castro avait « mis le grappin » sur les communistes cubains, et non l’inverse.
Rares tentatives de rébellion écrasées
Castro les a rapidement noyés dans le flot des fidélistes, a écrasé les rares tentatives de rébellion des communistes orthodoxes prosoviétiques. Il a combattu durement les partis communistes d’Amérique latine rétifs à ses instructions ; il a contrôlé et dirigé les autres, jouant des rivalités, accueillant à Cuba des bataillons de militants latino-américains pour les entraîner à la guérilla et les endoctriner.
Pendant un quart de siècle, un débat a opposé les partisans de la thèse d’un Castro poussé dans les bras de l’Union soviétique par les erreurs et l’agressivité des Etats-Unis et les avocats d’un Castro décidé, dès le début, à instaurer un régime socialiste à Cuba. Aucune réponse définitive n’a été apportée à cette question fondamentale. Par nécessité ou stratégie, Castro a en tout cas troqué une dépendance aux Etats-Unis pour une autre sujétion, sourcilleuse mais encore plus rigoureuse, à l’URSS.
Avec Moscou, Castro a noué une alliance indispensable à la survie de sa révolution. Alliance inégale, bien qu’il ait sans cesse réaffirmé sa « souveraineté ». Il a reçu des Soviétiques, dès 1960, une aide économique et militaire très importante, progressivement jugée trop lourde par Moscou. Elle a fini par être réduite à la fin des années 1980, lorsque l’URSS de Mikhaïl Gorbatchev dut, elle-même, affronter une crise économique dévastatrice. Cette aide a néanmoins permis à Cuba de devenir une puissance militaire, d’obtenir des résultats positifs dans les domaines de la santé et de l’éducation et de maintenir un temps à flot une économie nationale en crise permanente.
Autre certitude : après 1968 et son discours justifiant l’intervention militaire du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie, La Havane a épousé toutes les orientations de la politique étrangère soviétique. Et pourtant la personnalité de Fidel était d’une telle complexité que certains n’ont jamais exclu l’hypothèse d’un nouveau changement de cap, si ce revirement pouvait « tourner à l’avantage de Cuba, de la révolution ou à son propre avantage ». Et ce, bien qu’il ait – avec une obstination tournant, sur la fin, à la répétition stérile – dénoncé l’« impérialisme américain » et l’embargo décrété par Washington en 1960 comme la seule cause de toutes les faiblesses du régime.
Coléreux, brouillon, désordonné
Une volonté de fer, une exceptionnelle capacité de travail, une mémoire prodigieuse, un talent oratoire de premier ordre, sans oublier l’intelligence et le courage physique : on a répété à satiété ses qualités. L’homme était aussi très coléreux, brouillon, désordonné, roublard et retors. Mais presque tous ceux qui l’ont approché ont été séduits par ce colosse barbu, dont le fils, Fidelito, occupa des fonctions importantes à la Commission nationale de l’énergie atomique, et qui a eu par ailleurs plusieurs enfants naturels.
Comment dissocier Castro de la révolution cubaine ? Un modèle plutôt décevant. Les tentatives d’industrialisation ont tourné court ; le « Tout pour le sucre » de la récolte de 1970 a désarticulé l’appareil de production. L’austérité, toujours plus d’austérité. Année après année, la libreta (« carnet de rationnement ») à perpétuité, le marché noir, l’absence de libertés, la surveillance tatillonne des comités de défense de la révolution (CDR), des milliers de détenus politiques, des morts en prison.
Le ras-le-bol d’une population privée de liberté s’est spectaculairement exprimé en avril 1980 : 125 000Cubains choisissent alors l’exode, soudain autorisé, vers les Etats-Unis. C’est l’atteinte la plus grave portée au prestige de Fidel depuis 1959. Autre coup dur, l’intervention américaine à la Grenade, en 1983, la reddition et la capture de centaines de travailleurs cubains : des « volontaires » pour la construction d’un aéroport, mais armés.
Adulé ou haï
Le prestige du castrisme a pu s’effondrer, sauf dans les milieux de la gauche latino-américaine, incapables, pour la plupart, d’analyser les causes et les conséquences de l’effondrement des régimes communistes en Europe de l’Est. La cote de Fidel est longtemps demeurée inchangée. Il a été adulé ou haï. Pendant un demi-siècle, il est resté une personnalité de poids sur la scène internationale, en dépit d’une situation interne qu’il qualifiait lui-même, dès 1986, d’« anarchique » et d’une politique étrangère interventionniste.
La taille alourdie, malgré un régime rigoureux, suivi après la suppression radicale de ses fameux cigares en 1985, la barbe blanchie, il a trouvé un interlocuteur privilégié en Hugo Chavez, président du Venezuela depuis 1999. Castro a donné à Cuba une importance hors de proportion avec sa taille et sa population. Il s’est inséré avec un aplomb phénoménal dans les querelles entre superpuissances, jouant de leurs rivalités. Il a connu ou affronté onze présidents américains, fréquenté presque autant de premiers secrétaires du Parti communiste de l’URSS. Mais il était plus à l’aise dans la tempête que dans la détente, plus fort pendant la guerre froide qu’à l’heure de la perestroïka.
Doyen des chefs d’Etat d’Amérique latine, il s’était fait, comme d’autres dirigeants de moindre envergure, le chantre de l’unification du sous-continent. « L’unité, l’unité, disait Bolivar, ou l’anarchie vous dévorera. » Un cri repris par Castro, qui développa sa réflexion sur le thème de la dette extérieure du tiers-monde. Le Cubain devint, pour un temps, « une conscience planétaire », note Jean-Pierre Clerc dans son Fidel de Cuba (Ramsay, 1988). Vers la fin, il ne réclamait plus la mort violente du pécheur capitaliste. Fidel faisait même profession, parfois, de vouloir sauver le capitalisme d’une « explosion sociale révolutionnaire », tout en réaffirmant qu’« un jour tous les pays du monde seront socialistes ».
« L’Histoire m’absoudra », affirmait Castro après l’affaire de la Moncada. L’Histoire jugera l’homme Fidel et sa révolution entachée de terribles violations des droits de l’homme, éclaboussée par les révélations sur les trafics en tout genre – à commencer par la drogue – décidés par Fidel lui-même pour regarnir les caisses vides de son régime. L’un des miracles de cette existence jamais en repos est qu’il ait si souvent échappé à la mort. Peu de dirigeants sur la planète ont pris autant de risques, se sont engagés sans réserve dans des aventures militaires scabreuses, ont été la cible de commandos au service d’opposants ou de la puissante CIA.
La baraka
La baraka. La chance l’a toujours accompagné, comme elle a accompagné un autre Galicien, le dictateur espagnol Francisco Franco, qui a toujours considéré avec une sympathie agissante ce fils d’émigrés gallegos, malgré l’éloignement de leurs idéologies. Fidel, né le 13 août 1926 à Biran, dans l’est de Cuba, a toujours revendiqué avec hauteur son ascendance espagnole. Au point de prétendre avoir le droit de vote aux premières élections démocratiques de juillet1977 en Espagne.
La désastreuse opération commando contre la Moncada ? « C’était une folie, une erreur tactique que je ne commettrais pas aujourd’hui », nous a déclaré Castro, bien plus tard. La chance, déjà. En fuite, Fidel est épargné par un lieutenant de l’armée qui pourchasse les insurgés survivants, un colosse noir nommé Sarria, qui a confié à Robert Merle : « On ne tue pas les idées. » Une chance insolente qui ne l’abandonna jamais, alors qu’il fut la cible de plusieurs dizaines de tentatives d’assassinat organisées par les services secrets américains. Aucun dirigeant, il est vrai, n’a été pendant si longtemps plus clandestin que Fidel. Pas de domicile fixe ou presque pendant plus de cinquante ans : autre record.
Amnistié, exilé au Mexique en 1955, il trouve des subsides aux Etats-Unis, rencontre Ernesto Che Guevara et se lie d’amitié avec lui. Après son débarquement près de la sierra Maestra, en 1957, on le croit mort ; il prépare son entrée en apothéose à La Havane, salué par l’opinion américaine. Le charme est rompu quelques jours plus tard par les exécutions de policiers de Batista, jugés en direct à la télévision. La période héroïque s’achève. Débute celle des crises, intérieures et extérieures.
Dès 1960, Washington commence à manifester son hostilité. John F. Kennedy donne son feu vert en avril 1961 à un débarquement d’anticastristes dans la baie des Cochons. L’opération tourne au désastre complet. Castro se proclame marxiste-léniniste. La dramatique « crise des fusées » de l’automne 1962 est une suite logique de cette mésaventure américaine. Elle a mis le monde au bord de la guerre nucléaire. On sait avec certitude aujourd’hui, d’après les Mémoires de Nikita Khrouchtchev, que Castro n’avait pas hésité à envisager froidement la troisième guerre mondiale, si c’était le prix à payer pour tenir tête aux Etats-Unis. Cet aveuglement avait stupéfié et irrité le dirigeant soviétique lui-même. « Nous avons le droit de penser par nous-mêmes » : cette formule des débuts, Castro la reprendra en 1988, pour justifier son refus de s’aligner sur la perestroïka lancée en URSS par Gorbatchev.
« Le parti est immortel »
Et après lui ? « Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, a-t-il affirmé en 1985. Après Fidel, il y aura des quantités de gens qui vaudront davantage que Fidel. Les hommes meurent. Le parti est immortel. » Pourtant, la débâcle des régimes communistes a frappé Cuba de plein fouet. La question insistante qui se posait dans toutes les chancelleries, à partir de 1986, était : combien de temps Castro pourra-t-il tenir, seul contre tous sur la scène extérieure et entouré d’adulateurs à l’intérieur ?
Certes, il n’a jamais eu de statues sur les places de l’île. Mais le Castro vieillissant a exercé un pouvoir absolu, un contrôle de tous les rouages. La mégalomanie était inévitable. « Je suis la révolution », disait Fidel en 1991. Et de continuer à proclamer ce slogan nihiliste : « Le socialisme ou la mort ! » A quoi les opposants irrévérencieux ajoutaient sur les murs de La Havane : « Quelle différence ? » Fidel a assumé avec donquichottisme ce rôle déplaisant du cancre obstiné de la perestroïka. Il s’est conduit comme le pire des dirigeants staliniens dans l’affaire Ochoa, ce général couvert de lauriers en Angola, accusé par le gouvernement de « trafic de drogue », condamné à mort et fusillé le 13 juillet 1989. La comédie sinistre des procès de Moscou, transplantée aux Caraïbes.
En août 1991, Fidel crut, l’espace de deux jours, que le sort allait lui être de nouveau favorable. Le coup d’Etat manqué des « conservateurs » du Kremlin fit reculer quelque temps le spectre de la fin de l’aide soviétique à l’économie cubaine aux abois. Puis Castro resta seul, face à une administration américaine déterminée à le laisser, dans la meilleure des hypothèses, « pourrir dans son coin », selon l’expression qu’utilisa le président George Bush père.
Mais Castro n’a voulu renoncer à aucun de ses principes, même s’il a dû accepter d’ouvrir le pays au tourisme – y compris sexuel – dans une tentative désespérée de faire entrer des devises. Le protecteur soviétique une fois disparu, qui aurait imaginé que Fidel parviendrait encore à maintenir, pendant plus de vingt ans, un pouvoir absolu sur son île ?