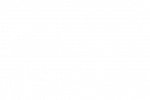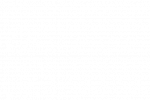Génocide au Rwanda : retour sur l’un des plus grands fiascos de la justice internationale

Génocide au Rwanda : retour sur l’un des plus grands fiascos de la justice internationale
Par Pierre Hazan
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui devait juger les responsables du génocide des Tutsis, a clos ses travaux en 2015, plus de vingt ans après les faits.
Ce fut le procès le plus long, le plus cher et sans doute le plus raté de la justice internationale. Il s’est clos il y a moins d’une année et a été un laboratoire d’erreurs, de dysfonctionnements et de comportements inadéquats du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), pour le plus grand drame des victimes. Voici l’autopsie d’un échec retentissant, au terme duquel la chambre d’appel a reconnu « le préjudice » subi… par les génocidaires.
La justice. Enfin ! Après tant de morts et tant de souffrances. C’est tout ce à quoi aspirait cette jeune femme originaire de Butare dans le sud du Rwanda. A 15 ans, cette adolescente avait perdu tous ses proches : une soixantaine de membres de sa famille, y compris sa grande sœur et ses parents, lors du génocide des Tutsis perpétré entre avril et juillet 1994. Elle-même n’avait survécu que par miracle. Alors, lorsque les enquêteurs du TPIR sont venus la trouver, elle a accepté de témoigner, y compris pour évoquer les multiples viols qu’elle avait subis.
La Cour lui promit que jamais son identité ne serait dévoilée et elle figure dans les procès-verbaux du TPIR sous le nom de « Témoin TA ». Son témoignage était en effet, crucial, car « TA » mettait directement en cause Arsène Shalom Ntahobali, 24 ans à l’époque des faits, le chef des milices interhamwe dans cette région. Arsène était le fils de Pauline Nyiramasuhuko, la ministre de la promotion féminine et de la famille (!) et, dans une tragique ironie, l’incitatrice en chef du génocide et de la campagne des viols dans la province de Butare.
Le procès s’est ouvert en juin 2001 au TPIR. Il se devait d’être exemplaire. C’était le plus grand procès jamais organisé par la justice internationale sur le génocide des Tutsis au Rwanda, l’équivalent d’un minitribunal de Nuremberg avec six personnes dans le box, accusées de divers chefs d’inculpation relevant du « génocide » et du « crime contre l’humanité ». Il y avait la ministre Pauline Nyiramasuhuko, son fils Arsène Shalom Ntahobali, deux maires, un préfet et un officier de police. Le procès devait démontrer comment, sous la houlette de la ministre de la promotion féminine, cinq hommes avaient mis en place et conduit le génocide dans cette province qui se refusait jusque-là à commettre l’irréparable. Le procès devait aussi démontrer le caractère systématique des viols, dont la plus basse estimation, selon le tribunal, se montait à 250 000 sur l’ensemble du Rwanda durant la centaine de jours que dura le génocide.
L’identité des témoins dévoilée
Mais le procès fut tout sauf exemplaire. Les dysfonctionnements se multiplièrent. Le premier couac fut la mise en danger des témoins, à qui pourtant le tribunal avait garanti l’anonymat. Ainsi, l’identité de « TA » fut dévoilée et sa vie aussitôt mise en péril. En 2003, dans le cadre du reportage pour ARTE et la Télévision suisse romande que je réalisais avec Gonzalo Arijon, Rwanda : une justice prise en otage, j’ai rencontré « TA ». Espérance, de son véritable prénom. Elle m’a amené dans la maison familiale où il ne restait que quelques pierres encore debout et m’a raconté comment sa vie a basculé lors de son retour du tribunal et le souvenir amer qu’elle garde de cette justice internationale : « Lorsque je suis revenue chez moi, mes voisins m’ont dit que je les avais trahis. Quand je m’endors la nuit, je ne suis pas sûre de me réveiller le matin. On peut venir ici te tuer n’importe quand », racontait-elle. Pendant des années, le gouvernement du Rwanda et le TPIR se sont renvoyé la responsabilité de la protection des témoins après leur déposition.
Puis, vint le deuxième dysfonctionnement, l’épisode le plus traumatisant pour Espérance et, à des biens des égards, l’un des plus scandaleux dans l’existence du TPIR : l’avocat kenyan Duncan Mwanyumba a conduit un contre-interrogatoire, dont les questions aussi déplacées que choquantes déclenchèrent les rires des trois juges, mais obligèrent néanmoins Espérance à y répondre. Duncan Mwanyumba demanda ainsi à Espérance combien de vêtements elle portait avant d’être violée, puis à quelle date elle avait pris un bain pour la dernière fois, laissant ainsi entendre qu’elle était aguicheuse mais trop sale pour être violée, lui demandant encore de préciser combien de fois Arsène Shalom l’avait violée, s’il était circoncis (voir l’extrait du documentaire Rwanda : une justice prise en otage)
Comble de malchance pour Espérance, son calvaire juridique est survenu au moment où le gouvernement rwandais voulait discréditer le TPIR car il redoutait que le procureur, après avoir enquêté sur les génocidaires, instruise les crimes de revanche commis par des proches du régime de Kigali. Les propos déplacés de l’avocat à l’égard d’Espérance constituèrent du pain bénit pour les autorités rwandaises, qui avaient largement matière à dénoncer le fonctionnement du tribunal. Ainsi, bien malgré elle, Espérance, qui ne voulait que la justice pour les siens, fut donc successivement mise en danger par le TPIR lorsque son identité fut dévoilée, puis retraumatisée par un contre-interrogatoire mené de manière aberrante et brutale, enfin, instrumentalisée dans un jeu politique qui ne la concernait en rien, et dont l’exposition publique des violences qu’elle avait subies détruisit le couple qu’elle était en train de construire.
Des génocidaires nourris et soignés
Au-delà du cas d’Espérance, le troisième dysfonctionnement du TPIR concerna des milliers de femmes violées qui survécurent au génocide. Certaines estimations indiquent que les deux tiers d’entre elles avaient contracté le sida lors de leur viol. Or les règles de la justice internationale avaient été élaborées par des juristes occidentaux sans tenir compte des réalités économiques et sociales d’un pays pauvre et dévasté par le génocide. D’où une situation absurde, où les accusés du TPIR bénéficiaient du droit à la santé dans une prison qui respectait soigneusement les règles internationales, alors que rien n’avait été prévu pour leurs victimes. Ainsi, les génocidaires violeurs et infectés par le VIH avaient droit à un traitement contre le sida ainsi qu’à une nourriture équilibrée, alors que leurs victimes – des veuves dans l’immense majorité – furent laissées à elles-mêmes, sans soins, essayant péniblement de survivre dans un pays qui tentait de se relever après la terrible épreuve du génocide.
Le quatrième dysfonctionnement fut l’exceptionnelle lenteur de la procédure juridique, y compris selon les standards de la justice internationale. Arsène Shalom Ntahobali et Pauline Nyiramasuhuko ainsi que les quatre autres accusés avaient été arrêtés entre 1995 et 1998, alors qu’ils se cachaient en Belgique, au Kenya et au Burkina Faso. Le procès des « Six de Butare » n’a commencé qu’en 2001 pour se terminer en 2011, avant qu’un jugement soit rendu et qu’il puisse faire appel. Les accusés ont ainsi passé une quinzaine d’années en détention préventive. Ce qui fit dire à Fausto Pocar, le président de la chambre d’appel du TPIR en décembre 2015, que le droit des accusés à être jugés « dans un délai raisonnable » n’avait pas été respecté. En conséquence de ce « préjudice », la cour décida de réduire la condamnation pour « entente en vue de commettre le génocide, génocide, extermination et incitation à commettre des viols » de la prison à vie à quarante-sept ans de détention pour Pauline Nyiramasuhuko et son fils, ainsi que pour un troisième accusé. Un quatrième a vu sa peine réduite et les deux derniers ont été libérés après une vingtaine d’années passées en détention provisoire.
Ni compensation, ni réparation
C’est ainsi que se clôtura en 2015 l’ultime procès du TPIR avant que celui-ci ferme définitivement ses portes. Un procès qui, par les erreurs commises, fut emblématique d’une justice internationale qui cherchait difficilement ses marques et qui, à sa décharge, n’avait pratiquement aucun précédent sur lequel s’appuyer. Au moment de la création de ce tribunal en 1994, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, créé une année plus tôt, tâtonnait lui aussi et la justice militaire des tribunaux de Nuremberg était bien loin. Comme le soulignait la procureure Carla Del Ponte dans Rwanda : une justice prise en otage. « Pour les victimes, cette justice est restée une abstraction. Elles devaient témoigner au tribunal devant les principaux responsables du génocide, qui étaient très bien soignés et nourris et vivaient dans une prison très agréable, alors qu’elles-mêmes, les victimes, n’avaient droit à aucune compensation ni réparation. Au bout du compte, elles estimaient que cette justice pour elles, était une injustice. »
Ce fut, en effet, le cher prix payé par Espérance et par bien d’autres victimes dans le lent et difficile processus de construction de la justice pénale internationale.
Pierre Hazan, conseiller éditorial de JusticeInfo.net, est professeur associé à l’université de Neuchâtel, en Suisse.