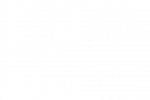En Gambie, comment faire croire à une démocratie et l’obtenir malgré soi

En Gambie, comment faire croire à une démocratie et l’obtenir malgré soi
Par Amaury Hauchard (Banjul, envoyé spécial)
Le dictateur Yahya Jammeh, au pouvoir depuis vingt-deux ans, a créé les conditions de sa chute à force d’aveuglement mégalomane.
« Dans les bureaux de vote qu’on a pu visiter, tout se passait pour le mieux : l’isoloir était isolé, les observateurs des trois camps étaient présents, et le calme régnait », explique Ben Udenski, membre de la société civile sud-africaine et l’un des 18 observateurs que l’Union africaine a pu dépêcher dans le pays pour la présidentielle gambienne. Jeudi 1er décembre, les Gambiens ont défait dans les urnes leur président autoritaire Yahya Jammeh lors d’un scrutin jugé par tout un chacun « libre et équitable », une situation inédite dans un tel régime.
Alors que Yahya Jammeh dirige d’une main de fer le pays depuis vingt-deux ans, la fin démocratique de son règne interroge. « Comment n’a-t-il pu rien prévoir pour rester au pouvoir ? », s’interrogeait ainsi le lendemain du vote Moussa, 19 ans, dans les rues de Banjul, n’y croyant toujours pas.
« Le roi qui défie les rivières »
« En Gambie, les jours de vote sont plutôt libres, c’est l’absence de démocratie sur le terrain en amont qui pose problème », analyse Niklas Hutlin, chercheur américain spécialiste de la Gambie à l’Université George Mason (Virginie). Depuis six mois, le président, candidat à un cinquième mandat, avait ainsi créé les conditions de sa réélection, qu’il imaginait comme un nouveau plébiscite extraordinaire de sa personne.
14 avril, à Serrekunda, deuxième ville du pays. « Notre parti, le Parti démocratique unifié [UPD, opposition], manifestait avec des panneaux appelant à une réforme du Code électoral, se souvient Moustapha Saidy, 22 ans, en exil aujourd’hui à Dakar, qui était présent à la manifestation. La police est venue et s’en est violemment prise à nous. Solo Sandeng, le secrétaire national du parti, a été emmené avec une dizaine d’autres manifestants, c’est la dernière fois qu’on les a vus. » Solo Sandeng décédera une semaine plus tard sous les coups des services de renseignement. Son corps n’a jamais été rendu à sa famille.
Deux mois plus tard, en juin, le régime multiplie par dix le montant à verser à l’Etat pour déposer sa candidature à la présidence, le portant à 25 000 dollars et exige 10 000 signatures de soutien alors qu’il n’en fallait que 500 auparavant. « Jammeh change les lois à sa guise de manière à ce que l’opposition ne puisse pas gagner », avançait, avant le scrutin, Sidi Sanneh, ancien ministre des affaires étrangères gambien, en exil aux Etats-Unis. Et il ne veut pas d’opposition forte contre lui, regardez ce qu’il a fait au Parti démocratique unifié. »
Outre les événements d’avril, l’UDP, principal parti d’opposition, a été totalement décimé. Fin août, son président, Ousainou Darboe, candidat malheureux à chaque élection contre Jammeh depuis sa prise de pouvoir par la force en 1994, est jugé avec trente autres membres du parti pour « manifestation illégale » après une marche pour demander la libération de Solo Sandeng, deux jours après que ce dernier avait été arrêté. Condamnés à trois ans de prison ferme, ils sont détenus dans les tristement célèbres geôles gambiennes de Mile 2, où finissent opposants politiques, journalistes et autres militants de droits de l’homme qui ont osé élever la voix contre « le roi qui défie les rivières » – l’un des titres officiels du président gambien.
Egocentrique et mégalomane
Cet emprisonnement, un de plus, du leader historique de l’UDP a été un tournant dans la vie politique gambienne. « A ce moment, on a compris qu’il fallait nous unir dans une coalition pour gagner, c’était le seul moyen », explique Ramzia Diab, ancienne députée de la majorité qui a rejoint l’opposition, soulignant que les anti-Jammeh ont toujours été convaincus que la « voie légale et démocratique » était la solution pour mettre fin à son régime. « Mais Jammeh ne croyait pas à ce rassemblement, il était sûr de gagner ces élections, comme celles d’avant », continue-t-elle.
Yahya Jammeh, prince de la personnification du pouvoir, est en effet convaincu que cette coalition ne pèsera pas dans les urnes, que les Gambiens comprendront, une fois encore, qu’il est le seul à pouvoir développer la Gambie. « En vingt-deux ans, vous avez vu ce que j’ai fait, vous avez maintenant un poste de police, un hôpital, une école. Tout ça grâce à moi », déclarait-il mardi en banlieue de Banjul, lors de l’un de ses derniers meetings de campagne.
L’homme est égocentrique autant que mégalomane : « J’ai purifié votre région des sorciers, il n’y en a plus un. Je leur ai demandé quel était ce paludisme qui ne tuait que des enfants. Ils en ont ri, je leur ai promis que, par le feu, je brûlerai le vent du paludisme et que plus aucun enfant ne mourrait de cette prétendue maladie. Aujourd’hui, rendons grâce à Dieu, il n’y a plus de sorcier à cause des prières que j’ai faites. »
Pour verrouiller le scrutin – pour lequel il ne voit qu’une seule issue : sa victoire –, Jammeh a refusé que l’Union européenne et la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) n’envoient leurs observateurs. Le jour du vote, les communications internationales et l’Internet ont été coupés, laissant craindre de possibles fraudes lors du dépouillement.
« Jammeh était convaincu que les tactiques qu’il avait déjà utilisées par le passé, comme son emprise sur le média d’Etat, le musellement des journalistes indépendants et l’emprisonnement de figures de l’opposition, suffiraient à conforter son avance dans les urnes, analyse Jim Wormington, chercheur à Human Rights Watch. Mais, si le système n’est pas équitable, les élections l’ont été, et l’opposition a su en profiter. »
Les soldats retirés des rues à l’annonce des résultats
Pêché d’orgueil. Durant la campagne, le président dictateur met à la disposition de sa mégalomanie tout l’appareil de l’Etat. Les bérets rouges lourdement armés de l’armée sécurisent des meetings conçus pour chanter la gloire de Jammeh tandis, que le candidat Barrow traverse les rues sans autre protection visible qu’une chaîne humaine de militants, un cordon de mains tendues pour éviter que ses milliers de partisans ne prennent d’assaut sa voiture.
Enfin, si l’armée a sécurisé la capitale durant le scrutin, les dizaines de soldats postés dans les rues se sont pour la plupart retirés à l’annonce des résultats. Pourquoi Jammeh n’a-t-il pas envoyé l’armée ? « La Gambie est petite, tout le monde connaît un soldat parmi ses proches, l’armée n’aurait jamais tiré sur ses frères », pense Adama, 18 ans. Des sources diplomatiques expliquent, elles, que des tractations ont eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi entre la présidence et certaines ambassades pour dissuader Yahya Jammeh d’utiliser la force.
Aujourd’hui, retranché dans le palais présidentiel, le président perdant a sans doute compris qu’il n’aurait pas dû mépriser son opposition ni organiser un scrutin dans les « vraies » règles. A vouloir créer un simulacre de démocratie, Jammeh a fini par en créer une, fière et sans égale.