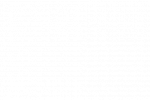La doctrine Obama s’en ira avec lui

La doctrine Obama s’en ira avec lui
Marquée par une conception de la puissance dans la retenue et la nuance, la « doctrine Obama » semble vouée à disparaître. Dans la course à l’investiture, ce sont des visions bien plus traditionnelles de la politique intérieure et extérieure des États-Unis qui s’affronteront, juge le politiste américain Nicholas Dungan.
Par Nicholas Dungan
D’ici un an exactement, le 20 janvier 2017, le prochain chef de l’exécutif des États-Unis d’Amérique prêtera serment sur les marches du Capitole à Washington DC. Qu’il s’agisse d’une présidente ou d’un président, sa politique étrangère se démarquera de celle de Barack Obama. L’Europe, et la France, doivent s’y préparer.
Durant les sept dernières années, la question a souvent été posée : y a-t-il une « doctrine Obama » ? La réponse est oui. Dès le discours marquant sa propre investiture, le 20 janvier 2009, Obama soulignait une grandeur américaine qui « doit être méritée », une politique reflétant « l’humilité et la retenue », une conception de la puissance qui « à elle seule ne peut nous protéger, ni ne nous autorise à agir à notre guise. »
La synthèse de la doctrine Obama se trouve dans l’allocution du président à West Point le 27 mai 2014 : ne pas recourir systématiquement à l’usage de la force armée ; lutter contre le terrorisme en partenariat avec d’autres pays ; renforcer l’ordre international, y compris en privilégiant l’action à travers des institutions multilatérales.
Une lecture du monde loin des traditions américaines
Cette doctrine, pourtant, ne s’est jamais traduite en une authentique stratégie. La sortie des troupes américaines de l’Irak et de l’Afghanistan, l’accord avec l’Iran, le rapprochement avec Cuba, le soutien à la COP21 ne compensent pas l’indécision continue d’Obama au Moyen Orient, l’échec du « reset » avec la Russie ou le « pivot » manqué vers l’Asie.
Le problème relève de Barack Obama lui-même car sa politique, externe comme interne, n’a jamais été réellement en phase avec les Américains. Élu pour son charisme, il a cru pouvoir gouverner par son charisme. Connaisseur de la Constitution des États-Unis, il n’avait aucune appréciation des rouages de la politique à Washington. Social-démocrate dans l’âme, il se situait très à gauche de l’Américain moyen. Hautain, intelligent, intellectuel, il dédaignait la bousculade et la familiarité, notamment auprès des membres du Congrès qui détiennent un pouvoir énorme dans le système américain.
Aucun des candidats actuellement en lice pour la nomination de leur parti ne partage la lecture du monde de Barack Obama. Le slogan sans programme de Donald Trump — « Make America Great Again » — revendique une Amérique musclée, exceptionnaliste, combative. Hillary Clinton, qui a passé ses quatre années à la tête de la diplomatie américaine à cultiver ses relations et son image à travers le monde, s’est vue décrite par le vice-président Joe Biden comme « une interventionniste ». Son analyse Realpolitik des relations internationales s’approche davantage de Kissinger que d’Obama. Donald Trump aura soixante-dix ans au mois de juin de cette année, Hillary Clinton en octobre de l’année prochaine : tous deux sont des purs produits de la génération des baby-boomers et de la guerre froide.
Vers le retour d’une politique américaine traditionnelle
De nombreux dirigeants politiques européens durant les récentes décennies ont préféré travailler avec des responsables américains « durs », les trouvant plus prévisibles. L’ennui aujourd’hui, au-delà de la question de la fiabilité des personnages de Donald Trump ou de Hillary Clinton, réside dans la multiplication des dysfonctionnements du système américain au dedans (éducation, santé, infrastructure, inégalités, institutions) et la réduction de la marge de manœuvre des États-Unis au dehors. L’arrivée au pouvoir d’un président dont la conception géopolitique s’inspire des États-Unis triomphants ne changera point ces réalités.
Bien au contraire, si les dirigeants outre-atlantique prennent leurs décisions à partir d’une vision mondiale jugée erronée ou vétuste à Paris, ou Berlin, ou Bruxelles, il en résultera des différences d’appréciation de plus en plus marquées, pour ne pas dire des différends tout court, entre Européens et Américains. Nous avons déjà vécu ce phénomène quand, en février 2015, Angela Merkel a dû se rendre à Washington pour s’opposer sur place aux Américains, dont certains, joyeux à l’idée d’une guerre froide ressurgie, appelant à une intensification de l’envoi d’armes à l’Ukraine.
Depuis sept ans, les Européens ont pu se trouver en harmonie profonde avec la doctrine de Barack Obama même si ses hésitations face à l’action ont provoqué remous et remords. La page va bientôt se tourner, vers un nouveau leader américain d’une trempe sans doute plus traditionnelle, mais dont la conviction concernant la place et l’action internationales des États-Unis peut surprendre. L’Europe, et la France, se doivent dès à présent d’élaborer leur propre conception de la bonne politique étrangère américaine de demain, d’entamer très rapidement des pourparlers avec leurs futurs homologues démocrates et républicains et de s’efforcer de maximiser leur influence et leur vision car, le 20 janvier 2017, la doctrine de Barack Obama s’en ira avec lui.
Nicholas Dungan est senior fellow à l’Atlantic Council à Washington DC et enseignant à Sciences Po Paris.