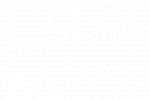Balade nocturne dans un « taxi-proxénète » de Casablanca

Balade nocturne dans un « taxi-proxénète » de Casablanca
Par Ghalia Kadiri (contributrice Le Monde Afrique, Casablanca)
De nombreux chauffeurs de taxi marocains mettent en contact prostituées et clients. L’activité est risquée dans un pays qui réprime durement prostitution et proxénétisme.
Des chauffeurs de taxi de Casablanca, en 2012, lors d’un mouvement social déclenché par la hausse du prix de l’essence. | ABDELHAK SENNA/AFP
Lahcen (le prénom a été modifié) écrase sa cigarette et avale son expresso d’un trait. Il est 23 heures, en cette nuit de janvier, c’est à son tour de conduire le petit taxi rouge qui vient de se garer devant la terrasse du café. La porte claque. Lahcen démarre et s’engouffre dans la nuit profonde de Casablanca.
On l’appelle le « taxi-fantôme ». A 54 ans, Lahcen n’est connu que sous des pseudonymes : « L’mikaniciane » en référence à son passé de garagiste, « L’mcharreg » à cause d’une cicatrice, longue et boursouflée, creusée dans sa joue gauche. Tous les soirs depuis vingt-quatre ans, il sillonne les rues de Casablanca dans la même Peugeot 205 délabrée, presque trop étriquée pour sa corpulence. « Je partage la voiture avec un autre taximan. Il assure le service de jour et moi de nuit », explique le conducteur d’une voix rocailleuse.
« Son coffre, c’est mon placard »
Ce n’est pas tout. Lahcen est aussi « coursier spécial » – il préfère décrire ses « extras » avec retenue. Prostituées, alcool, haschich. Le chauffeur de taxi achète, transporte, livre et dépose « tout ce que vous voulez » et « qui vous voulez ». Avec ses trois téléphones portables et une liste de contacts bien fournie, il a trouvé la parade pour s’assurer un salaire que la profession de taxi, trop contraignante et désormais concurrencée par les VTC, ne permet pas d’atteindre. « Les taxis ont peur d’Uber. Pas moi !, lance-t-il. J’offre des services qu’ils ne pourront jamais proposer. »
Ce vendredi soir, les gens sont nombreux à héler un taxi. Lahcen ne s’arrête pas. « L’mcharreg » a déjà entamé sa course folle vers le centre-ville. Le trajet est rythmé par les secousses de la voiture et les innombrables dos d’âne qui ont envahi la chaussée. A l’intérieur, les portières ferment difficilement et les manivelles des fenêtres ont été arrachées. L’état des freins est peu rassurant. Sous son verset du Coran suspendu au rétroviseur, Lahcen est imperturbable. Il écoute religieusement une cassette de la chanteuse égyptienne Oum Kalsoum, quand le ronronnement puissant du moteur ne couvre pas sa voix.
Finalement, la vieille Peugeot s’arrête devant un bar à chicha. Une jeune fille se tient devant l’entrée. Elle tire des affaires du coffre et s’installe à l’avant du taxi sans dire un mot. Chaque fois, c’est la même histoire. La prostituée appelle Lahcen, il la conduit chez le client, l’attend puis la ramène chez elle. « C’est elle qui trouve les clients, précise Lahcen. Certains taxi-proxénètes le font pour elles, mais moi je ne suis que l’intermédiaire. » Sur la route, la dénommée Sarah en profite pour enfiler une robe et se maquiller. « Son coffre, c’est mon placard », dit-elle en souriant, le visage transformé par plusieurs couches de fond de teint et un mascara débordant.
Après quatre années passées sur les trottoirs de la métropole, Sarah a rencontré Lahcen il y a deux ans. « Maintenant que j’ai des clients fidèles, il me conduit chez eux et assure ma sécurité », raconte la jolie brune de 22 ans. Pour sa prestation, elle demande 400 dirhams (37 euros) à son client, presque cinq fois plus qu’avant. « En plus, je n’ai plus à me battre avec les autres filles pour avoir le meilleur emplacement sur le trottoir. » Après la passe, Sarah donne 100 dirhams à Lahcen. Une somme qui n’a rien d’insignifiant, quand un taxi traditionnel gagne entre 100 et 150 dirhams par jour, après déduction des frais de location du véhicule et d’essence.
A la recherche de prostituées « clean » et majeures
Pas le temps de souffler : un autre habitué passe commande par téléphone. Cette fois, « on part à la chasse aux filles », annonce le pilote. Direction le boulevard d’Anfa. La nuit, sur cette grande artère du centre Casablanca, le racolage bat son plein. Des voitures s’arrêtent, puis s’évanouissent dans le noir à la recherche d’un refuge à l’abri des regards. Certains le font dans la voiture même. D’autres offrent un pot-de-vin aux taxis pour utiliser leur banquette arrière. « Ici, les prostituées sont très bas de gamme, explique le chauffeur. Il y a même des SDF. » La passe ne coûte pas plus de 100 dirhams, et la plupart acceptent de montants encore plus faibles.
Ce soir, Lahcen a pour mission de trouver des prostituées « plutôt clean » et « majeures » pour passer la soirée chez un client dans l’ancienne médina. Un gardien en blouse bleue lui indique un groupe de filles postées à l’entrée d’un célèbre hôtel sur le boulevard. Deux filles âgées de 19 ans et 23 ans acceptent de monter dans son taxi. A la fin de la course, le « coursier spécial » touche 300 dirhams.
Dans les meilleurs jours, ce petit commerce parallèle peut lui rapporter jusqu’à 800 dirhams les soirs de week-end, 200 ou 300 dirhams en semaine. « Ça marche jusqu’au jour où on se fait choper par les flics. » Souvent, ce sont les « indics » qui dénoncent. Vendeurs de cigarettes au détail, épiciers, concierges… Lahcen les soupçonne tous. « Du coup, on est obligés de leur graisser la patte », raconte le chauffeur. Les taxis se méfient aussi des multiples caméras installées sur les grandes avenues de la ville. « Dès qu’il y en a une nouvelle, on se fait passer le mot. Il faut aussi faire gaffe aux images filmées sur les téléphones, beaucoup se font prendre comme ça ! » Au Maroc, la prostitution et le proxénétisme sont passibles d’un à cinq ans de prison ferme et d’une amende de 5 000 à un million de dirhams (460 à 93 000 euros).
Optimiser les courses à tout prix
Peu importe les risques, Lahcen refuse de raccrocher. Il y a tout juste vingt-cinq ans, lorsqu’il réparait une voiture dans un garage de Mohammedia, au nord-est de Casablanca, l’ancien mécanicien y a laissé deux doigts. « Alors, je suis venu à Casa pour faire taxi », raconte-t-il. Cette ville de 4 millions d’habitants compte le plus grand parc du royaume, avec pas moins de 8 000 « petits taxis », un moyen de transport urbain accessible et largement utilisé. Seulement, la profession est soumise à un système d’agrément très strict, laissant peu de marge aux chauffeurs. Ces derniers versent 60 % à 70 % de leurs recettes quotidiennes à un détenteur d’agrément, à qui ils louent également le véhicule – au Maroc, très peu de chauffeurs sont propriétaires de leur taxi. Certains exigent même un « droit d’entrée », pourtant illégal, dont le montant peut atteindre une centaine de milliers de dirhams.
Souvent, deux chauffeurs se partagent une seule voiture, l’un travaillant le jour, l’autre la nuit. | Ghalia Kadiri
Tous les soirs, Lahcen donne 200 dirhams au propriétaire de la Peugeot, qui fait travailler deux chauffeurs pour le même taxi. « Sans les extras, je ne gagnerais pas grand-chose entre l’grima [« agrément »], l’essence et les frais d’entretien du véhicule. » Pas de retraite, pas de couverture sociale, les prix du carburant en hausse depuis 2007. Et la concurrence est rude depuis l’arrivée d’Uber en 2015, suivie d’autres applications de VTC. Le secteur, encore peu réglementé et très peu contrôlé au Maroc, profite surtout aux rentiers détenteurs des agréments. Les syndicats des taxis espèrent depuis longtemps une réforme qui n’est pas à l’ordre du jour. En attendant, les chauffeurs ont développé des subterfuges aux yeux de tous pour maximiser leurs gains : surtarification, extras et, malgré l’interdiction, les petits taxis font tous du covoiturage pour optimiser la course.
A Casablanca, passé une certaine heure, il est plus facile de trouver du haschich que de l’alcool. | Ghalia Kadiri
Il est 5 heures du matin quand Lahcen prend ses derniers passagers à la sortie d’un cabaret sur la corniche. Fin de service. Du moins ce devait l’être. Son vieux Motorola à clapet sonne : un client a soif. Une mission impossible au Maroc, où la vente de spiritueux, officiellement réservée aux étrangers, s’arrête à 20 heures. Mais passés les horaires légaux, des guerrab (« vendeurs d’alcool sans autorisation ») assurent la relève. Dans un quartier de Casablanca célèbre pour la contrebande, Lahcen vérifie que la bouteille de whisky est bien fermée. « Parfois, ils le mélangent avec du thé, dit-il en démarrant le taxi. A cette heure-ci, c’est beaucoup plus facile de se procurer du haschich que de l’alcool d’origine », sourit-il derrière sa moustache.
Le coursier ne refuse aucune commande, « sauf les drogues dures », assure-t-il. Ce qu’il ne veut pas, dit-il, « c’est se faire prendre et risquer de tout perdre ». Ses économies, sa santé, sa famille. Mais ce n’est pas la police qui l’inquiète. « Depuis quelques mois, une bande de taxis me menace. » Les khataffa, ces transporteurs clandestins qui font la loi dans certains quartiers et empêchent les taxis d’y circuler, voient les activités de « L’mcharreg » d’un mauvais œil. « Et eux, ils me font peur », lâche Lahcen à 7 heures du matin, avant de rejoindre enfin sa femme et ses deux filles.