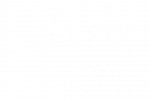Romans, nouvelles, essais : la sélection du « Monde des Livres »

Romans, nouvelles, essais : la sélection du « Monde des Livres »
Par Raphaëlle Leyris, Florence Noiville, Macha Séry, Julie Clarini, Philippe Pons (Tokyo, correspondant)
Chaque jeudi, La Matinale vous propose ses coups de cœur littéraires du moment.
LA LISTE DE NOS ENVIES
Besoin d’entraînement avant l’ouverture du Salon du livre, vendredi 24 mars ? La Matinale vous met en appétit avec une sélection de cinq ouvrages.
AUTOBIOGRAPHIE. « Endetté comme une mule », d’Eric Losfeld
Il avait une haute exigence littéraire, des convictions chevillées au corps et le poing leste lorsqu’il s’agissait de régler son compte à un fâcheux. Eric Losfeld (1922-1979) fut un éditeur intransigeant, sans compromis pour « l’indivisible liberté ». Que ce fût chez Arcanes, qu’il fonda en 1951, ou aux éditions du Terrain vague, lancées en 1955, il n’a, disait-il, publié que ceux qu’il estimait : surréalistes, poètes, libertins, oulipiens.
Pénurie de papier, faillites, perquisitions, saisies, procès… Les déboires qu’il eut à surmonter n’amoindrirent jamais son amour du livre. Parues quelques semaines avant sa mort, ses Mémoires ont conservé un ton incroyablement revigorant. Car durant près de quatre décennies, l’édition a été pour Eric Losfeld une extension du domaine de la lutte.
Ce libertaire menait combat. Contre le racisme, le colonialisme (il cosigna la Déclaration sur le droit à l’insoumission, dit « Manifeste des 121 »), la pudibonderie, les restrictions du régime gaulliste vis-à-vis de la liberté d’expression. Le catalogue des écrivains (Sade, Queneau, Ionesco, Jarry, Benjamin Péret, etc.) qu’il a édités reste exceptionnel. Macha Séry
« Endetté comme une mule », d’Eric Losfeld, Tristram, « Souple », 311 pages, 11,40 €.
NOUVELLES. « Des hommes sans femmes », d’Haruki Murakami
Grand amateur de littérature américaine, Haruki Murakami adresse ici un clin d’œil au Men Without Women d’Ernest Hemingway (1927). Fragiles et solitaires, les personnages abandonnés et meurtris de ces nouvelles sont habités par le vague à l’âme qui sourd d’une attente amoureuse sans issue.
Jouant de la légère et envoûtante musique de la mélancolie, l’auteur explore avec finesse ces moments où « les couleurs de la solitude vous pénètrent le corps ». Il entraîne le lecteur dans les arcanes de l’âme, et ce qu’il nomme le « second sous-sol » que chacun porte en lui. Ici, pourtant, ce ne sont pas les femmes qui attendent stoïquement les hommes.
Renversant ce cliché si prégnant dans la tradition littéraire et la peinture japonaises, Murakami exprime une solitude d’une nature plus cachée mais non moins profonde. Comme celle de cet homme réveillé en pleine nuit par le mari de son amante qui lui apprend au téléphone le suicide de cette dernière. C’est d’ailleurs cette nouvelle (« Des hommes sans femmes ») qui donne son titre au recueil. Peut-être parce qu’elle contient le constat le plus grave que puisse faire cet homme : « Perdre une femme signifie aussi qu’on a perdu toutes les femmes. » Philippe Pons
« Des hommes sans femmes » (« Onna no inai otokotachi »), d’Haruki Murakami, traduit du japonais par Hélène Morita, Belfond, 304 pages, 21 €.
ROMAN. « Le Fou du roi », de Mahi Binebine
Peintre internationalement reconnu et écrivain couronné de nombreux prix, Mahi Binebine vient, selon ses propres termes, d’une famille marocaine totalement « shakespearienne ». Pendant trente-cinq ans, de 1965 à 1999, son père a été le bouffon d’Hassan II.
Par « bouffon », il faut entendre homme de culture. Un personnage qui fait rire certes, mais qui est aussi un intellectuel au service du monarque. Vie de cour, grâce et disgrâce, flagorneries et génuflexions : de cet emploi à hauts risques, le père se tire plutôt bien… jusqu’en 1971. « Jusqu’à ce coup d’Etat inratable et pourtant raté. Jusqu’à ce que l’on découvre surtout que mon frère était parmi les mutins ! »
Surprise. Epouvante. « Mon père était alors caché avec le roi, tandis que mon frère arpentait le palais les armes à la main… » C’est ce drame familial et ses terribles conséquences que Mahi Binebine raconte ici. Une histoire dont il a mis longtemps à se délivrer. Une histoire qui a presque la profondeur et la portée d’un mythe antique. Florence Noiville
« Le Fou du roi », de Mahi Binebine, Stock, 176 pages, 18 €.
ESSAI. « Le Triomphe de l’artiste », de Tzvetan Todorov
C’est un livre posthume et pourtant doué de vie, empli de cette souplesse qu’avait la pensée de Tzvetan Todorov. D’ailleurs, l’écrivain et philosophe disparu le 7 février y parle de lui, de son enfance en Bulgarie et de sa passion de lycéen pour les artistes russes.
Ce détour suggère l’origine du livre et l’interrogation qu’il porte : qu’ont fait ces artistes qu’il admire pendant le régime soviétique ? Sous sa plume, cette question sur les liens entre l’art et la révolution n’a rien d’abstrait : Todorov restitue les vies, les passions, les refus et les accommodementss d’une génération d’écrivains qui fut témoin de la révolution d’octobre 1917 : Boulgakov, Maïakovski, Pasternak, Tsvetaïeva… et surtout le peintre Malevitch.
Une simple et belle galerie de portraits ? Ce serait mal connaître l’auteur : la « déshumanisation » en cours dans nos démocraties l’inquiète ; elle lui rappelle de bien mauvais souvenirs et, comme jadis en Union soviétique, convoque les consciences à la résistance. Julie Clarini
« Le Triomphe de l’artiste », de Tzvetan Todorov, Flammarion/Versilio, « Documents et essais », 332 pages, 20 €.
ESSAI. « Rouvrir le roman », de Sophie Divry
A mi-chemin de son essai Rouvrir le roman, Sophie Divry rappelle en quels termes Virginia Woolf combattait l’idéologie littéraire conventionnelle de son temps : « On nous donne une petite boîte de jouets, et l’on nous dit : “Vous ne devez jouer qu’avec ceux-là.” Il faut avoir le courage de jeter la petite boîte par la fenêtre. » Rouvrir le roman a quelque chose d’une boîte à outils pour que chacun puisse fabriquer ses propres jouets, à volonté.
S’élevant contre l’idée que le roman serait « contraignant, compromis, pauvre, forcément narratif, vulgaire ou corrompu », Sophie Divry s’attelle ici à démonter un certain nombre de préjugés. Peut-on écrire un roman quand on n’est porté ni sur les personnages ni sur l’intrigue ? A-t-on encore le droit d’utiliser le passé simple ? « Le public est-il sale ? » « Le sens est-il sale ? » Sophie Divry se confronte à ces questions et à d’autres plus précises, sur le jeu avec la typographie, la manière d’introduire des dialogues… Le tout en s’appuyant sur quelques-uns de ses héros, de Virginia Woolf à Edgar Hilsenrath, en passant par Nathalie Sarraute ou le génial Raymond Federman.
Plaidant pour une recherche formelle qui ne serait pas simple volonté d’« en mettre plein la vue », mais de « mettre à jour cette matière sensible qui nous échappe », Sophie Divry signe avec Rouvrir le roman un très stimulant précis de liberté. Raphaëlle Leyris
« Rouvrir le roman », de Sophie Divry, Noir sur blanc, « Notabilia », 208 pages, 14 €.