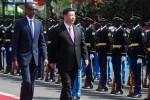« Nous, humanitaires, n’offrons pas une réponse durable aux crises alimentaires »

« Nous, humanitaires, n’offrons pas une réponse durable aux crises alimentaires »
Propos recueillis par Bruno Meyerfeld (Nairobi, correspondance)
Pour Peter Hailey, expert des crises alimentaires et directeur d’un think tank à Nairobi, les famines d’aujourd’hui ne sont pas causées par le climat, mais sont « à 100 % d’origine humaine ».
Un enfant de 11 mois reçoit un traitement contre la malnutrition à Borama, au Somaliland. | Andrew Renneisen pour "Le Monde"
Selon les Nations unies, 20 millions de personnes sont menacées de famine au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. L’ONU a qualifié la situation de « plus grande crise humanitaire » depuis 1945.
Peter Hailey est le directeur du Centre pour le changement humanitaire (CHC), un think tank établi à Nairobi. Expert des crises alimentaires, il a travaillé pendant plus de deux décennies dans le secteur humanitaire et de la nutrition en Afrique, en Asie centrale et dans les Balkans. Selon lui, la communauté internationale doit aujourd’hui adapter ses méthodes pour faire face au risque de famine afin de ne pas reproduire les erreurs produites en 2011, lorsque 260 000 personnes étaient mortes de faim en Somalie.
Que pensez-vous des déclarations alarmistes de l’ONU ?
Peter Hailey : Ces déclarations sont nécessaires pour mobiliser l’opinion publique mais devraient être plus nuancées. A long terme, elles peuvent avoir des conséquences néfastes. Car que dira-t-on lors de la prochaine crise alimentaire ? Qu’elle est pire que la précédente ? Ou la pire « de tous les temps » ? On risque de perdre toute crédibilité si on simplifie trop la situation.
Par ailleurs, parler d’un bloc homogène de 20 millions de personnes en détresse n’a aucun sens. Toutes ces personnes ne font pas face au même risque de famine. Les situations varient beaucoup selon les pays, avec des populations plus ou moins vulnérables. Car quoi de commun entre le Nigeria et le Yémen ? Entre le nord et le sud de la Somalie ? Selon les pays et les régions, la sécheresse n’aura pas le même impact.
Cependant, il faut rester mobilisé. On l’a vu en 2011 en Somalie : deux ou trois semaines suffisent pour perdre le contrôle de la situation et pour que la mortalité explose. Il faut être prêt à toutes les éventualités.
Justement, la communauté internationale a-t-elle tiré les leçons de la famine somalienne de 2011-2012 ?
Cela dépend sur quel plan. En 2011, l’état de famine avait été déclaré bien trop tard par l’ONU : en juillet, alors que plus de 130 000 personnes étaient déjà mortes. La communauté internationale était très hésitante à intervenir et avait peur que l’aide humanitaire se retrouve détournée par le groupe djihadiste Al-Chabab.
Aujourd’hui, en 2017, on n’a heureusement pas reproduit cette erreur : l’alerte a été donnée plus tôt, dès février. On peut raisonnablement penser que la situation de 2011 ne se reproduira pas, même si une partie du travail qui est fait aujourd’hui aurait déjà dû être réalisé en 2016, avec des transferts massifs d’argent vers les plus vulnérables, des livraisons d’eau vers les points stratégiques, une évaluation de l’impact de la sécheresse sur les populations, etc.
Qu’est-ce qu’il reste à améliorer ?
D’abord, nous, les humanitaires, nous n’offrons pas de réponse durable aux crises alimentaires. Pour prévenir efficacement une famine, il faut pourtant réaliser du travail de long terme en amont : renforcer les sociétés civiles et les autorités locales, mettre en place des mécanismes à grande échelle d’assurance, notamment pour le bétail, et créer des dispositifs de prévention efficaces, comme par exemple des transferts d’argent réguliers vers les populations les plus vulnérables.
Ensuite, je crois qu’on a encore trop en tête l’image d’Epinal de l’humanitaire avec un sac de riz sur le dos, type Kouchner en Somalie [en 1992]. Il faut moderniser cette approche, promouvoir le transfert d’argent par mobile banking, plus efficace que la distribution traditionnelle de vivres. Il faut aussi insister davantage sur la place de l’eau dans la réponse humanitaire, notamment dans les zones les plus affectées par la sécheresse en Afrique, comme la Somalie ou le Sahel. Celle-ci est aussi importante que la nourriture sur bien des aspects, notamment dans l’alimentation, mais aussi pour le bétail, l’hygiène et la santé. A quoi ça sert d’avoir un sac de riz si on ne peut pas le cuire ?
Pourquoi y a-t-il encore des famines en 2017 ?
Contrairement à ce qu’on peut penser, le nombre de famines a énormément baissé ces vingt dernières années. En dehors de l’Afrique, la dernière grande famine en date est celle de la Corée du Nord dans les années 1990. Sur le continent africain, on observe le même phénomène de forte diminution par rapport à ce qu’on a pu connaître au XXe siècle.
Aujourd’hui, une chose est claire : les famines ne sont pas causées par le climat ou la sécheresse. Elles sont à cent pour cent d’origine humaine. Les famines ne sont pas dues à l’absence de nourriture, mais aux difficultés d’accès pour les populations à celle-ci à cause de décisions ou d’inaction politiques.
Mais, en Afrique comme ailleurs, les gouvernements se sentent de plus en plus responsables de leurs populations. Bon gré ou mal gré, ils savent qu’une famine peut remettre en cause la légitimité de leurs pouvoirs et se sentent forcés de réagir. L’Ethiopie est ici un exemple remarquable. Prenez les sécheresses de 1984 et de 2016, qui étaient comparables dans leur intensité : dans le premier cas, 400 000 Ethiopiens sont morts de faim.
Dans le second, on a réussi à endiguer la crise. Pourquoi ? Parce que le gouvernement éthiopien sait qu’une famine généralisée remettrait en cause sa légitimité et a mis en place avec le soutien de la communauté internationale un système efficace de prévention, incluant assurance sur le bétail et transfert d’argent. Cela prouve qu’avec la volonté politique, on peut lutter efficacement contre la famine.
#Famine : journée spéciale sur Le Monde. fr
Le Soudan du Sud s’est déclaré en situation de famine le 20 février et trois autres pays – le Nigeria, la Somalie et le Yémen – pourraient suivre dans les prochaines semaines, selon les Nations unies qui estiment à plus de 20 millions le nombre de personnes exposées : 7,3 millions au Yémen, 6,1 millions (dont 100 000 déjà touchés) au Soudan du Sud, 5,1 millions au Nigeria, 2,9 millions en Somalie.
Il s’agit de « la plus importante crise humanitaire depuis la seconde guerre mondiale », toujours selon l’Organisation des Nations unies (ONU), qui a réclamé 4,4 milliards de dollars d’ici à juillet pour prévenir « une catastrophe ».
Plus que la sécheresse, les conflits sont la cause directe de cette situation. Insurrection du groupe djihadiste Boko Haram, qui déstabilise toute la région du lac Tchad ; terrorisme des Chabab, en Somalie ; guerre civile au Soudan du Sud entre les forces légales du président, Salva Kiir, et l’ancien vice-président Riek Machar ; coalition internationale au Yémen dirigée par l’Arabie saoudite contre la rébellion houthiste.
Partout, les associations humanitaires et les agences onusiennes rencontrent des difficultés pour se déployer sur le terrain et organiser la distribution de l’aide. Les fonds manquent aussi à l’appel. Jusqu’à présent, seuls 10 % des sommes réclamées ont pu être collectées.
Tout au long de la journée du 28 mars, nous vous proposons d’échanger sur ce thème. Des experts de l’Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA – « Bureau de la coordination des affaires humanitaires »), l’agence de coordination des affaires humanitaires des Nations unies seront mobilisés pour expliquer les « plans de réponse » élaborés dans ces quatre pays pour faire face à la famine et les obstacles à leur mise en œuvre.
- 10 h 30 : Pourquoi la famine est un phénomène politique ? Tchat avec Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières.
- 12 heures : Facebook Live avec Stéphane Foucart, journaliste au Monde, spécialiste du climat sur le thème : Comment le changement climatique exacerbe les conflits.
- 14 h 30 : Tchat avec Bruno Meyerfeld, correspondant du Monde au Kenya et envoyé spécial en Somalie.