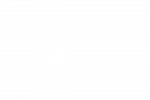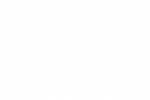Paul Rondin : « Le mécénat est le cheval de Troie des groupes privés »

Paul Rondin : « Le mécénat est le cheval de Troie des groupes privés »
Propos recueillis par Fabienne Darge
Le bras droit d’Olivier Py au Festival d’Avignon s’inquiète de la récente montée en puissance du privé dans le spectacle vivant.
Paul Rondin, directeur délégué du Festival d’Avignon. | CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON
Paul Rondin est, au Festival d’Avignon, le bras droit d’Olivier Py, avec le titre de directeur délégué. Comme beaucoup dans le théâtre public, il s’inquiète de la récente montée en puissance du privé dans le spectacle vivant, et d’un certain abandon du terrain par la puissance publique.
Dans le domaine du spectacle vivant, le privé intervient-il principalement sous la forme du mécénat ?
Pas uniquement. Je dirais plutôt que le mécénat serait le cheval de Troie : il a permis à des groupes privés de mettre un pied très honorable dans la culture – certains avec une vraie démarche socio-culturelle. Je n’ai rien contre le mécénat, nous y faisons appel à Avignon et nous sommes bien contents de ces apports. Cela n’empêche pas que la question du service public se pose. Et que l’on doit se demander pourquoi certaines fondations ou mécènes investissent depuis quelque temps le champ du spectacle vivant. Dans les arts visuels, on peut comprendre : c’est un vrai marché, et c’est assumé. Mais pourquoi ce besoin de visibilité de certains groupes ?
A qui pensez-vous ?
Fimalac est à mon sens le cheval de Troie par excellence. Leur Fondation Culture & Diversité est tout à fait respectable, et a fait des choses formidables pour les jeunes qui en ont bénéficié. Mais d’emblée, j’ai trouvé étrange que cette fondation se montre à ce point dans les lieux de spectacle vivant. Et on s’est aperçu assez vite qu’en parallèle, une fois la crédibilité acquise grâce à la fondation, il y avait derrière une vraie construction, une vraie stratégie industrielle, qui en plus est redoutable, car elle est verticale : l’activité va de l’édition à la billetterie – de l’origine même du spectacle, sa production, à sa diffusion et son exploitation.
Pouvez-vous détailler ce processus ?
Quand des groupes – je pense aussi à ventesprivées.com – commencent à s’intéresser fortement à la billetterie, on peut penser qu’à terme, ils ne vont pas s’en contenter. Et effectivement : on s’aperçoit qu’ils achètent aussi des salles, et qu’ils produisent des artistes qu’ils font tourner. Tout alimente tout. Et ce processus va plus loin quand ils commencent à s’intéresser aux Délégations de service public (DSP), et notamment aux théâtres de villes. Ces groupes proposent un service, et tout à coup on privatise, de manière contractuelle et momentanée, ce qui revenait à un service municipal, départemental, régional ou national.
Ils proposent une offre qui peut être de qualité, mais dont on peut soupçonner qu’elle soit alimentée par le même groupe qui gère la salle. Et ces salles, qui préservaient de l’emploi et un savoir-faire aux niveaux technique et administratif, et en matière de production et d’accueil du public, sont alors souvent vidées des gens qui les faisaient vivre, au profit d’une machine qui arrive, fait de la pure prestation de service, et repart. C’est le cas des Zéniths en région, qui ne sont déjà plus des salles vivantes. Il faut faire très attention à ce que tous ces théâtres qui forment une vraie richesse sur le territoire français ne se mettent pas à présenter tous la même chose, et à devenir des garages.
Cette stratégie est-elle déjà sensible au niveau du Festival « off » d’Avignon ?
Pour le moment, je n’ai pas connaissance de salles qui auraient été rachetées en tant que telles. Mais on sent bien qu’il y a un appétit, une envie, que des gens se renseignent. On sait très bien que le « off » n’est plus la belle utopie soixante-huitarde de la liberté, mais un grand marché non régulé du spectacle vivant. Et comme tout grand marché non régulé, il ne bénéficie pas à une concurrence qui pourrait permettre à tout un chacun de s’exprimer, mais au contraire, il attise les appétits industriels.
Qu’est-ce qui a changé en quelques années ? On sait que jusqu’à il y a peu, le spectacle vivant, et surtout le théâtre, n’intéressait pas les mécènes et les industriels…
Ce qui a changé, c’est que les industriels produisent eux-mêmes les spectacles. Comme ils contrôlent la chaîne de bout en bout, ils peuvent avoir une rentabilité. Je suis étonné, d’ailleurs, que l’on n’analyse pas plus loin cette histoire de Penelope Fillon qui aurait écrit dans une prestigieuse revue culturelle…
Je vais prendre un autre exemple, dont personne ne parle, parce que cela se passe en Afrique. Le groupe Bolloré est en train de construire partout en Afrique de l’ouest des salles polyvalentes spectacle-cinéma-musique. Or Bolloré, c’est aussi Vivendi, et Universal Music. CQFD.
Je n’ai rien contre le privé, et je n’ai aucun problème avec le business. Je suis moi-même un marchand, je vends des billets. Mais je crois qu’il faut être conscient qu’il se passe quelque chose de nouveau, et qu’il faut bien observer dans sa totalité un paysage dont on essaie de ne nous montrer qu’un tout petit morceau.
Cette montée en puissance du privé est-elle révélatrice d’un certain délaissement du politique ?
C’est certain. Il y a actuellement en France un désintérêt sidérant des élites politiques et médiatiques pour la culture. Le milieu politique, à de rares exceptions près, semble ne se souvenir de l’éducation et de la culture que lorsque se produit un attentat. On est aujourd’hui dans une période de vraie transformation économique et industrielle. Il ne faut pas forcément en avoir peur. Simplement, ce qui est quand même un peu inquiétant, c’est que l’idée même d’une politique de la culture, publique, est tellement invisible, qu’il y a une place à prendre. Et certains l’ont bien compris. Quand on s’en apercevra, il sera peut-être déjà trop tard.
On vous rétorquera que si le privé prend une place croissante, c’est largement en raison des baisses de crédits. Comment continuer les missions de service public avec des budgets en baisse ?
C’est une question de choix politique. Pourquoi ne pas fermer des collèges et des lycées parce qu’on n’a pas assez d’argent, pendant qu’on y est ? On peut toujours ne plus financer l’éducation et la culture : à l’arrivée, c’est un désastre. Mais je crois que c’est aussi à nous, opérateurs culturels, de trouver des solutions économiques. Je ne dis pas que c’est facile : le théâtre, ça n’a jamais été une partie de jackpot. Mais si on n’est pas un peu aventurier, il faut faire autre chose. Et surtout, avant de parler d’argent, parlons du projet : de la politique publique de la culture que nous voulons mener sur le terrain. L’économie du spectacle vivant a toujours été difficile, elle le sera encore, mais pour le moment, on a quand même des moyens pour produire.
Y a-t-il un problème de culture, justement, de transmission, sur les missions du service public ?
Il faut bien dire qu’il y a eu, notamment au niveau local, une forte démission du politique, et un glissement vers le divertissement. Je n’ai rien contre le divertissement, mais il faut savoir ce qu’on fait, et ne pas le confondre avec les œuvres de l’esprit. Un tourneur de one-man-shows, c’est plus intéressant pour un adjoint à la culture qui veut offrir du divertissement à ses administrés. Mais c’est aussi un échec de la politique culturelle, que de considérer que le théâtre ne doit servir qu’à détendre les spectateurs. Je ne dis pas qu’on doit embêter les gens. Mais on voit bien que la recherche du déplacement, du frisson, ce n’est pas ce qui habite le monde politique actuel.
N’est-ce pas là un résultat paradoxal de la décentralisation mise en place il y a soixante-dix ans ?
Un résultat de la délégation absolue du culturel à des opérateurs professionnels, oui, sur les trente dernières années. On a tout professionnalisé, en mettant beaucoup d’argent, et bravo à François Mitterrand et à Jack Lang de l’avoir fait. Mais, du coup, l’Etat a pu déléguer à ces directeurs d’institutions ce qui aurait dû être aussi sa politique culturelle à lui. Ce n’est pas forcément grave dans les villes qui ont les moyens d’avoir une grosse structure comme un centre dramatique national ou une scène nationale. Mais dans les moyennes ou petites villes où il n’y a pas d’institution, comme il n’y a plus de culture et de transmission du savoir-faire de la politique culturelle, les choses se délitent. On voit arriver de nouveaux élus qui, tout simplement, ne savent pas comment ça marche.
La décentralisation, ce n’est pas la délégation à des opérateurs semi-publics, c’est l’égalité d’accès à la culture pour tous sur tout le territoire. Si on détricote ce maillage patiemment construit, cela aura des conséquences importantes. Tous ces opérateurs culturels font, sur le terrain, un travail bien plus important que les politiques pour retisser du lien social. C’est une réalité, qu’il suffirait d’encourager et de soutenir. Mais beaucoup de nos politiques préfèrent se méfier, et exclure. Moi je ne crois pas que le réseau subventionné en France soit un problème, je pense au contraire qu’il est une solution.