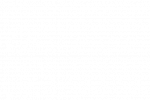Berkeley, le nouveau ring où s’affrontent « l’alt-right » et les « antifas »

Berkeley, le nouveau ring où s’affrontent « l’alt-right » et les « antifas »
Par Corine Lesnes (Berkeley, envoyée spéciale)
Depuis cent jours, partisans et adversaires de Donald Trump croisent le fer au nom de la liberté d’expression dans l’université californienne.
Une nouvelle manifestation a eu lieu sur le campus de l’université de Berkeley, en Californie, jeudi 27 avril. | Marcio Jose Sanchez / AP
Difficile de faire plus symbolique. Depuis le 20 janvier et l’investiture de Donald Trump, l’extrême droite et l’extrême gauche ont choisi le campus de Berkeley, en Californie, pour leur affrontement idéologique – et de plus en plus physique. C’est là qu’est né, en 1964, le mouvement du « free speech » qui, après quatre mois d’occupation étudiante, a imposé le droit à la liberté d’expression dans les universités américaines.
Cette fois, ce sont les conservateurs qui revendiquent le « free speech », et à Berkeley-même, sachant que l’extrême droite est tout sauf bienvenue dans une ville qui est l’une des plus progressistes du pays. En cent jours, on a recensé trois journées d’affrontements, qui ont fait six blessés et des dégâts estimés à plusieurs centaines de milliers de dollars.
Jeudi 27 avril, une nouvelle manifestation de plusieurs centaines de personnes dans chaque camp, séparées par un cordon de policiers en tenue anti-émeutes, a conduit à une dizaine d’arrestations.
« Violence et perturbations »
« Le campus est devenu un aimant pour les groupes qui cherchent à utiliser le berceau du mouvement du “free speech” comme une scène pour semer violence et perturbations », a déploré le président de l’université, Nicholas Dirks, dans une tribune publiée jeudi par le New York Times.
Berkeley n’est plus le bastion « gauchiste » de l’époque du combat contre le maccarthysme. C’est un campus énorme, qui compte 36 000 étudiants et 2 000 enseignants. Les frais de scolarité s’élèvent à quelque 30 000 euros par an pour les résidents de Californie (45 000 euros pour les autres). Près de 20 % des étudiants sont d’origine étrangère.
A deux semaines de la fin des classes, les étudiants sont occupés à leurs examens de fin d’année. « Le campus est plutôt résilient », souligne Nicholas de Montchaux, le directeur du centre des nouveaux médias de la faculté de journalisme. Mais la confrontation commence à prendre des proportions qui rappellent les affrontements gauche-droite de la fin des années 1960.
Des invités très controversés
Tout a commencé le 1er février lorsque le club des étudiants républicains s’est mis en tête d’inviter le très controversé Milo Yannopoulos, éditorialiste au site Breitbart News, pour présenter son livre, Dangerous, à l’université. Les incidents, provoqués par des agitateurs masqués – en marge de la manifestation d’étudiants proclamant que le « discours de la haine n’a rien à voir avec la liberté d’expression » –, ont fait plus de 100 000 dollars de dégâts sur le campus. « Milo » a dû être escorté par la police, sans avoir pu prononcer son intervention. Depuis, il a démissionné de Breitbart News, sous l’accusation d’avoir tenu des propos pédophiles.
Le club des républicains a récidivé mi-avril en annonçant avoir invité pour le 27 une autre figure incendiaire, Ann Coulter, une ancienne avocate devenue l’égérie de la droite anti-immigration qui se décrit elle-même comme « une conservatrice pleine de préjugés » mais « avant tout chrétienne ». Mission : tester les limites du « free speech ».
« C’est seulement en invitant des provocateurs que nous générons un dialogue sur l’ensemble du campus », a justifié le président du groupe, Naweed Tahmas, un étudiant de 20 ans. Un groupe dit BridgeCal, dont l’ambition est de servir de « passerelle entre les extrêmes », s’est joint à l’invitation.
La direction a d’abord autorisé l’événement, au nom de la liberté d’expression – un principe que Donald Trump lui avait rappelé après l’annulation de l’intervention de « Milo », sous la forme d’un tweet menaçant de priver le campus de fonds fédéraux. Mais quelques jours plus tard, l’université est revenue sur sa décision, craignant des incidents et mettant en avant le coût du déploiement des forces de l’ordre pour assurer la sécurité de l’oratrice.
Une autre date a été proposée, le 2 mai, et une salle hors campus. Ann Coulter a refusé et les organisateurs ont porté plainte au nom du premier amendement qui garantit la liberté d’expression.
Un Tea Party du « free speech »
Les autorités de Berkeley s’inquiètent du débarquement de militants de plus en plus étrangers au milieu universitaire, conduits par des organisations nationalistes comme les Bikers for Trump (Motards pour Trump) ou les Proud Boys de Gavin McInnes, le fondateur de Vice Media, un rassemblement qui prétend « restaurer la domination occidentale à une époque de mondialisme et de multiculturalisme » .
Dans ce haut lieu de la contre-culture des années 1960, c’est une sorte de Tea Party du « free speech » qui a ainsi fait irruption. Drapés dans des drapeaux américains, enhardis par l’élection de Trump, et persuadés de défendre « la liberté jusque dans ce trou libéral de Berkeley », comme l’affirmaient jeudi 27 avril les protestataires au micro installé dans le Civic Center Parc. Ils viennent de l’Indiana ou du Texas, pour en découdre, et ils sont attendus de pied ferme par l’autre bord, les anciens « Black Block », rebaptisés « antifas » (pour anti-fascistes), casqués et masqués, qui, selon les étudiants, n’appartiennent pas plus au campus que les premiers.
« La violence est évidemment une tactique pour imposer le silence, note le président Nicholas Dirks dans sa tribune. La question pour Berkeley est de savoir si notre tradition d’engagement en faveur de la liberté d’expression, va jusqu’au point où nous devons laisser notre campus être utilisé comme un cirque publicitaire qui a peu à voir avec le discours libéral. »
« Même le discours de haine doit être défendu »
Le débat a pris une tournure nationale. Sur les 20 000 dollars réclamés par Ann Coulter pour son intervention, 17 000 dollars sont pris en charge par l’organisation conservatrice Young America’s Foundation, qui est basée en Virginie, près de Washington. Sans surprise, la droite républicaine, qui se plaint depuis des années d’être marginalisée dans les universités, a pris fait et cause pour la défense du « free speech » à Berkeley.
Les activistes de « l’alt-right » ont réussi à semer l’embarras à gauche, en s’emparant d’un thème qui avait été celui combat des minorités. Une partie des démocrates a condamné la position des étudiants opposés à la présence d’Ann Coulter. David Cole, le directeur de l’ACLU, l’association de défense des libertés civiles, l’a fermement rappelé jeudi : « Même le discours de haine doit être défendu. »
Même le très progressiste professeur d’économie Robert Reich, de Berkeley, a jugé que le refus d’autoriser l’intervention de la pasionaria anti-immigration était « une grave erreur ». D’autres soulignent que dans les années 1960, il n’était question que d’opinions libres et non de discours rémunéré par des intervenants extérieurs. Les universitaires ont « une position absolutiste, commente la professeure Abigail de Kosnik. C’est normal, ils ont vécu ce combat. Mais les étudiants sont en train de changer ce que le “free speech” signifie à Berkeley ».
L’université de Berkeley, berceau du « free speech »
Le 1er octobre 1964, sur Sproul Plaza, la place située au cœur de l’université de Berkeley, l’étudiant Jack Weinberg est arrêté au motif d’avoir installé une table d’où il essaie de distribuer des tracts en faveur des droits civiques pour les Noirs – un geste politique interdit dans l’enceinte de l’université. Aussitôt, des centaines d’étudiants se massent autour de la voiture des policiers pour les empêcher d’emmener leur camarade. Ils sont bientôt 3 000 pour un sit-in pacifique sur Sproul Plaza.
Jack Weinberg va passer trente-deux heures assis dans la voiture. Ses camarades se relaient sur le toit du véhicule, à la suite de l’étudiant de philosophie Mario Savio, pour mobiliser la foule. Le sit-in marque le début d’une période d’agitation qui va durer quatre mois.
Après l’arrestation de 700 étudiants, le corps enseignant apporte, le 8 décembre, son soutien au « free speech ». Les autorités cèdent. Jack Weinberg ne sera pas poursuivi. Les universités ne pourront plus empêcher la liberté d’expression – inscrite dans le premier amendement de la Constitution américaine – de s’appliquer sur les campus.
Aux yeux des historiens, le « free speech movement » de l’automne 1964 a lancé le mouvement de rébellion des jeunes de la classe moyenne blanche aux Etats-Unis.