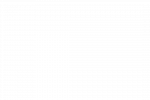Claudia Cardinale : « Je n’ai eu, dans ma vie, qu’un seul homme »

Claudia Cardinale : « Je n’ai eu, dans ma vie, qu’un seul homme »
Propos recueillis par Annick Cojean
Icône du cinéma international, l’actrice italienne montera de nouveau les marches du Festival de Cannes, qui s’ouvre mercredi 17 mai.
Claudia Cardinale, actrice fétiche de Visconti et de Fellini, et partenaire des plus grands acteurs du XXe siècle, de Burt Lancaster à Alain Delon, Henri Fonda, Jean-Paul Belmondo ou Marcello Mastroianni, a été choisie pour illustrer l’affiche officielle du 70e anniversaire du Festival et y incarner « la joie, la liberté et l’audace ». Pour Le Monde, elle revient sur son parcours.
Je ne serais pas arrivée là si…
… si la naissance de mon petit garçon, à la suite d’un viol, ne m’avait poussée à m’engager dans le cinéma pour gagner ma vie et être indépendante. C’est pour lui que je l’ai fait. Pour Patrick, ce bébé que j’ai voulu garder malgré les circonstances et l’énorme scandale que pouvait susciter alors une naissance hors mariage. J’étais très jeune, farouche, pudique, presque sauvage. Et sans la moindre envie de m’exhiber sur des plateaux de cinéma. Mais voilà : un hasard m’avait fait gagner à 17 ans, en 1955, l’élection de La Plus Belle Italienne de Tunis, alors que je ne m’étais pas présentée. La récompense était un voyage à la Mostra de Venise, où je suis allée avec maman et où mon bikini, sur la plage du Lido, a attiré l’attention des réalisateurs, que j’ai tout de suite éconduits. Un journal a même fait mon portrait en titrant « La fille qui ne veut pas faire de cinéma ». Mais les sollicitations se sont multipliées. Mon père s’est mis à recevoir des tas de télégrammes et a fini par dire : “pourquoi pas ?” Entre-temps, le drame qui était survenu et l’arrivée prochaine d’un bébé – que je gardais secrète – m’ont convaincue de foncer.
Vous avez donc quitté votre Tunisie natale pour aller à Rome ?
Oui. Un grand producteur italien, Franco Cristaldi, m’a tout de suite prise sous son aile. J’ai tourné enceinte, personne ne s’en rendait compte, car la taille des vêtements, alors, était située juste sous la poitrine. On a organisé discrètement mon accouchement à Londres. Et c’est ainsi que le bébé a été nommé Patrick. Parce qu’on l’a baptisé à la St Patrick’s Catholic Church. Le même producteur a eu l’idée de raconter que le bébé était mon petit frère. Et j’ai été contrainte à assumer ce mensonge pour éviter le scandale et protéger ma carrière.
L’avez-vous regretté ?
Oh oui ! J’ai eu la chance d’avoir une famille unie, qui s’est montrée solidaire. Mais le mensonge était un poids, et quand Patrick a eu 6 ou 7 ans, j’ai appelé un journaliste et avoué que c’était mon fils. C’était une époque étrange, vous savez, où les acteurs étaient totalement dépendants d’un producteur avec qui ils étaient sous contrat, donc pieds et poings liés. J’ai très vite enchaîné les succès, fait quatre films par an, mais je suis restée salariée comme une simple employée et n’étais pas libre de mes sorties, de mon maquillage et de ma vie personnelle. J’ai d’ailleurs appris bien plus tard que le père de mon fils m’avait envoyé de nombreuses lettres, que le producteur a déchirées sans jamais m’en faire part. Il voulait reconnaître l’enfant. Quand je l’ai su et que j’ai interrogé Patrick pour savoir s’il voulait faire sa connaissance, il a refusé catégoriquement. Tout cela a été très tourmentant. Et mon fils en a souffert. Mais il aborde aujourd’hui la soixantaine. Et nous avons heureusement gardé tous les deux, lui qui vit désormais à Rome, après New York, et moi qui vis à Paris, un excellent rapport. La famille est essentielle.
La vôtre était donc italienne, mais installée en Tunisie depuis plusieurs générations…
Oui. Mes ancêtres avaient quitté la Sicile pour la Tunisie, alors protectorat français. Et mes parents, comme moi-même, avons donc été élevés dans la langue française. J’ai eu beaucoup de chance, car ils formaient un couple éternel. Amoureux et fusionnel. Et quand papa est mort à 95 ans, maman m’a dit : « On a fait l’amour juste avant qu’il meure. » C’est incroyable, non ? Mon père était ingénieur technique à la compagnie des trains à Tunis, mais il jouait aussi du violon et donnait des concerts. Maman, elle, s’occupait de ses quatre enfants : Blanche, Bruno, Adrien et moi, Claude.
C’est ma sœur Blanche, blonde aux yeux bleus, qui rêvait de faire du cinéma. Moi, la brune aux yeux noirs qu’on appelait « la Berbère », je me voyais plutôt institutrice dans le désert ou exploratrice pour découvrir le monde. J’étais ce qu’on appelait un garçon manqué, toujours prête à me bagarrer pour démontrer que les filles étaient au moins aussi fortes que les garçons. Une vraie casse-cou qui sautait toujours dans le train en marche pour se rendre à l’école à Carthage. Les conducteurs ont d’ailleurs fini par le dire à mon père, car c’était très dangereux. Mais rien ne me faisait peur.
Vous avez pourtant déguerpi quand le réalisateur René Vautier a voulu, un jour, vous aborder à la sortie du lycée !
Oui. Je suis partie en courant. Alors il est allé voir la directrice : on a repéré une jeune fille… « Oh là là, a-t-elle dit. Claude, c’est une sauvage ! Il vaut mieux que j’appelle son papa. » Et c’est ainsi que j’ai tourné un petit film qui s’appelait Les Anneaux d’or, où je jouais le rôle d’une Arabe. Et puis un autre, Goha, de Jacques Baratier, avec un débutant qui s’appelait Omar Sharif, où j’étais également une Arabe voilée. Mais cela, c’était avant le grand départ en Italie.
Parliez-vous italien lorsque vous avez débarqué à Rome ?
Pas un mot ! Ma langue maternelle est le français et je ne comprenais rien, effrayée, en arrivant sur le tournage du Pigeon, de Monicelli, de voir tout le monde gesticuler en gueulant très fort. J’avais l’impression que tout le monde se disputait. Mais non, m’a-t-on expliqué : les Italiens parlent aussi avec leurs mains. A l’école d’acteurs de Cinecitta, quand il a fallu monter sur scène et me présenter, j’en ai été incapable. Tout le monde m’observait en disant : celle-là doit être arabe. Furieuse, je suis partie en claquant la porte. Eh bien ils m’ont gardée, élue « pour le tempérament » ! Et peu à peu j’ai appris l’italien. Mais j’ai été doublée dans tous mes premiers films. Pour Le Guépard, je parle français avec Alain Delon et anglais avec Burt Lancaster.
C’est Fellini, pour Huit et demi, qui a exigé que je joue en italien, quitte à avoir l’accent français. Cette époque, d’ailleurs, était folle. Car j’ai tourné les deux films en même temps. Visconti, précis, méticuleux comme au théâtre, me parlait en français et me voulait brune aux cheveux longs. Fellini, bordélique et dépourvu de scénario, me parlait en italien et me voulait plutôt blonde aux cheveux courts. Ce sont les deux films les plus importants de ma vie.
Ressentiez-vous un lien particulier avec Luchino Visconti ?
Oui. C’est l’homme le plus élégant et le plus cultivé que j’aie jamais rencontré. Dès mon premier film avec lui, Rocco et ses frères, j’ai su qu’il voulait me protéger, car dans une scène de bagarre, il a pris un mégaphone et a crié : « Ne me tuez pas la Cardinale ! » Sur le tournage du Guépard, il venait me murmurer à l’oreille, en français : « Je veux voir la langue quand tu embrasses Delon. » Et, dans Sandra, qu’il a dirigé de sa chaise roulante, il a voulu que je joue avec la vraie robe de mariée de sa maman. Il m’invitait souvent à dîner, dans sa maison de la via Salaria et, sous ma serviette, il cachait toujours un petit cadeau, un bijou, une allusion à un film.
Quand Marlene Dietrich lui a écrit un jour une carte postale « I love you Luchino », il m’a dit : « Allez, on va la voir pour son dernier concert à Londres. » Et on y est allé avec Rudolf Noureev. Elle a pleuré en le voyant. Et ensuite, quand j’ai appris qu’elle vivait à Paris dans une solitude quasi totale, abandonnée et oubliée de tous, je me suis débrouillée pour la retrouver et je ne l’ai pas lâchée jusqu’à sa mort.
Le cinéma ne produit-il pas de gens heureux ?
C’est un métier cannibale et ingrat. A Hollywood, où j’ai refusé de rester, encore plus qu’en Italie. Surtout pour les actrices. Et surtout quand elles passent 60 ans. Je me souviendrai toujours de Rita Hayworth, dont j’incarnais la fille dans Le Plus Grand Cirque du monde avec le grand John Wayne. Un jour, elle a débarqué dans la petite roulotte qui me servait de loge. Elle m’a regardée et elle m’a dit : « Moi aussi tu sais j’ai été belle. » Et elle a éclaté en sanglots.
Avez-vous ressenti vous-même la pression de l’âge et de l’exigence éternelle de beauté ?
Il est stupide de penser qu’on puisse arrêter le temps. Quand je vois toutes ces actrices qui se font refaire et finissent par se ressembler toutes quand elles ne sont pas défigurées à vie ! Quelle horreur ! Je ne supporte pas l’idée de chirurgie esthétique. Un médecin, un jour, m’a approchée pour me faire une proposition. Mais ça va pas ? Jamais ! D’ailleurs maman me disait toujours : « On ne voit pas tes rides, Claudia, parce que tu es toujours en train de rire ! » J’ai 79 ans, et parfois les gens ne le croient pas.
Revoir de vieux films est-il parfois douloureux ?
Il y a quelques années, à Cannes, il y a eu une projection du Guépard en version restaurée. Alain Delon était à côté de moi et, à la fin, en larmes, il m’a chuchoté : « Tu as vu ? Ils sont tous morts. » C’était vrai. J’ai connu un âge d’or du cinéma qui a inspiré les Martin Scorsese et les Woody Allen (ils me l’ont dit), mais dont les protagonistes ont tous disparu. Tant de grands et beaux acteurs…
Qui vous ont courtisée !
Oui. Mais je n’ai eu dans ma vie qu’un seul homme : le réalisateur napolitain Pasquale Squitieri, le papa de ma fille, avec qui j’ai fait dix films. Et c’est moi qui l’ai choisi. C’était un très beau mec, un tombeur, qui enchaînait les conquêtes d’actrices italiennes, françaises, américaines, si vous saviez ! Eh bien, je l’ai voulu à tout prix. J’ai su un jour qu’il était à New York, j’ai pris l’avion et, à l’aéroport JFK, j’ai appelé le seul numéro que j’avais, celui d’un de ses amis artistes. J’ai dit : « Je cherche Pasquale. » Il me répond : « Incroyable : il est à côté de moi. » Et il me le passe : « Claudia, pourquoi m’appelles-tu de Rome ? – Voyons ! Je suis à JFK. Viens me prendre ! » Et il est venu. Et nous avons passé vingt-sept ans ensemble.
Au début, Franco Cristaldi a été furieux et a tenté de nous bloquer, professionnellement, car il était puissant et contrôlait toute l’industrie cinématographique italienne. Et à la fin, quand j’ai quitté Rome pour Paris, à cause des paparazzis qui étaient toujours devant ma porte et me harcelaient avec ma petite fille, Pasquale et moi sommes restés merveilleusement complices. On s’appelait sans cesse. Et ses coups de fil me manquent terriblement depuis sa mort, en février dernier. J’ai ses photos partout dans mon appartement.
Quels souvenirs des autres grands acteurs croisés ou partenaires ?
David Niven, mon partenaire dans La Panthère rose, m’a fait le plus joli compliment : « Claudia, avec les spaghettis, tu es la plus belle invention des Italiens ! » J’avais une scène d’amour très chaude avec Henri Fonda dans Il était une fois dans l’Ouest, de Sergio Leone, mais sa femme, plantée comme un vautour à côté de la caméra, me regardait avec tant de haine que j’en étais paralysée. J’ai adoré Belmondo, avec qui j’ai tourné quatre films, comme avec Delon, et avec qui j’ai tant ri. Et j’aimais tendrement Rock Hudson, mon grand ami homo, avec qui je me baladais bras dessus bras dessous pour faire croire à une romance, car être pédé dans le cinéma équivalait à un poison et pouvait stopper votre carrière. J’étais aussi à ses côtés quand il est mort à Paris, du sida.
Et Marcello Mastroianni ?
Ah Marcello ! J’ai débuté avec lui et nous avons fait plusieurs films ensemble. Je me souviens que, dans Le Bel Antonio, de Bolognini, en 1960, il jouait le rôle d’un homme tellement amoureux de moi qu’il en était impuissant. Eh bien figurez-vous qu’il ne pouvait plus sortir de l’hôtel, à Catane, car les hommes étaient prêts à en venir aux mains avec lui sous le prétexte qu’un Sicilien impuissant, ça n’existe pas !
A-t-il été, dans la vraie vie, amoureux de vous ?
Oui, je crois. Il l’a même dit une fois dans une émission de télévision où j’étais invitée. A mon arrivée, il s’est précipité sur moi et m’a lancé : « J’étais tellement amoureux de toi. » Je lui ai dit : « Arrête, Marcello ! On est en direct ! » Je pensais à Catherine Deneuve, avec qui il était alors marié. Mais lui : « Je m’en fous ! J’étais amoureux fou ! » C’était gentil mais pas malin. Deneuve a été furieuse et m’a longtemps boudée.
Et Marlon Brando ?
C’était mon idole quand j’étais petite à Tunis, au même titre que Brigitte Bardot. Il l’a su et il est venu un jour frapper à ma porte, à Hollywood, pour me faire un numéro de charme et coucher avec moi. Mais il a vite compris. « OK. Tu es Bélier comme moi, hein ? » Et il est parti. J’ai presque éprouvé comme un petit regret. Même Pasquale, plus tard, a été sidéré : « Comment as-tu fait pour éconduire Brando ? » Mais je n’ai jamais voulu mélanger métier et vie privée. Pas de flirt. Pas d’histoire. L’Italienne a un fort tempérament.
Vous êtes l’une des très rares actrices de cette époque à continuer de tourner !
Je sais, c’est incroyable. Et toujours avec la même trouille. Elle ne m’a pas quittée malgré les 150 films ou presque au compteur, et toutes ces médailles et statuettes que vous voyez posées sur mes commodes. J’ai eu beaucoup de chance. Ce métier m’a offert une foule de vies. Et la possibilité de mettre ma notoriété au service de nombreuses causes : les droits des femmes, car je suis féministe. Les droits des homos, et ils le savent puisqu’ils me saluent toujours en passant sous mes fenêtres pendant la Gay Pride. Le combat contre le sida et la peine de mort avec Amnesty International. Les enfants du Cambodge…
Le cinéma brûle des tas de jeunes gens, balayés après un ou deux films. Quels conseils donnez-vous aux jeunes comédiennes ?
Etre forte à l’intérieur. Se défaire vite des rôles pour ne pas s’égarer dans les personnages. Et camper sur ce qu’elles sont réellement sans mélanger vie professionnelle et vie privée. Ne pas tout accepter pour un rôle qui peut vous abîmer ou vous donner l’impression de vous vendre. Moi, par exemple, j’ai toujours refusé la nudité, j’aurais eu l’impression de vendre mon corps. Refuser les caprices odieux que font certains metteurs en scène. Et résister au chantage au travail. Oui, il faut se battre !
Propos recueillis par Annick Cojean
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale ici