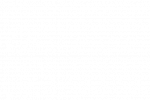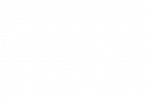Coupée de son arrière-pays, Bangui vit dans sa bulle

Coupée de son arrière-pays, Bangui vit dans sa bulle
Par Christophe Châtelot (Bangui, envoyé spécial)
L’Afrique en villes (4). Depuis la guerre civile, la capitale centrafricaine n’est reliée à l’extérieur que par l’aéroport, le corridor vers le Cameroun et le fleuve Oubangui.
La route de Bangui jusqu’au Cameroun, via Bossembélé, Bouar puis la frontière, à Bokolo, n’est plus ce qu’elle était. Il y a certes quelques passages troués comme un champ de bataille, mais Romaric ne s’en plaint pas. Quelle route africaine n’en a pas ? Ce qui a changé la vie de Romaric et de ses collègues camionneurs, ce n’est pas la qualité « passable » du goudron, mais la sécurité désormais assurée sur cet axe vital pour la capitale centrafricaine, dont l’approvisionnement des 700 000 habitants repose presque exclusivement sur deux voies : la route vers le Cameroun et le fleuve Oubangui.
En ce vendredi de juin, Romaric est encore plongé dans les entrailles de son vieux Renault jaune éprouvé par plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Encore quelques heures pour les derniers réglages. Le lendemain, il prendra la route pour une longue virée, à la queue leu leu avec 80 autres camions garés, comme lui, sur le parking du Bureau des affrètements routiers centrafricains (BARC), à l’entrée de Bangui. Une vie s’organise autour des petits commerces dans ce caravansérail mécanisé avant de partir en convoi, escorté par des casques bleus et des voitures de la police économique centrafricaine.
Un corridor stratégique
Cette mesure a été prise durant la période de transition assurée par Catherine Samba-Panza (2014-2016), après la guerre civile qui a plongé le pays dans un bain de sang, de 2012 à 2014. Avant elle, les Français avaient pris la mesure de l’importance de ce corridor stratégique. Sa sécurisation fut l’une des priorités des militaires de l’opération « Sangaris », dès leur déploiement début 2014, qui dégagèrent cette voie livrée aux milices chrétiennes anti-balaka et aux coupeurs de route.
« Avant, si vous tombiez en panne, vous ne pouviez pas vous en sortir. Les gens sortaient des forêts, vous tuaient et brûlaient le véhicule. Aujourd’hui, c’est bon, mais il ne faut toujours pas circuler seul avec de la marchandise », raconte Romaric. Les escortes ont d’ailleurs commencé après la mort d’un chauffeur camerounais. Dorénavant, ils prennent la route deux fois par semaine, le mardi et le samedi, sans trop s’en soucier.
Un autre objectif de ces escortes, plus inattendu, est, selon l’expression de Wilfried Dimanche Nguissimale, président de l’Union syndicale des conducteurs de Centrafrique, « d’arrêter les tracasseries sur la route ». Entendre par là le racket organisé par tout ce que le pays compte d’hommes en uniforme – policiers, gendarmes, douaniers, service des eaux et forêts… –, qui ponctionnaient leur dîme à l’entrée et à la sortie de chaque village. La présence de casques bleus du Bangladesh dans les convois a mis fin à cette pratique. En Centrafrique, tout du moins. « Pas au Cameroun. Ils peuvent immobiliser ton véhicule pendant plusieurs jours en attendant que ton patron te dise de payer », ajoute Wilfried Dimanche, dit « Willy ».
Enfin, reste la douane centrafricaine. « Ils préfèrent être payés en liquide », grince un commerçant. « Le train de vie du nouveau directeur général de la douane, Frédéric Théodore Inamo, a changé depuis sa nomination. Il est proche du soleil, comme on dit », ironise-t-il, en référence à sa proximité avec le président Faustin-Archange Touadéra, originaire lui aussi de l’ethnie gbakamandja. La directrice précédente, Rachel Ngakola, était la compagne de Mahamat Kamoun, le premier ministre de Mme Samba-Panza. Elle a été éjectée de ce poste lucratif avec le changement de pouvoir.
Tout ou presque vient du Cameroun
« Cette histoire de douane, c’est pour mon patron, moi je conduis », glisse Romaric. Ce qui l’attend, ce sont trois jours de route jusqu’à la frontière, autant chez le voisin camerounais jusqu’au port de Douala, plus proche débouché maritime de la Centrafrique. Là, à 1 400 km de Bangui, débarquent par conteneurs la plupart des biens que l’on retrouve dans la poignée de supermarchés libanais de Bangui, dans les microscopiques échoppes des bords de rue ou sur les étals des marchés.
Du poulet congelé aux clous et sacs de ciment, en passant par le dentifrice, les télévisions ou les vêtements, le sucre, le sel, la farine et tout ce que l’on compte de babioles chinoises, tout ou presque vient du Cameroun. A l’exception du carburant convoyé depuis le Congo-Brazzaville par des barges poussées sur les eaux de l’Oubangui quand l’étiage le permet, pas plus de six mois par an.
En sens inverse, au départ de Bangui, le transport est plus chiche. Beaucoup de camions repartent sans rien, sauf quelques-uns chargés de grumes ou de coton. Il faut dire que la Centrafrique n’exporte pas grand-chose hormis du bois, des diamants et de l’or – sur les circuits parallèles surtout –, un peu d’huile de palme, du savon et sa bière nationale, la Mocaf.
Le problème de ces voyages à vide est qu’ils renchérissent le coût d’approvisionnement de Bangui. Un coût qui n’est pas seulement lié au prix du carburant consommé à vide (600 litres de gasoil par camion vide et autant d’euros, 1 200 litres en pleine charge). Il faut y ajouter, outre les taxes de douane variables selon les produits et l’humeur des fonctionnaires, les frais d’immobilisation à Douala, le temps d’effectuer les formalités. Jamais moins de onze jours, facturés 11 000 francs CFA (environ 17 euros) par conteneur et par jour. Et puis les bakchichs. « Jusqu’à 150 000 francs CFA », selon « Willy ».
A cela, ajoutons les frais de manutention, 160 000 francs CFA pour un conteneur de 20 pieds, et d’autres dépenses telles que le prix de l’escorte, facturée 25 000 francs CFA pour chaque camion par la police économique. « Résultat, les coûts de transport des biens sont parmi les plus élevés du monde », note Olivier Benon, le représentant du Fonds monétaire international (FMI) à Bangui.
« Du coup, on a du mal à écouler la marchandise », regrette Paul Mjebelja, président du marché central de Bangui. Les affaires ne vont pas bien. Elu patron du marché par ses pairs commerçants, ce quincaillier achetait quatre fois par an de la marchandise à des Chinois de Douala. Deux fois moins souvent aujourd’hui.
Car le coût de transport se répercute sur les prix de vente pour une population centrafricaine parmi les plus pauvres du monde (avec un PIB annuel par habitant de 400 dollars), empêtrée dans une spirale de violences qui l’entraîne vers le fond. « La boîte de sardines est passée de 300 à 500 francs CFA, dit Romaric, le camionneur. Je n’en mange plus, la faute à la guerre. »
« Le prix de la gazelle a doublé »
Il y eut bien quelques mois d’accalmie avant et après l’élection de Faustin-Archange Touadéra, début 2016. L’espoir douché par les promesses non tenues et la versatilité meurtrière des organisations politico-militaires, la Centrafrique s’est de nouveau embrasée à partir de septembre. En juin, les groupes armés faisaient la loi et semaient le chaos dans quatorze des seize provinces du pays.
Autrement dit, Bangui vit dans une bulle, certes épargnée par les combats, mais reliée à l’extérieur seulement par l’aéroport, le corridor vers le Cameroun et l’Oubangui. Elle est quasiment coupée de son arrière-pays.
C’est ce que vit Eugénie Berthe. Originaire de Kaga-Bandoro, à 300 km au nord de Bangui, cette enseignante complète son maigre traitement au versement aléatoire par un commerce de viande de brousse qu’elle écoule sur le marché central de Bangui. Mais depuis la reprise des combats entre milices chrétiennes anti-balaka et musulmanes de l’ex-Séléka, les routes et les campagnes ne sont plus sûres. « Je ne peux plus aller jusqu’à Kaga-Bandoro pour m’approvisionner, dit-elle. Je m’arrête à mi-chemin pour voir mes fournisseurs, des chasseurs qui me disent que pour eux aussi c’est dangereux. Alors ils vendent trop cher, le prix de la gazelle a doublé. »
Idem pour la viande de bœuf. Avant les violences de 2014, sa vente était assurée par les commerçants musulmans du quartier PK5 en lien avec les gros éleveurs de bovins, essentiellement des Peuls. Mais voila, les anti-balaka ont « nettoyé » le PK5, comme le reste de Bangui, poussant par le meurtre et la terreur les musulmans au départ. Le bœuf est devenu rare à Bangui.
« Les commerçants musulmans ne viennent plus ici », regrette le président du marché, l’une des rares places de la ville où l’on trouve des produits locaux (boucherie, poissons, fruits et légumes). « On a un gros problème d’approvisionnement », ajoute-t-il. Et de clientèle, semble-t-il. En ce vendredi de juin, le nombre de vendeurs – 1 500 enregistrés pour 300 places – surpasse les acheteurs potentiels qui déambulent entre les étals de poissons séchés ou de viandes boucanées dégageant une odeur entêtante. Après cinq incendies en l’espace de quelques années, le marché est un peu à l’image du pays : en état de décomposition avancée.
Le sommaire de notre série « L’Afrique en villes »
Cet été, Le Monde Afrique propose une série de reportages dans seize villes, de Kinshasa jusqu’à Tanger.