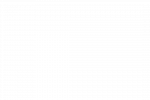Mostra : Clooney et Guédiguian en opération immobilière à Venise

Mostra : Clooney et Guédiguian en opération immobilière à Venise
Par Jacques Mandelbaum
Le réalisateur américain a présenté « Suburbicon », une satire poussive de l’Amérique des années 1950 tandis que le Français signe, avec « La Villa », un film plein de grâce.
Jean-Pierre Darroussin, Ariane Ascaride, Robert Guédiguian et Anais Demoustier à la première de « La Villa » à la Mostra de Venise, dimanche 3 septembre. / FILIPPO MONTEFORTE/AFP
Deux notables candidats au Lion d’or se sont positionnés ce week-end à la Mostra de Venise, ouverte depuis le 30 août. Fort attendus par leurs aficionados respectifs, en nombre certes inégal, il s’agit de George Clooney et de Robert Guédiguian qui, dans Suburbicon et La Villa, s’intéressent visiblement à la manière dont leurs personnages habitent le monde.
Le premier, adoré en Italie et divinisé à Venise où il s’est récemment marié, symbole cool de la gauche américaine, signe ici son film le plus noir, qui se présente comme une satire de « l’American way of life » située durant les années 1950, dans une ville nouvelle destinée à la classe moyenne.
Le récit consiste à montrer ce qui se passe vraiment derrière la belle vitrine, quitte à tourner rapidement vinaigre et à révéler que le pays est en vérité peuplé par des monstres. Soit un bon père de famille (Matt Damon) multi-homicide, une belle-sœur qui l’accompagne avec le sourire (Julian Moore), une femme handicapée éliminée, un infanticide projeté, une population haineuse qui assiège la maison d’une famille noire jusqu’à ce qu’elle quitte la ville. On en passe et des meilleures. Tout cela finit, au-delà de la satire, en amer jeu de massacre.
On reconnaît ici la patte des frères Coen, dont Clooney a récupéré et retravaillé un scénario du début des années 1980 jamais tourné, sans parvenir toutefois à en transformer son fiel en or, comme leurs auteurs excellent le plus souvent à le faire. Suburbicon, également inspiré d’un fait divers raciste survenu en 1957 à Levittown, en Pennsylvanie, est une charge qui manque de subtilité et d’humanité. Vraisemblablement gagné par l’atmosphère méphitique dégagée par la gouvernance du président Trump, le film exsude la colère et l’amertume, procède à l’emporte-pièce, finit par s’auto-intoxiquer. Pareille mésaventure vient d’arriver, sur le terrain russe, à l’excellent Sergeï Loznitsa avec Une femme douce.
Retour à l’Estaque pour Robert Guédiguian
Dans La Villa, Robert Guédiguian fait quant à lui exactement l’inverse de son collègue américain. Plutôt que de forcer son tempérament, il revient à ses fondamentaux et signe un film plein de grâce et d’émotion, d’intelligence sur l’époque. Quand on associe « fondamentaux » et « Guédiguian », le résultat de l’opération se nomme naturellement Marseille. Soit un chapelet de films tournés depuis bientôt quarante ans avec la même bande (Gérard Maeylan, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Jacques Boudet…) dans le quartier de l’Estasque, mêlant l’histoire prolétarienne à la romance, la fidélité aux idéaux à la trahison, l’autobiographie à la fiction brechtienne.
L’œuvre, qui se donne la liberté d’inventer à chaque film une nouvelle histoire, est impressionnante, devenant à la longue sa propre archive en filmant l’empreinte du temps qui passe sur les corps et les lieux qui la peuplent (sublime flash back dans le film faisant remonter la jeunesse des protagonistes). Le cinéaste y revient aujourd’hui à première vue pour solder les comptes, et à seconde vue pour continuer le combat. Toute la beauté du film tient dans cet effet à double détente.
Nous sommes ici à quelques encablures de l’Estaque, dans l’anse Méjean, que la spéculation, qui a gagné partout, menace à son tour. Un vieux prolo frappé par une attaque, voué désormais à une vie végétative, rassemble autour de lui ses trois enfants, entrés à leur tour dans l’âge du bilan, et mis à la question de la vente probable de la maison familiale qui surplombe la mer. Entre règlements de compte et tendresse indéfectible, regrets d’un rêve qui n’a pas pris, fatigue d’une vie qui a passé si vite, lassitude d’une époque qu’on vomit, tout cela sentirait la fin de partie si l’amour, la colère et le combat n’y reprenaient finalement leurs droits, à la faveur de la découverte d’enfants immigrés cachés dans la calanque. C’est ainsi que la vie continue dans La Villa quand elle s’arrête à Suburbicon.