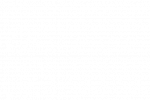Des « crimes contre l’humanité » qui ont poussé plus de 400 000 personnes à fuir le Burundi

Des « crimes contre l’humanité » qui ont poussé plus de 400 000 personnes à fuir le Burundi
Par Jean-Philippe Rémy (Johannesburg, correspondant régional)
Une commission d’enquête des Nations unies documente les exactions commises depuis 2015 et le maintien au pouvoir de Pierre Nkurunziza.
Dans le rapport de la commission d’enquête des Nations unies sur le Burundi, rendu public lundi 4 septembre, ne figurent que peu de témoignages, et presque aucune recension détaillée des horreurs subies par une partie de la population, pourtant au cœur des préocupations des enquêteurs. Parmi les centaines d’hommes, de femmes et d’enfants entendus par ces derniers, nul n’est cité de façon personnelle. Il y a une raison à cela. Les détails ont été engrangés, mais demeurent confidentiels. Il faut y voir à la fois une mesure de protection élémentaire, et la préparation de la suite du dossier dans ce cadre, c’est-à-dire la façon dont la justice internationale s’en saisira.
Tout juste remarquera-t-on, par exemple, que parmi les quelque cinq cents témoignages recueillis par les enquêteurs de la commission figurent quarante-cinq cas de viols affectant des personnes âgées de 8 à 71 ans. Ce chiffre n’indique pas le nombre de viols commis dans le pays, mais le nombre de témoignages qui ont pu être accessibles aux enquêteurs, lesquels n’ont pas été autorisés à se rendre au Burundi, leurs demandes d’explication, notes verbales et lettres étant restées sans réponse. Les enquêteurs ont été contraints de se rendre dans des pays voisins du Burundi et de s’y entretenir avec des réfugiés.
Cette relative absence de détails peut toutefois apparaître comme une surprise, si on la compare avec les rapports d’organisation de défense des droits de l’homme sur les exactions commises au Burundi depuis 2015. Pourquoi cette date ? Après tout, d’autres séquences auraient mérité ce soin au Burundi, à d’autres époques. Les grands massacres contre les Hutu de 1972 (déjà qualifiés d’actes de génocide) ; l’assassinat du président Ndadaye en 1993, et les vagues de massacres qui suivirent cet élément déclencheur et se muèrent en une guerre civile de dix ans : tout ceci mériterait d’être intégré à un processus judiciaire. Mais ce n’est pas le mandat de la commission d’enquête, qui statue sur le présent et a été créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2016 alors que, en avril de l’année précédente, s’était ouverte au Burundi une crise aiguë.
Tentative de coup d’Etat
Celle-ci avait été déclenchée par la décision du président, Pierre Nkurunziza, de se présenter pour un troisième mandat. Contre certaines dispositions légales liées au processus de paix qui avait mis fin à la guerre civile, mais aussi contre l’avis de certains membres de son propre parti, le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD). Cela allait provoquer des manifestations, puis une spirale de violence et de répression. Les manifestants étaient en majorité tutsi. Cette partie de la population allait payer le prix le plus fort de la répression. Mais des Hutu allaient, eux aussi, être visés. Dans ce contexte, même si la commission d’enquête relève des cas « d’arrestations, de tortures et de violences sexuelles, des insultes à caractère ethnique » à l’encontre de Tutsi, « elle n’est pas en mesure d’établir l’existence d’une volonté politique de détruire en tout ou en partie ce groupe ethnique ». Les enquêteurs s’en tiennent donc à la qualification des « violences exercées », et à en identifier les commanditaires, en retraçant l’histoire des actes commis depuis 2015.
Après une phase de manifestations un peu rudes, la situation initiale s’était durcie, spécialement après une tentative de coup d’Etat contre Pierre Nkurunziza, qui allait jeter la suspicion sur les loyautés au sein de l’armée ou des forces de sécurité, et élargir le spectre des représailles.
Les manifestants de la première heure étaient violents : cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Le rapport de la commission le note, relevant que, dans certains cas, « des agents de police auraient agi à la suite d’actes de violence de manifestants ayant entraîné la mort de policiers et de membres du parti au pouvoir », tout en relevant que ces mêmes forces de l’ordre ont fait un « usage excessif de la force létale », c’est-à-dire qu’ils ont ouvert le feu avec leurs fusils d’assaut sur des manifestants armés seulement de pierres.
« Climat de peur profonde et généralisée »
Par la suite, une violence plus lourde s’est mise en place pour casser la contestation, visant les hommes jeunes de tous les quartiers où se concentrait cette dernière. Le rapport des Nations unies n’entre pas dans le détail systématique des arrestations, tortures, viols, sévices, assassinats extra judiciaires exécutés par les forces de l’ordre, le creusement de fosses communes pour dissimuler l’existence de suspects exécutés ou morts sous la torture dans les cachots de la police ou des services de renseignement. Il en cite toutefois un certain nombre (pour étayer sa démonstration) et, surtout, les organise par thèmes, les résume, et en indique la portée. Au final, les enquêteurs penchent pour la qualification de ces actes en « crimes contre l’humanité ».
Il faut noter, par ailleurs, que d’autres rapports, ceux de Human Rights Watch, d’Amnesty International, ou de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) – qui a publié, en juillet, un dernier texte sur le Burundi –, ou encore des articles écrits lorsque les médias internationaux étaient encore autorisés à se rendre et à travailler au Burundi, ont dessiné de façon comparable le détail des exactions. Les observateurs extérieurs ne sont plus autorisés à travailler librement au Burundi, ou contraints de s’autocensurer, dans le cas de la presse. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les témoignages en provenance du Burundi se fassent désormais rares.
Restent les témoins réfugiés à l’extérieur du pays. Encore ces derniers ne se sentent-ils pas en sécurité. « Les entretiens de la commission ont révélé un climat de peur profonde et généralisée : peur de témoigner par crainte de représailles, peur d’être poursuivi, même en exil, et peur de rentrer au pays », note le rapport de l’ONU. Les réfugiés burundais recensés en juillet 2017 sont au nombre de 417 000 personnes, soit 4 % de la population totale du pays.
« Campagne des cent jours »
Le Burundi n’est pas sorti de la crise. « Ce climat propice aux violations des droits de l’homme a perduré en 2016 et 2017, entretenu notamment par des discours de haine de la part d’autorités et de membres du parti au pouvoir ainsi que par l’impunité générale, aggravée par un manque d’indépendance du système judiciaire. » Comme le stipule son mandat, la commission d’enquête du Conseil des droits de l’homme de l’ONU se doit d’« identifier les auteurs présumés… en vue de faire pleinement respecter le principe de responsabilité ».
A cet égard, une liste confidentielle de responsables a été dressée par la commission d’enquête. Pour la suite, ce sera à la Cour pénale internationale (CPI) de se saisir du dossier. « Il revient à la CPI d’enquêter sur les violations et d’établir les responsabilités pénales », notent les auteurs, qui s’attachent à reconstituer la chaîne de responsabilités vis-à-vis des atteintes aux droits de l’homme.
La commission a établi « des liens étroits entre des membres, y compris haut placés, du service national de renseignement, de la police, de l’armée et de la présidence, d’une part, et certains Imbonerakure [mouvement de jeunesse du parti au pouvoir, qualifiée de milice par des rapports des Nations unies], ces derniers recevant des premiers des instructions ou directives pour violer les droits de l’homme. Dans certains cas, la Commission a pu également établir le contrôle effectif d’agents de l’Etat sur des Imbonerakure. De nombreux témoins ont mentionné leur présence aux côtés de membres de la police ou du service national de renseignement, y compris dans les centres de détention, lorsque des violations ont été commises, et opérant parfois avec des uniformes et des armes de la police ou de l’armée, au vu et en présence de membres de ce corps. »
Le 25 avril 2016, le procureur de la CPI a ouvert un examen préliminaire afin de déterminer si des crimes relevant de la compétence de sa Cour avaient été commis au Burundi. En réponse, à l’automne suivant, un projet de loi à l’Assemblée nationale burundaise, adopté par 94 voix sur 100, ouvrait la voie à une rupture en octobre du Burundi – partie jusqu’ici du traité de Rome –, avec la juridiction internationale. La publication du rapport de la Commission des droits de l’homme survient alors que la date de sortie effective du Burundi de cette juridiction prendra effet le 26 octobre. Dans l’intervalle, une commission spéciale de l’Assemblée nationale, composée de douze députés, a été créée à Bujumbura, le 31 août, pour examiner le contenu du rapport de l’ONU. Ce devrait être vite réglé. Le texte onusien évitant de mentionner dans le détail les cas précis des personnes entendues comme témoins, et qui constituent la base de son travail, et gardant confidentielle la liste des responsables des exactions, il ne reste que les principes à discuter. Le 17 juillet, la société civile, désormais en exil ou dans la clandestinité pour sa majeure partie, a lancé une « campagne des cent jours » pour sensibiliser l’opinion internationale sur le Burundi