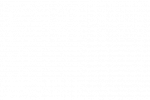La France vue de Toronto

La France vue de Toronto
Par Isabelle Regnier (Toronto, envoyée spéciale)
Les réalisateurs Xavier Beauvois et Mahamat Saleh Haroun ont présenté leurs derniers films au festival de cinéma canadien.
Lancé avec le très médiatisé biopic Borg vs. McEnroe, du Suédois Janus Metz Pedersen (que nous n'avons pu voir en raison d’embouteillages aériens), le Festival international du film de Toronto bat son plein depuis jeudi 7 septembre, et va maintenir les abords du lac Ontario en effervescence jusqu’au dimanche 17. D’une manifestation créée dans les années 1970 pour apporter les meilleurs films des meilleurs festivals internationaux à un public local, le TIFF a muté au fil des ans pour devenir l’énorme machine qu’il est aujourd’hui. A la fois marché du film géant, rampe de lancement pour la course aux Oscars (tous les trois ans en moyenne, le public de Toronto décerne son prix, le People’s Choice Award, au film qui remporte, cinq mois plus tard, l’Oscar du meilleur film), et un concurrent sérieux pour les festivals de Venise et de San Sebastian avec qui il se dispute les projections en première mondiale.
Ainsi voit-on de plus en plus de films d’auteurs français démarrer leur carrière sur les écrans du multiplexe Scotiabank ou des théâtres de Toronto, dans un parfum sucré de pop-corn. Les découvrir dans ce contexte, dans des salles pleines à craquer d’un public surexcité, calés entre des productions de toute nature, venues des quatre coins du monde, donne le sentiment de recevoir des nouvelles d’un pays à la fois familier et lointain.
Grande tradition naturaliste
Une carte postale, qui nous raconterait, par exemple, que la grande tradition naturaliste du cinéma français n’est pas morte, puisque Xavier Beauvois la célèbre avec ferveur dans son nouveau film, Les Gardiennes. Refusé à Cannes, ce film, qui marque la première collaboration entre le cinéaste et la productrice Sylvie Pialat, se présente comme une émanation de La Maison des bois, le chef-d’œuvre de Maurice Pialat réalisé pour la télévision en 1971.
Pendant sept longues années, de 1915 à 1922, il nous installe au cœur de la campagne bretonne, dans une ferme où, depuis que les hommes sont partis au front, les femmes ont pris les affaires en main. Hortense, la matriarche (Nathalie Baye, magistrale dans son premier rôle de grand-mère aux cheveux gris), est secondée par sa fille (Laura Smet). Elles sont bientôt rejointes par la jeune Francine (Iris Bry, une révélation), une orpheline qui se dévoue à la famille, et à la ferme, et tombe amoureuse d’un des fils de la maison lors d’une visite qu’il vient y faire en permission.
Les années passent, rythmées par les moissons, par la violence qui explose en sourdine, et à retardement, mais pas moins brutalement que sous le feu des canons, par de rares éclats de joie. Beauvois cherche moins à raconter une petite histoire qu’à saisir la grande, qui s’écrit en silence. Tranchant dans la continuité à grands coups d’ellipses, il creuse le moment comme une glaise, sculptant de concert avec Caroline Champetier, la chef opératrice qui a signé la lumière de tous ses films, les visages et les corps de ses acteurs lesquels, ainsi saisis dans leur vérité nue, sont bouleversants.
Les personnages font ce que les circonstances leur commandent pour assurer d’abord la survie, et peu à peu, la prospérité de la ferme, se relevant vaillamment chaque fois qu’un nouveau coup du sort vient les terrasser. Et c’est ainsi qu’insensiblement, entre le début et la fin du film, porté par un mélodrame sourd dont la charge n’explosera que dans la dernière demi-heure (le film dure deux heures et quart), on aura glissé d’un monde figé dans une tradition ancestrale à un autre où la modernité a fleuri sans crier gare, transformant les usages et les mentalités, tandis que les femmes ont gagné une liberté qu’elles n’avaient pas pensé à demander.
Si le film témoigne d’une volonté parfois écrasante de faire art, donnant l’impression que chaque plan a été composé comme un tableau de maître (avec Millet et Courbet en ligne de mire), il ne laisse pas moins affleurer une stupéfiante sensation de vie, qui est la marque des grands cinéastes.
Le cinéaste Mahamat Saleh Haroun au Festival international du film de Toronto, le 10 septembre 2017. / VALERIE MACON/AFP
Une sensation de vie
Une sensation de vie, c’est aussi ce que produit, dans ses meilleurs moments, Une saison en France, de Mahamat Saleh Haroun. Pour son premier film tourné en France, le cinéaste tchadien, qui vit à Paris depuis de longues années, a voulu raconter l’histoire d’une famille d’intellectuels fraîchement débarquée à Paris après avoir fui la République centrafricaine, qui voient leurs espoirs, et avec eux, leur dignité, se dissoudre comme dans un bain d’acide au fur et à mesure des refus qui leur sont opposés par l’administration française. Ils sont quatre, Abbas, ses deux enfants et son frère, Etienne.
Le film commence alors qu’on ne sait rien d’eux, sinon que la petite fille adore lire, que le petit garçon préfère les jeux vidéo et le PSG, que leur père travaille sur les marchés, qu’ils vivent tous les trois dans un appartement bourgeois, et que leur oncle est vigile devant une pharmacie. Cette réalité va vite apparaître pour ce qu’elle est : une illusion. Derrière la sérénité qu’ils affichent, il y a les séquelles du voyage en enfer qu’ils ont fait pour fuir leur pays, au cours duquel la mère des enfants est morte assassinée. Il y a l’angoisse de savoir sa vie suspendue à une décision administrative, le stress de ne jamais être chez soi, de ne pas se sentir d’avenir, la tristesse de ne plus pouvoir exercer son métier d’origine — en République centrafricaine, les deux frères étaient respectivement professeur de français et professeur de philo.
Sandrine Bonnaire et Eriq Ebouaney dans « Une saison en France », de Mahamat Saleh Haroun. / AD VITAM
En faisant parler ses personnages comme des Parisiens, en les faisant s’habiller comme des bourgeois, en les débarrassant de tout stigmate associé à la condition de migrant, Mahamat Saleh Haroun les dépeint comme d’autres versions de lui-même, des frères qui ont eu moins de chance que lui — exigence morale qui favorise en outre l’identification des spectateurs. On regrette toutefois qu’il n’ait pas poussé plus loin la licence fictionnelle. Si l’émotion explose dans une scène choc, d’une force impressionnante, qui condense toute la violence emmagasinée par cette famille (et partant, par tous les migrants), le parti pris didactique du film, qui conduit à détailler, étape par étape, la descente aux enfers à laquelle s’apparente le parcours des migrants, n’enferme pas moins les personnages dans le carcan de leur condition.
Sur le Web : www.tiff.net/tiff