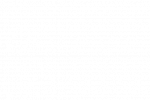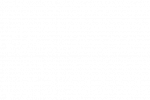L’exil de Hassan : « Je me faisais traiter de “nègre” tous les jours en Grèce »

L’exil de Hassan : « Je me faisais traiter de “nègre” tous les jours en Grèce »
Par Emile Costard (Vichy, envoyé spécial)
Dans cette série en trois épisodes, Hassan, un réfugié d’origine érythréenne, raconte son histoire et l’épopée qui l’a mené jusqu’en France.
Depuis deux mois, et dans le cadre du projet européen « Les nouveaux arrivants », Le Monde suit un groupe de réfugiés installés à Vichy. Pendant un an, nous raconterons l’intégration de ces hommes originaires du Soudan et d’Erythrée. Hassan est l’un d’entre eux.
La République hellénique sera son bagne. La Grèce, Hassan l’a vécue comme un traumatisme. Et si l’Europe qu’il avait tant idéalisée n’était qu’un vieux continent hostile à sa présence ? Après plusieurs tentatives infructueuses pour continuer plus à l’ouest, il se résigne et travaille dans les exploitations agricoles comme ouvrier clandestin, enchaînant des journées de dix heures sous un soleil de plomb, jusqu’à devenir l’ombre de lui-même. En 2015, l’arrivée massive d’hommes et de femmes fuyant la guerre en Syrie mettra fin à son calvaire.
A mon arrivée à Athènes, je suis resté trois jours dans un hôtel tenu par un Soudanais, puis je suis parti pour Patras, la troisième ville du pays. Beaucoup de migrants se rendaient là-bas à l’époque, car la ville dispose d’un grand port avec des liaisons régulières pour l’Italie.
Tous les jours, on essayait de se glisser sous des camions qui embarquaient pour l’Italie. La seule chose que je récoltais, c’était les coups de la police. Les flics étaient débordés, ils ne pouvaient pas arrêter tout le monde et nous plaçaient en centre de rétention, alors ils nous tabassaient puis nous rejetaient plus loin. Le soir, je dormais dans des trains désaffectés. J’ai tenu dix jours. J’étais éreinté.
Je préférais gagner ne serait-ce qu’un euro par jour plutôt que de continuer à traîner dans la rue. J’ai entendu qu’il y avait parfois du travail dans le secteur agricole à Filiatra. J’ai pris mes affaires et je suis allé là-bas. Je ne connaissais personne. Sur place, il y avait trois ou quatre autres réfugiés qui habitaient en périphérie. Ils s’étaient fabriqué un camp de fortune. C’était beaucoup de souffrances. On vivait dans des cabanes, sans eau, sans toilette, sans électricité. Ça a duré presque un an.
Je ne parlais pas grec. C’était très dur d’attirer l’attention sur ma situation. En plus, le racisme était extrêmement fort. On était « des monstres qui sortaient tout droit de la mer », m’a dit un jour une fillette. Je me faisais traiter de “nègre” tous les jours. Les gens me dévisageaient dans la rue. Ils se retournaient quand je passais, comme s’ils n’avaient jamais vu un Noir. C’était vraiment impossible à vivre. J’ai vu des jeunes perdre la tête. Il fallait être solide pour tenir. Je faisais tout pour être invisible, pour qu’on ne me remarque pas. J’essayais juste de mettre de l’argent de côté. Je bossais régulièrement dans les fermes alentour pour quelques euros. Je ne gagnais pas plus de 5 euros par jour, alors imaginez le temps qu’il faut pour économiser 2 000 euros. Mais j’ai tenu bon. Au bout de deux ans, j’ai reçu un appel surréaliste d’un Soudanais que je connaissais : « Hassan, je suis dans un café à Athènes et il y a un homme qui vend ton passeport ! J’ai reconnu ta photo et c’est bien ton nom ! »
Le passeport avec lequel Hassan avait quitté le Soudan et que les passeurs lui avaient pris à son arrivée en Turquie est à vendre. Il n’en revient pas. Le Soudanais lui conseille de le racheter, car il connaît un homme pouvant lui procurer un faux visa. Hassan décide de vendre tout ce qu’il possède, emprunte quelques dizaines d’euros et file sans plus attendre à Athènes. L’espoir de quitter la Grèce ne sera que de courte durée.
Pour 350 euros, j’avais tous les documents nécessaires et un billet d’avion pour l’Italie. A l’aéroport, j’ai réussi à passer plusieurs contrôles, jusqu’à ce qu’un homme de la sécurité m’interpelle. Il a été très direct : « Tu fais demi-tour ou j’appelle la police sur-le-champ. » Je n’ai pas bronché et j’ai rebroussé chemin…
Ça faisait deux ans que je vivais en Grèce et toutes mes tentatives pour quitter le pays avaient capoté. Je suis retournée à Filiatra faute de mieux. C’est à cette période que j’ai commencé à travailler chez un esclavagiste, le patron d’une exploitation agricole de 50 hectares. J’étais chargé d’épandre des engrais interdits, des produits toxiques. Je devais acheter les gants et le masque avec mon argent, car ils n’étaient pas fournis. Je connaissais un réfugié qui était tombé malade, alors je prenais mes précautions. A la fin du mois, je recevais entre 100 et 150 euros pour des journées de 10 heures de travail, parfois plus. Le patron retenait une partie de mon salaire et mes heures supplémentaires n’étaient jamais payées. Que pouvais-je faire ? Rien. Légalement, je n’étais personne. J’étais coincé.
Cette année-là, j’ai rencontré Mitcho, le seul Grec que je porterai toujours dans mon cœur. Mitcho avait une quarantaine d’années et il avait une petite exploitation d’oliviers. Je bossais chez lui au moment des récoltes. Il n’y avait pas beaucoup de boulot mais il payait bien. Et il s’intéressait à nous, à ce qu’on pouvait ressentir, à ce qu’on avait traversé. Un jour, je lui ai raconté que mon patron principal retenait une partie de mon salaire depuis sept mois. Mitcho s’est mis dans tous ses états. Je devais arrêter de bosser sur-le-champ ou il viendrait avec moi réclamer mon argent et lui casser la gueule. Je l’ai empêché. J’avais peur de créer des problèmes et d’être dénoncé à la police. Alors Mitcho a eu une autre idée. Il m’a emmené voir le prêtre orthodoxe du village et il a expliqué ma situation. Le lendemain, le patron est venu me voir. Il était très embarrassé. Il m’a gueulé dessus, mais il m’a rendu mon argent (rires).
J’ai continué à travailler comme ça jusqu’en 2015, l’année où tout a changé. A la télé et dans les journaux, on ne parlait que des Syriens qui fuyaient la guerre. Ils arrivaient en Grèce par milliers, c’était très impressionnant. A Filiatra, certains qui étaient de passage disaient qu’il leur faudrait dix jours pour se rendre en Allemagne. J’étais sidéré. Les frontières étaient ouvertes et ils le confirmaient. Mais pour combien de temps ? Je n’ai pas voulu perdre une seconde. Je suis allé chercher ma paie et j’ai réuni mes affaires. Je ne resterai pas un jour de plus. Mitcho et sa famille m’ont emmené à la station d’autocar et je suis parti pour Athènes. Les réfugiés étaient dans tous les bus du pays. Plus personne ne se cachait. C’était surréaliste. Et comme l’offre s’adapte à la demande, les prix des passeurs avaient considérablement baissé. Je suis parti avec des dizaines de réfugiés vers Thessalonique. Nous avons marché, marché et encore marché. Les flots de réfugiés sur les routes avançaient en rang, comme des bataillons. La Macédoine, la Serbie, la Croatie puis l’Italie. Je suis resté quelques jours à Vintimille et j’ai rejoint la France.
La France est son terminus. Elle est aussi un hasard. A son arrivée à la gare de Lyon, à Paris, Hassan hésite à poursuivre vers Calais pour tenter sa chance en Angleterre. Puis une rencontre fortuite avec un Soudanais dans le quartier de La Chapelle l’emmène dans un squat du 19e arrondissement, l’ancien lycée Jean-Quarré, où des centaines de migrants ont élu domicile. Au premier abord, Hassan se dit que la France n’a rien à envier à la Grèce. Ici, les migrants dorment par milliers sous le métro. Mais son deuxième jour dans la capitale française lui redonne espoir. Alors qu’il déambule dans les rues, il se sent anonyme pour la première fois depuis longtemps. Le nord de Paris est cosmopolite et des gens de toutes les couleurs cohabitent. Et si la France était le pays où il parviendrait à faire son trou ?
Hassan restera dix jours dans le squat avant d’être évacué dans le centre d’accueil et d’orientation de Varennes-sur-Allier. La destination lui est inconnue, mais des bénévoles parisiens lui expliquent que le transport est pris en charge et qu’il sera logé. Epuisé par son odyssée grecque, il décide de se laisser porter. Il lui faudra un mois pour récupérer avant de se lancer dans les démarches administratives pour demander le statut de réfugié, qu’il obtiendra un an plus tard, en 2016. « Un grand moment de joie mêlé à une profonde mélancolie », explique-t-il. Car si la réception de son titre de séjour symbolise un nouveau départ, elle met aussi un terme officiel à sa vie d’avant. L’exil est une douleur sourde et continue : « Maintenant, je dois faire le deuil de ma vie passée pour continuer d’avancer. »
Il vit désormais à Vichy, travaille et prend aussi des cours de français. Durant son temps libre, Hassan joue du synthétiseur dans le groupe des Soudan Célestins Music, composé de réfugiés soudanais et érythréens, et pratique le football dans une équipe d’anciens migrants. « Je veux vivre et m’intégrer », résume-t-il simplement.
Alors que nos entretiens se terminent, Hassan fait une requête. La seule de ce récit. Que nous n’oublions pas de citer les gens qui l’ont aidé. La liste est longue et les bénévoles de Vichy Réseau Solidaire en font partie. Il pense à eux et les remercie.
Il pense aussi régulièrement à ceux qui sont restés coincés en Erythrée. A ceux qui sont enfermés dans une geôle ou qui vivent dans un pays qui ne leur offre aucun avenir. Il pense à ceux qui sont morts sur les routes de l’Europe et à ceux qui, après avoir enduré tout ce qu’il a vécu, se sont vu refuser l’asile. L’exil est un gigantesque jeu de hasard et Hassan se classe parmi les chanceux.