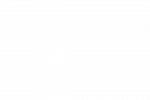Joann Sfar : « Je suis K.-O. debout, comme toute la gauche caviar »

Joann Sfar : « Je suis K.-O. debout, comme toute la gauche caviar »
Propos recueillis par Pascale Krémer
Auteur de bande dessinée, réalisateur et romancier, il vient de publier un nouveau roman, « Vous connaissez peut-être », et sortira le 17 novembre « La Tour de Bab-El-Oued », septième tome de sa série « Le Chat du rabbin ».
Je ne serais pas arrivé là si…
… Si mes grands-parents n’avaient pas écrit pour moi. Mon grand-père maternel, ma grand-mère paternelle étaient des conteurs formidables. Je ne crois pas un instant à la génération spontanée des auteurs. On redit en moins bien les histoires dont on a hérité.
Mes récits sont en arborescence, comme ceux de ma grand-mère : elle commençait par une anecdote du quotidien, chez le coiffeur, le médecin, dans la rue, ça lui rappelait un épisode familial récent en Algérie, puis on se retrouvait dans l’Espagne des conquistadors, et là, ça y allait, le sexe ! Elle qui était très prude, il lui fallait cette mise à distance de plusieurs générations pour oser en parler.
Vous êtes né dans une famille juive, originaire du Maghreb et d’Europe de l’Est…
Mon grand-père maternel venait de Bolekhiv, près de Lviv, c’était la Pologne à l’époque, c’est l’Ukraine maintenant. Il parlait dix langues et avait fait des études pour être rabbin.
Mais la France des années 1930 importait des médecins. Il racontait que le rabbin l’avait convoqué pour lui dire : « Arthur, tu vas aller dans un pays civilisé, alors tous les trucs qu’on fait, là, comme manger casher, tu arrêtes, tu vas passer aux choses sérieuses. » Il est parti faire des études de médecine en France. On a du mal à se représenter une époque où même pour les ecclésiastiques, avoir un mode de vie séculaire, c’était mieux. « Rabbin, c’est pas un métier pour les juifs », disait ma grand-mère paternelle.
C’était une très belle femme d’extraction très modeste qui avait réussi à faire faire des études à ses cinq enfants. Elle était étouffante mais moi qui n’ai pas eu de mère, j’ai toujours adoré ça. Elle a passé sa vie derrière la fenêtre à imaginer ce qu’elle n’a pas vécu – elle a été veuve assez tôt. Son espace de liberté, c’était son imaginaire. Le Chat du rabbin vient de cette envie de rendre justice aux femmes de Méditerranée au sens large, qui ont plus donné qu’on ne leur a donné.
Vos parents vous ont transmis cette double culture juive, ashkénaze et séfarade ?
Je suis surtout l’enfant d’un couple de rêve. Mon père était un brillant avocat, né dans la misère à Sétif, en Algérie, orphelin de père. Dès ses 7 ans, il portait des sacs de bonbons à l’usine. Il avait été marqué par la répression sanglante des émeutes, en 1945, puis par un miracle judiciaire : un avocat avait sauvé de la mort un Arabe injustement accusé de meurtre.
Mon père a fréquenté l’Alliance française qui alphabétisait les juifs d’Algérie pour la petite administration française. Il a payé ses études de droit en jouant du piano dans les bars et les bordels.
Au milieu des années 1950, après sa capacité de droit, le préfet de police d’Alger l’a envoyé en métropole avec sa famille parce qu’il était menacé par l’extrême droite, la future OAS. Il est arrivé à Nice avant l’exode des pieds-noirs. Il y a mené la carrière idéale d’avocat du Sud de la France, commencée en défendant des putes, terminée en avocat des banques. C’était le sosie de Sacha Distel, il jouait du piano comme un professionnel, avait un bateau, changeait d’Alfa Romeo tous les ans. Il claquait, comme ceux qui ont été très pauvres.
Ma maman, elle, était une starlette, Mademoiselle Age Tendre à 17 ans, elle avait fait deux disques chez Barclay, elle était étudiante en pharmacie et championne de natation. Ils étaient très amoureux mais mon père s’était éloigné parce qu’il était plus vieux d’une vingtaine d’années. Alors ma grand-mère maternelle est allée le voir et l’a engueulé : « Elle vous aime, vous l’avez fait pleurer, maintenant vous vous occupez d’elle. » Sur la Côte d’Azur, la jeune chanteuse était courtisée par des gens bien plus dangereux que mon père.
Votre mère est décédée très jeune, à 26 ans, dans son sommeil, alors que vous n’aviez que 3 ans et demi. Est-ce que vous « seriez arrivé là » sans ce drame ?
J’essaie d’éviter de trop m’astiquer avec les traumatismes fondateurs, cette tarte à la crème des écrivains. Il y a des vides à combler. Mais si je n’avais pas été capable de mettre quelque chose dans ce vide, je ne serais pas là.
On m’a placé dans une situation atypique, cela ne m’a pas détruit, j’ai juste compris très tôt qu’on pouvait mourir. Je déteste m’entendre dire que je suis boulimique de travail, hyperactif, parce que je fais beaucoup de livres. Je suis juste très conscient que la vie ne dure pas longtemps. J’ai un travail à faire avant de décéder.
A quoi a ressemblé votre enfance, ensuite ?
Mon père a fermé son piano dès que ma mère n’a plus été là. Il a décidé de devenir religieux. Comme la plupart des gens qui décident ça sur le tard, il l’a fait avec trop de gravité. J’ai mis longtemps à découvrir que le judaïsme pouvait être très joyeux. Pour mon père, qui était pourtant marrant avant, c’était des obligations, des interdits, de la terreur, un judaïsme de juriste. Je voyais bien que cela ne l’intéressait pas tant que ça. C’était un deuil.
A partir de 6 ans, il m’a mis dans tous les cours de religion possibles et imaginables. Tous les mercredis et dimanches. Et moi, j’ai passé mon enfance à essayer de le faire marrer, à faire le clown, à raconter, dessiner. Et j’y arrivais !
J’étais entouré de joie chez les grands-parents et amis. Mon grand-père maternel m’envoyait des catalogues de jouets, il me disait « coche ce que tu veux ». Je cochais tout, je recevais tout ! On lui disait qu’il faisait de moi un enfant gâté, il répondait : « Ben non, il est pas con ! »
Le dessin a donc très vite été votre passe-temps ?
C’était le seul truc que mon père ne savait pas faire. Je ne souhaitais pas me mesurer à lui. Avant d’écrire, de lire, je dessinais déjà, des BD. Je n’ai jamais fait de dessins qui ne parlent pas. Mon grand-père m’achetait les super-héros, Conan le Barbare.
Mon père m’a toujours encouragé quand j’ai envisagé de devenir artiste. Il a juste exigé des études sérieuses avant, pour que je puisse être prof au cas où ça ne marcherait pas. J’ai fait une maîtrise de philosophie, c’était passionnant. Dans ma tête, je faisais dialoguer les rabbins du cours d’hébreu avec Platon.
Après, j’ai rejoint les Beaux-Arts de Paris. Ils ont fêté leurs 200 ans en 2016, et m’ont confié un atelier, on a le droit d’y faire des bandes dessinées ! C’est une reconnaissance, pour la BD. On a passé trente ans à se dire que Roy Lichtenstein valait mieux que Hugo Pratt, ce qui est quand même une connerie.
Vous êtes vite parvenu à vivre de la BD, sans avoir besoin d’enseigner la philo ?
Quand j’étais étudiant aux Beaux-Arts, trois éditeurs différents (Delcourt, Dargaud, L’Association) ont accepté mes projets, mais j’ai d’abord publié chez Cornélius. En fait, j’ai dessiné des BD pour tout le monde, nuit et jour.
C’était déjà la même chose qu’aujourd’hui, le travail de quelqu’un qui aime Frankenstein et Romain Gary, qui ne fait pas la différence entre le livre jeunesse et adulte. Certaines BD ont dépassé les 2 millions d’exemplaires (Le Chat du rabbin), d’autres ont bien marché (Petit Vampire, Donjon), d’autres se sont vendues à 2 000 exemplaires, je les aime autant.
La chance de ma génération, c’est le changement du public des BD grâce à nos prédécesseurs, Jacques Tardi, Will Eisner, Art Spiegelman… Nous, le public a bien voulu qu’on s’empare des sentiments, des personnages féminins, du reportage. On n’était pas limités à la BD pour petits garçons.
D’où vous vient cette prédilection pour les monstres et les vampires ?
Que les morts puissent parler me semble être une bonne nouvelle. J’aime les personnages flottants, aussi. Je suis dans le futur. J’ai aujourd’hui vingt ans de plus que ma mère quand elle est décédée. J’ai grandi avec cette peur de ne pas vivre plus vieux qu’elle. Je suis ultra-superstitieux, très oriental, pour ça, une vraie gardienne d’immeuble. Je crois aux sorts, au mauvais œil, je tire les tarots. Chaque jour, je suis ravi d’être là.
J’ai quelque chose d’un ogre, les gestes, la nourriture, l’alcool, le dessin… Quelque chose d’un dévoreur. Un gourmand. Je sais que les gens me trouvent fatigant. Mais ce qu’on ne dit pas assez des dessinateurs, c’est qu’ils passent huit à dix heures par jour dans un silence monacal. Donc dès qu’on sort, on a envie de parler, d’exubérance !
Vous avez réalisé « Gainsbourg, vie héroïque » et adapté « Le Chat du rabbin », tous deux primés aux Césars. Pourquoi avez-vous osé le cinéma ?
Je ne l’ai pas demandé. M’en inspirer me suffisait. Mais sept producteurs m’ont approché pour adapter Le Chat. J’ai toujours dit non. A la fin, chez Dargaud, ils ont fini par me dire que si je ne le faisais pas moi-même, ils le confieraient à quelqu’un d’autre…
Pour Gainsbourg, deux producteurs voulaient adapter une de mes BD très « cul », très « provo » qui ne vendait pas : Pascin. L’histoire d’un peintre des années 1930. Je leur ai dit : « Pascin, au ciné, c’est Gainsbourg ». Ils m’ont répondu que sa famille avait dit non à tout depuis vingt ans. Mais la famille m’a dit oui. Et je me suis retrouvé dans quelque chose de beaucoup plus grand que moi, porté par l’amour d’un pays entier pour ce type-là.
Dans tous mes nouveaux projets, il y a des monstres, des magiciens, des vampires. Je ne trouve pas l’argent pour ça dans un pays écrasé de cartésianisme. Sauf pour un projet de série avec Canal+, qui se tournera au printemps. Huit heures de fiction avec des vampires sur la Côte d’Azur. La suite de mon roman L’Eternel. Ce sera vraiment pour adultes.
Comment êtes-vous venu au roman ?
Par le roman jeunesse, et les films que je n’ai pas réussi à monter. L’Eternel, en 2013, c’était un projet avorté de faire mon Nosferatu le vampire. Puis j’ai eu le projet d’une comédie sur la bonne conscience de gauche. Un philosophe des Lumières qui écrivait contre l’esclavage, lui-même esclavagiste par besoin d’argent.
Mais on m’a dit cette phrase terrible : « Ton domaine, c’est les juifs, ne fais pas de blagues sur les Noirs. » J’ai été comme foudroyé. Comprendre qu’on me percevait comme ça… Plutôt qu’édulcorer, j’ai écrit un roman de 500 pages, un pastiche de conte moral du XVIIIe siècle. Qui s’est vendu à trois exemplaires…
L’an dernier, vous avez publié un roman sur votre père (« Comment tu parles de ton père ») et ce mois d’août, « Vous connaissez peut-être », où vous évoquez votre liaison virtuelle avec une mythomane, sur Facebook…
Il a fallu que je fasse vingt-cinq ans de BD pour aborder en deux livres deux sujets très simples : le plein, le vide. Un petit garçon élevé par son père parce que sa maman a été supprimée du monde par un bon Dieu dont on souhaite qu’il n’existe pas, parce que s’il existe, ce qu’il a fait n’est pas très excusable. Je raconte combien il était facile de m’arnaquer parce que j’étais en situation de vide. Très seul, très demandeur, sans savoir de quoi.
Vous veniez de vous séparer de la mère de vos enfants…
J’étais en puzzle, je découvrais le célibat à 40 ans, j’ai fait n’importe quoi. J’avais les copains, une vie sexuelle trop intense parce qu’on ne m’a pas éduqué à dire non. Ça ne passait pas par Tinder puisque je m’étais inscrit par mégarde comme étant de sexe féminin. Il n’y avait que des lesbiennes qui venaient me parler, me demander pourquoi j’avais mis une photo de Joann Sfar. Je m’en suis rendu compte des mois après…
Dans le livre, je raconte que je pense faire une rencontre sentimentale sur Facebook avec une jolie femme israélienne de 25 ans. Très vite, cela devient autre chose puisqu’elle m’annonce qu’elle a une leucémie mais que ça lui fait du bien de parler.
Elle ne me demande pas d’argent. Cette inconnue, parce qu’elle est malade et que je ne peux pas la voir, réussit à obtenir ce que je ne donne à personne. Elle me vole mon temps. Jusqu’au soir de mon anniversaire, où je pleure seul dans ma baignoire plutôt que sortir avec les copains parce qu’elle exige qu’on se parle.
Vous finissez par porter plainte puisqu’elle répand des rumeurs sur vous, et vous découvrez auprès de la police que c’est une quinquagénaire mythomane en surpoids qui vit en colocation dans le Nord. Elle trompe sa solitude en parlant nuit et jour avec des célébrités…
Elle ressemble à Kathy Bates dans le film Misery. Un cauchemar ! En plus, elle était odieuse. Je me suis infligé une punition. J’ai préféré ce mirage au réel, à un moment. J’adore la modernité. A 12 ans, j’ai vécu l’arrivée du Minitel, je me masturbais au téléphone en parlant d’une grosse voix à des dames. Mais face aux écrans, on a encore une virginité, la même que quand Orson Welles fait croire aux Américains que les Martiens débarquent. La TSF, c’était nouveau. Nous aussi, on a cette candeur.
Avec le livre, cet événement symptomatique a pris sens. Je l’ai mis à distance. Ma fragilité a disparu à l’instant où je suis tombé amoureux. Tout d’un coup, tout s’est remis en place. J’ai besoin d’un couple. Mon manque à moi est féminin. Mon dieu est une déesse.
Vous sortez en novembre un nouvel opus du « Chat du rabbin ». De quoi sera-t-il question ?
D’intolérance religieuse, comme d’habitude. J’ai fait Le Chat comme une œuvre contre le racisme. C’est le chat d’un rabbin mais il n’est pas juif. C’est là le sujet, notre étrangeté face à notre propre famille, ne pas se sentir à sa place. C’est ce que je souhaite à tout citoyen, cela permet de se tenir éveillé.
Avec Le Chat, je voulais inviter les lecteurs à la table d’une famille juive. Quand on mange chez quelqu’un, il est difficile de se disputer. De façon plus souterraine, je montrais des juifs qui ont l’air arabes. Aujourd’hui, je suis K.-O. debout. Dans un constat d’échec absolu, comme toute la gauche caviar, avec ma tentative de faire du vivre-ensemble. On est sur les décombres de ce système. Dans du Michel Houellebecq triomphant.
Vous que le retour du religieux inquiète, quel rapport entretenez-vous avec le judaïsme ?
J’adore le judaïsme, c’est une culture à la fois universaliste et ouverte. Je suis ravi d’être juif tant que ce n’est pas une assignation à résidence. Avec mes deux enfants, on célèbre les fêtes juives chez ma tante, mais enfin on ne va pas s’inventer une ferveur. Je leur ai transmis mon doute. Je refuse la bigoterie juive.
Mon père a fait comme si ma femme n’existait pas pendant douze ans parce qu’elle n’était pas juive. Comme beaucoup de juifs du Maghreb, il se sentait coupable de l’Holocauste, de n’avoir pas pu combattre, de n’avoir pas été déporté. A mes 7 ans, il m’emmenait au Musée de la déportation, en Israël, pour me dire : « Tu vois, Hitler a essayé de rayer les juifs de la carte. Tu dois épouser une femme juive et faire des enfants juifs. »
Mon grand-père qui, lui, avait connu la Résistance, m’a suggéré une réponse : « Dis à ton père que tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler. » Ça m’a gâché l’adolescence. Etre vivant, c’est une fin en soi, pas une culture à faire vivre.
Le 14 juillet 2016, la ville où vous avez grandi, Nice, a subi un terrible attentat. Vous aviez prévu de vous rendre au feu d’artifice ce jour-là…
Oui. Heureusement, mon fils a eu la flemme, on a regardé la télé. Nice, c’est le seul endroit que je connaisse où tout le monde déjeune ensemble. Ce n’est pas une ville tolérante mais on se parle parce que c’est une ville d’hôtellerie, de restauration, que les communautés ont toujours travaillé ensemble.
Cet attentat a tout fait exploser. Les corps sont restés trois jours à ciel ouvert sur la Promenade le temps de l’enquête… Les blessures ne se refermeront jamais. L’évolution en cours me fait peur. A Nice, maintenant, les seuls qui voyagent entre quartiers riches et pauvres, ce sont les chauffeurs Uber.
Propos recueillis par Pascale Krémer
« Vous connaissez peut-être », éditions Albin Michel, 272 pages, 18,50 €.
« La Tour de Bab-El-Oued », éditions Dargaud, 88 pages, 14,99 €, parution le 17 novembre.
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale ici