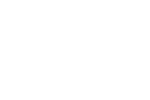A Alger, le Festival de la bande dessinée a fêté ses dix ans
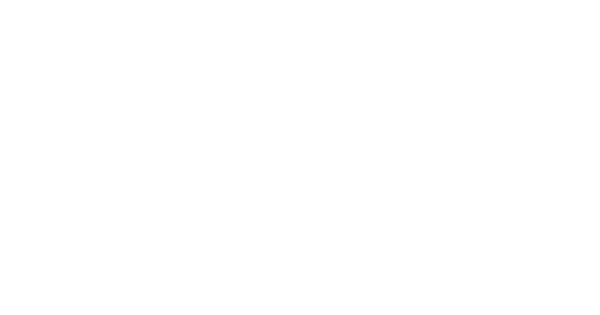
A Alger, le Festival de la bande dessinée a fêté ses dix ans
Par Zahra Chenaoui (Alger, correspondance)
Malgré l’influence du manga japonais, la tradition de la bande dessinée algérienne se transmet aux jeunes auteurs, grâce au Fibda.
Sous une petite tente blanche, Ahmed Haroun, 76 ans, fait une dédicace au feutre noir. Ce précurseur de la bande dessinée algérienne, très sollicité, prend le temps de répondre à ceux qui sont venus à sa rencontre lors du Festival international de la bande dessinée d’Alger (Fibda), du 3 au 7 octobre. « Vous êtes à la retraite ? demande une enseignante au dessinateur qui acquiesse. Ah, alors les enfants doivent être tristes. » Samia, la trentaine, est venue avec ses deux fils. « On leur a lu une histoire à l’école. C’est Monsieur Haroun qui l’a écrite, alors je voulais que les enfants le rencontrent et aient le livre », explique-t-elle.
De sa naissance, en 1967, jusqu’aux années 1980, la bande dessinée algérienne a surtout vécu grâce aux caricaturistes du journal étatique Al-Moudjahid. « C’était l’époque du parti unique, on n’avait pas le droit de caricaturer un ministre ! Et puis il y a eu 1990 », raconte Ahmed Haroun, qui travaillait pour le quotidien officiel.
L’ouverture politique permet alors la création d’un journal satirique Al-Manchar. Pour cette dixième édition, le Fibda a exposé les premiers numéros de cette revue. On y voit tous les acteurs politiques de la transition, et le début des inquiétudes face à la montée du Front islamique du salut (FIS). « Au sein de la rédaction de Al-Manchar, nous avions chacun notre personnage attitré, et il y avait quelqu’un chargé d’enseigner la bande dessinée aux plus jeunes », se souvient celui qui est le père du célèbre personnage Mquidech.
Une génération issue du Fibda
Mais le début de la décennie du terrorisme freine le développement de la bande dessinée, comme des autres secteurs de la culture en Algérie. En 2007, pour son lancement, le Fibda lance la revue Bendir. Ahmed Haroun reprend ses personnages fétiches. « La revue nous a permis de nous réunir à nouveau. Le Fibda a rallumé le flambeau de la bande dessinée algérienne », affirme-t-il.
Les bédéistes algériens Togui et Delou font partie des jeunes talents repérés et formés au fil des dix années d’existence du Festival international de BD d’Alger (Fibda) dont la dizième édition s’est tenue du 3 au 7 octobre 2017. / ZAHRA CHENAOUI
Samedi 7 octobre, à l’entrée de la tente blanche, les plus jeunes auteurs sont à l’honneur. Samir Toudji, dit Togui, 35 ans, Dalia, alias Delou, 28 ans, et Bouchra Mokhtari, 23 ans, dédicacent leurs ouvrages. Tous les trois ont donné une nouvelle dimension à leur passion pour le dessin grâce aux concours et aux ateliers du Fibda. « Le festival est un catalyseur. Les rencontres avec d’autres auteurs font évoluer nos dessins, c’est mieux qu’une école », estime Dalia, qui termine un doctorat en génie mécanique et qui publie Delou, chroniques de la vie d’une étudiante en deridja, l’arabe algérien. Samir Toudji est plus critique : « Le Fibda est une vitrine, mais ça ne suffit pas. Si on veut démocratiser la bande dessinée, il faut qu’elle soit moins chère, que des éditeurs se forment pour développer le secteur. Ça ne marchera pas avec seulement deux éditeurs pour tout le pays. »
Sur le stand de l’Enag, la maison d’édition d’Etat, les ouvrages historiques réédités n’attirent pas les foules. L’animation est ailleurs. Devant la librairie, deux jeunes filles, cheveux teintés de rose et de violet et relevés en chignon, jupe courte et chemisier, se fraient un chemin au milieu du public. A chaque mètre, elles sont arrêtées par de jeunes garçons qui se prennent en photo avec elles, téléphone portable à bout de bras. Les deux jeunes filles sont venues pour participer au concours de Cosplay, une compétition de déguisements de personnages de mangas japonais. Wahid, 24 ans, a les lèvres rouges, les cheveux teints en vert et une chemise violette. « J’aime beaucoup le personnage de Joker, explique-t-il. Il n’y a qu’au Fibda qu’on peut se déguiser en public. »
Le succès du Cosplay
Personnages de mangas stars, héros d’heroic fantasy ou de films cultes, les costumes sont parfois très professionnels. « Au début, on avait des candidats avec des costumes en carton. Désormais, il y a des perles ! Certains peuvent devenir des professionnels du costume, grâce à la reconnaissance de l’Etat », analyse Salim Brahimi, responsable des éditions Z-Link, une maison qui édite de nombreux auteurs de mangas et organise le concours dans le cadre du Fibda.
Lors des premiers jours du festival, ce sont les participants costumés qui ont rempli les allées bien vides. Mais samedi, il fallait jouer des coudes contre les barrières pour entrer. Pantalon et pull noirs, baskets aux pieds et grandes lunettes de soleil, Dalila Nadjem, 61 ans, commissaire du Fibda et responsable de la maison d’édition Dalimen, traverse l’esplanade en souriant. « Je suis ravie de voir qu’il y a la queue à la librairie ! Et regardez, tous ces jeunes, ils ont payé leur entrée. »
Sans soutien financier de l’Etat, austérité oblige, les organisateurs avaient augmenté le prix de l’accès au site et craignaient que cela ne refroidisse les habitués de la gratuité. Mais les chiffres sont bons. Plus de 14 000 entrées ont été vendues pendant le festival. Dalila Nadjem conclut : « En dix ans, on a au moins gagné ça : un public ! »