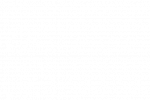Cécile Van de Velde : « Les jeunes portent aujourd’hui à l’extrême la revendication d’être acteurs de leur vie »

Cécile Van de Velde : « Les jeunes portent aujourd’hui à l’extrême la revendication d’être acteurs de leur vie »
Propos recueillis par Laure Belot
Dans un monde en pleine mutation, les jeunes ne doivent pas hésiter à réfléchir sur leur choix et à changer d’orientation plus tard, analyse la sociologue Cécile Van de Velde.
Cécile Van de Velde est professeure de sociologie à l’université de Montréal, où elle dirige une chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie. Egalement membre de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris, elle a publié Sociologie des âges de la vie (Armand Colin, 2015).
Dans un monde en pleine mutation, qu’observez-vous chez les jeunes qui cherchent à s’orienter ?
Ce qui est difficile à vivre aujourd’hui, c’est le double discours qui entoure l’orientation. On dit aux jeunes : « Vas-y, choisis ta voie, sois toi-même ! », et en même temps : « Tout est bouché, sois stratégique et dépêche-toi ! » Ce discours paradoxal est porté également par les parents. Il crée un vertige du choix, alors même qu’il y a peu de perspectives. Comme si trouver sa voie pouvait être une révélation.
Tout récemment, une jeune Montréalaise me disait : « J’ai trop de choix, je n’y arrive plus. » Alors qu’il existe une multitude d’endroits pour trouver de l’information, le choix peut être anxiogène. Source de liberté, il peut se révéler aussi source d’angoisse, de vertige, voire de solitude, même chez les gens très entourés, avec des parents qui conseillent, des amis qui cherchent aussi leur voie… Nous sommes dans une culture de l’immédiat et on entretient l’idée que ce choix pourra se faire rapidement.
Ce qui manque, c’est du temps, du temps pour soi. Du temps pour faire le point. Il faut oser le temps long pour se trouver, s’ajuster, choisir et rechoisir son chemin. Avancer par tâtonnement, par refus, par addition successive d’expériences, tout au long de sa vie, c’est un processus qui dure jusqu’à la retraite. On l’oublie ou on le nie. La société française a peu pensé ce temps long de la construction de soi.
Cela peut-il expliquer le pessimisme des jeunes Français face à l’avenir ?
En France, effectivement, les jeunes sont très angoissés et pessimistes, mais les Japonais et les Coréens aussi ! Ce qui nous donne une piste pour mieux comprendre. Dans ces sociétés qui ont tout fait jouer sur le diplôme, qui envoient le message qu’un adulte c’est avant tout un diplômé – davantage qu’un sujet –, les jeunes vont être atteints dans leur confiance parce qu’il faut aller vite, choisir vite. Et ce encore plus en temps de crise, quand il faut gagner la compétition scolaire pour avoir des chances de se placer sur le marché du travail. Ces modèles forcent le choix précoce et créent un enjeu autour de l’« orientation », comme on le voit en ce moment en France.
Dans les sociétés où on dit : « Tu as le temps, le temps de choisir et le temps de te tromper », là, l’optimisme et la confiance sont plus forts. A l’université de Montréal, dans mes séminaires, on trouve des personnes de 30, 40 ou 50 ans, qui reviennent aux études pour changer de vie. Le droit à l’échec est aujourd’hui essentiel. Cela n’enlève pas toutes les difficultés bien sûr, mais cela crée de la confiance, du bien-être collectif. La possibilité de se tromper allège ce sceau d’angoisse et de pression que l’on trouve chez les jeunes Français… Il faut reconnaître le temps du choix, instituer la possibilité de rebondir ou de se réinventer.
Parmi les enfants entrant en primaire, 65 % travailleront dans des emplois qui n’existent pas encore. Dans ce monde qui se complexifie, les parents semblent encore plus angoissés que la jeune génération…
Oui. Il y a encore plus d’angoisse chez les parents qui subissent la crise. La génération qui vient est une génération charnière, en tension entre deux mondes, comme celle de Mai 68. Dans mes enquêtes, j’ai pu constater que par ses valeurs et ses aspirations, c’est cette génération qui détient aujourd’hui les clés de sortie de crise. La question qui se pose est celle-ci : va-t-on enfin oser, en tant que société, lui faire confiance et lui ouvrir les portes ?
Son problème est qu’elle hérite d’un modèle très empreint du passé, le modèle du métier à vie. Le modèle d’une éducation qui se faisait pendant le temps de la jeunesse. Or, la jeune génération est aujourd’hui portée par une grande quête de « sens », mais se heurte à ce modèle et à un monde qui ne fait plus envie. Elle se retrouve en tension entre son besoin de sens et les pressions de la compétition. Entre « vivre sa vie » et « gagner sa vie », on leur demande désormais de choisir. Ceci crée des déviations, des tensions voire de la colère. Cette adversité devient un enjeu social et démocratique majeur. J’observe que même chez ceux qui suivent encore l’ascenseur social, beaucoup n’y croient plus et critiquent les règles du jeu. Et de plus en plus de jeunes choisissent désormais les chemins de traverse, construisent leur propre « case », ou sortent du « système ».
Irina Bokova, l’ex-directrice de l’Unesco, va jusqu’à parler de changement de civilisation. Le percevez-vous dans les agissements des jeunes ?
Oui ! Je pense que nous sommes à une fin de cycle, à un moment charnière. Les jeunes portent déjà un nouveau monde, un nouveau rapport au temps, une forme d’accélération de la société. C’est une génération du décalage : du décalage entre le monde dont elle hérite – un monde qui se vit en crise et en déclin –, et le monde qu’elle va porter, le monde de l’ouverture, de la connexion. D’ailleurs, je suis frappée par la forte différence entre la génération des 20 ans, qui commence à jouer sa propre carte, et celle des 30 ans, qui a cru en la promesse sociale et se sent davantage trahie.
J’ai la chance dans mes enquêtes de rencontrer ces jeunes adultes, ces « enfants du siècle », à différents endroits de la planète, comme à Montréal, Paris, Madrid, Hongkong… Je constate qu’ils ont une énergie très particulière. Bien sûr, il y a de très fortes inégalités internes, mais certains traits communs émergent. C’est une génération éduquée et très critique, qui peut marquer son histoire. Face à l’adversité, elle cherche un nouveau sens et défend une forme d’existentialisme, elle a envie de vivre ce présent, de redonner du sens, sans peur de la mobilité. Si on lui laisse les clés, elle aura des choses à changer.
Comment expliquez-vous cette revendication si affirmée d’être « acteur de sa vie » ?
C’est ce qu’on leur a appris dès l’enfance ! Les jeunes portent aujourd’hui à l’extrême cette revendication parce qu’ils ont été « socialisés » à cela : être soi-même, se trouver, cette idée que notre vie serait comme de l’argile et qu’il faut en quelque sorte la sculpter. Cette injonction à « choisir ses expériences » est accentuée par les réseaux sociaux où il y a beaucoup d’ostentation sur ce qu’on réussit à vivre. De plus, ils portent une volonté de « ne pas subir, ne plus subir » car ils ont vu leurs aînés souffrir de la crise. « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme », disait Nelson Mandela en prison.
On observe d’ailleurs une politisation accrue des vies. Des petits actes quotidiens – consommer, manger bio, aider la voisine âgée, choisir sa vie, quitter un travail salarié qui ne plaît pas… – sont souvent associés à un discours très réflexif contre la société. Ils deviennent codés comme des actes politiques. Ça veut dire qu’on a conscience de changer le système, à petits pas : « à défaut de changer les vies, je change ma vie » ; « le changement c’est maintenant et c’est moi ! » L’ancien monde, on est obligé de se mouler dedans, mais par des petites brèches, on va casser les murs.
Cette nouvelle génération affiche une nouvelle approche du travail. En France, la proportion d’étudiants voulant rentrer dans de grandes entreprises ne cesse de baisser…
Ce n’est pas étonnant. Il y a une défiance de plus en plus forte à l’égard du travail salarié. Dans mes enquêtes, j’observe les rêves et les aspirations qui sont en train d’émerger. A Montréal, c’est par exemple d’ouvrir sa microbrasserie de bière ou, dans les milieux plus populaires, de créer son petit commerce d’informatique. A Paris, on parle de créer sa start-up, son entreprise individuelle ou son association. Ces aspirations répondent à la dureté du marché du travail salarié, où ils se sentent souvent « bradés » ou « gâchés », alors qu’ils ont une vraie envie de participer.
La confrontation avec le marché du travail, la recherche d’emploi, la première expérience professionnelle dans des emplois de services (être serveur par exemple pour payer ses études) sont souvent perçues comme difficiles voire violentes. Ce n’est pas l’autorité en soi qui est remise en cause : quand elle est pensée comme légitime, elle est acceptée. Ce qui est rejeté, c’est l’idée d’une pression absurde, la perte de sens, la sensation d’être réduit dans son être et sa valeur, d’être « marchandisé ».
La valeur travail n’a pas baissé au cours des générations, on voit au contraire qu’elle a presque augmenté sur certaines dimensions. Elle va de pair avec l’envie de pouvoir s’exprimer, d’exister pour soi et pour les autres dans le travail, d’avoir une place qui répond aux aspirations. Cette approche affective et créative passe aujourd’hui par le modèle du free-lance, de l’artiste, ou de l’indépendant, beaucoup plus que du travailleur salarié.
Ceux qui ont commencé à travailler peuvent émettre des réserves. Comment l’expliquez-vous ?
On voit en effet apparaître ceux que j’appelle les « loyaux critiques » : ils ont un travail salarié, mais ils n’y croient plus. Ils observent, travaillent, mais ne se sentent pas considérés à leur juste valeur, surtout pendant les premières années. On voit alors monter le rêve d’aller plus loin, ce qui passe souvent par l’indépendance professionnelle.
Cette tension augmente parmi les jeunes diplômés qui ont suivi la voie royale, qui ont répondu aux attentes, qui ont « gagné la course ». Ils se savent plutôt chanceux – ils ne se plaignent pas – mais ils développent un discours radicalement critique contre le « système ». Ils disent qu’ils « achètent du temps », trois ou quatre ans, et qu’ensuite, quand ils auront remboursé leurs crédits ou leurs dettes, quand ils auront la force ou les réseaux nécessaires à la construction de leur projet personnel, ils se construiront leur propre place.
Les dispositifs tels que les autoentrepreneurs alimentent cette idée de libérer les possibilités, de sortir de ce qui est considéré comme le carcan d’une hiérarchie salariée, même si cela crée aussi des illusions et de la précarité.
Observez-vous une modification du rapport à l’autorité ?
On voit clairement une évolution du rapport à l’autorité. Pour résumer, on passe du « chef », celui qui donne des ordres indiscutables, à « l’accompagnant », le leader, celui qui va permettre de faire éclore la créativité, l’autonomie, l’être. Je le sens à l’échelle de ma profession : la façon de donner des cours, de suivre les étudiants qui font leur maîtrise par exemple, a changé en l’espace d’une dizaine d’années.
Aujourd’hui, je me considère beaucoup plus comme quelqu’un qui va accompagner l’étudiant dans l’élaboration de son propre projet, que comme un « sachant » qui aurait à donner des ordres ou à imposer une hiérarchie. On est davantage dans une relation symétrique et c’est assez symptomatique de ce refus d’une autorité considérée comme non nécessaire.
Vous décrivez une jeunesse très connectée. Certains ont aussi plus de mal. Peut-on parler de plusieurs jeunesses ?
Oui, on peut parler de plusieurs jeunesses. Cette génération est soumise tout à la fois à l’ouverture et à la crise, avec toutes ses tensions. Et je sens partout qu’une fracture est en train de se créer au sein des jeunes. Il y a cette frange majoritaire, diplômée, mobile, connectée, et qui se sent dans le monde. Mais il y a aussi celle qu’on oublie parfois parce qu’elle est plus invisible, plus silencieuse. Cette frange des moins diplômés, touchés de plein fouet par la crise, et qui se retrouvent atteints jusque dans leur confiance en soi. On la retrouve en France, mais aussi dans nombre de pays voisins.
L’absence de diplôme est-elle une des causes ?
Cette frange qui décroche, en quelque sorte les « perdants des perdants », n’est pas exactement la même selon les sociétés. Mais on y retrouve en effet les peu diplômés et les jeunes enclavés dans des territoires qui ne leur donnent pas les ressources pour survivre sur un marché du travail mondial. Ces franges-là se retrouvent de plus en plus dans des trajectoires d’impasse. Ce qui est très touchant quand on les interroge est de voir combien leurs vies se sont refermées comme des pièges face à l’absence de diplôme. Le diplôme devient, dans la compétition sur le marché du travail, un attribut minimum qui va discriminer ceux qui en sont dépourvus.
Je rencontre des jeunes dans des formes de retrait social, de sentiment d’abandon par la société, et à qui l’on demande encore de formuler un « projet »… Quand on a été refusé dix, quinze fois, quand on a écrit parfois des centaines de lettres de candidature et que jamais il n’y a eu une seule réponse, on perd ce qu’on a de plus précieux : l’estime de soi.
Mondialement, le clivage entre diplômés et non diplômés se creuse-t-il ?
Oui, et cette fracture se joue au niveau mondial. La frange diplômée se sent appartenir à une jeune génération globale et a les ressources pour critiquer l’effet de la crise sur leurs parcours. Chez les jeunes qui décrochent, on observe une forme d’intériorisation de l’échec et de responsabilisation individuelle, qui a été soulignée dans de nombreux travaux. Cela se traduit différemment selon les sociétés – des problématiques de « sans-abrisme » précoce au Canada, d’enfermement durable chez les parents au Japon, d’enclavement territorial en France… Mais il faut désormais penser en termes de classes sociales au niveau mondial.
Cette fracture se voit d’ailleurs également au niveau politique. Cette frange-là va réagir très fortement soit par le retrait du vote et l’abstention massive, soit parfois par une sensibilité aux populismes, aux discours du type « on vous a compris, on va vous aider ». Cette tendance est un enjeu politique majeur pour la décennie à venir.
Vous travaillez actuellement sur la colère des jeunes. Pourquoi ?
Le sujet de la colère sociale n’était pas présent au départ, il s’est imposé à moi au cours de mes enquêtes comparatives. J’ai été très frappée par le niveau de colère, par le niveau de critique « antisystème », y compris de ceux qui étaient à l’intérieur même de ce système et qui ont réussi. Cette colère dérive directement du monde qu’ils reçoivent et qui ne répond pas à leurs aspirations. Mais elle est aussi liée à ce qu’ils ont compris de la vie de leurs parents. La colère envers la société, envers le marché, envers les modes de gouvernement est d’autant plus forte chez ceux, et ils sont nombreux, qui ont été témoins de sacrifices parentaux.
On la voit particulièrement chez les enfants de migrants, qui ont vécu cette souffrance parentale du déclassement face à la migration. Quand on a vu ses propres parents souffrir de leur situation, on commence à douter, on ne croit plus aux promesses sociales. Témoin impuissant pendant l’enfance, on se dit « moi, je vais agir, je vais jouer ». Je retrouve cette transmission intergénérationnelle de la colère à différents endroits dans le monde. C’est une colère sourde, une colère larvée, mais une colère qui peut avoir des impacts sociaux majeurs si on l’étouffe ou si on ne parvient pas à la transformer en énergie sociale positive.
Participez à « O21 / S’orienter au 21e siècle »
Pour aider les 16-25 ans, leurs familles et les enseignants à se formuler les bonnes questions lors du choix des études supérieures, Le Monde organise la seconde saison d’« O21 / S’orienter au 21e siècle », avec cinq rendez-vous : à Nancy (vendredi 1er et samedi 2 décembre 2017, au centre Prouvé), à Lille (vendredi 19 et samedi 20 janvier 2018, à Lilliad), à Nantes (vendredi 16 et samedi 17 février 2018, à la Cité des congrès), à Cenon, près de Bordeaux (vendredi 2 et samedi 3 mars 2018, au Rocher de Palmer) et à Paris (samedi 17 et dimanche 18 mars 2018, à la Cité des sciences et de l’industrie).
Dans chaque ville, les conférences permettront au public de bénéficier des analyses et des conseils, en vidéo, d’acteurs et d’experts, et d’écouter et d’échanger avec des acteurs locaux innovants : responsables d’établissements d’universités et de grandes écoles, chefs d’entreprises et de start-up, jeunes diplômés, etc. Des ateliers sont aussi prévus. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à une ou plusieurs conférences d’« O21 » Nancy en suivant ce lien. Pour les autres villes, les inscriptions se font via ce lien.
Pour inscrire un groupe de participants, merci d’envoyer un e-mail à education-O21@lemonde.fr. L’éducation nationale étant partenaire de l’événement, les lycées peuvent organiser la venue de leurs élèves durant le temps scolaire.