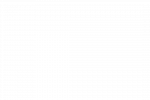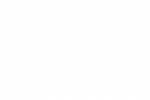Philippe Decouflé : « Ma rencontre avec la danse s’est faite dans les boîtes de nuit »

Philippe Decouflé : « Ma rencontre avec la danse s’est faite dans les boîtes de nuit »
Propos recueillis par Catherine Vincent
Le danseur et chorégraphe présente « Nouvelles pièces courtes » au Théâtre national de Chaillot, à Paris, à partir du 29 décembre. Il s’est confié à « La Matinale du Monde ».
Je ne serais pas arrivé là si…
… Si je n’étais pas tombé en arrêt dans la rue, à 13 ans, devant la photo d’un type avec un masque neutre – ce masque qui oblige les comédiens à utiliser leur corps pour exprimer leurs émotions. C’était celui du mime et chorégraphe Isaac Alvarez, qu’il avait fait faire d’après son visage. J’étais si fasciné que j’ai pris contact avec lui.
Alvarez dirigeait de grands stages dans le sud de la France : j’étais très jeune pour cette aventure, mais il a accepté de m’accueillir un premier été, et j’ai su immédiatement que j’allais passer ma vie à faire ça. Les années suivantes, j’y ai passé toutes mes vacances. J’ai tout adoré et découvert qu’on pouvait bosser dans le plaisir, ce que je n’ai plus cessé de faire.
Que se passait-il durant ces stages ?
Isaac était le maître. Au saut du lit, avant même le petit déjeuner, on faisait un grand cercle dans un gymnase autour de lui et on commençait à travailler : il fallait se mettre en situation de traverser des fleuves, ou devenir pierre, ou air, ou oiseau… Il utilisait beaucoup les éléments naturels. Ses assistants donnaient aussi des cours de mime, d’acrobatie.
Et l’après-midi : massage ! Ça, c’était extraordinaire. Les séances étaient assez techniques, il y avait de l’encens, de la musique planante, des lumières tamisées… On était au milieu des années 1970, l’ambiance était très Flower Power. Pour la première fois, je touchais plein de corps, des corps d’hommes, des corps de femmes – ce qui m’intéressait nettement plus.
Mais le moment vraiment magique, c’était le soir. Le maître lançait des thèmes et désignait des stagiaires pour les mettre en scène dans de grandes improvisations dont il démontait la mécanique. Avec Marcel Marceau et Jacques Lecoq, Alvarez faisait partie d’une génération qui avait renouvelé l’art du mime, et son enseignement était extraordinaire. Il m’impressionnait beaucoup.
C’était votre premier contact avec le monde du spectacle ?
J’ai toujours adoré les déguisements, les maquillages. Quand j’étais petit, j’étais fasciné par Alice Cooper… Et je ne sais pas si j’aurais pu supporter le lycée si je n’avais pas eu une prof de français géniale qui m’a fait faire du théâtre en 6e. Ma seconde 6e, car à l’époque, j’étais bien parti pour rater en tout !
La seule chose que j’aimais, c’était dessiner : j’adorais reproduire les personnages de Pilote ou de Tex Avery. Et voilà qu’avec cette prof, on monte La Cantatrice chauve, et que j’y joue l’un des pompiers. Pour ce rôle, je m’étais fabriqué un casque en papier d’aluminium, très fragile mais magnifique, avec lequel j’avais le costume le plus spectaculaire de tous. D’un seul coup, un monde s’ouvrait devant moi, dans lequel je pouvais trouver ma place.
La chance que j’ai eue, c’est d’avoir pu en faire un métier. Et d’avoir quitté le lycée juste après le brevet élémentaire, pour entrer à 15 ans à l’école du cirque d’Annie Fratellini – la seule à laquelle on pouvait accéder sans passer de concours. J’étais nul en gym, pas du tout physique, mais ils ont accepté ma candidature. Il faut dire que mes stages avec Alvarez m’avaient fait prendre une sacrée avance.
Que disaient vos parents de tout ça ?
Tous les deux étaient des intellectuels de gauche, ouverts, aimant les arts. Ils m’ont toujours laissé une grande liberté. Et puis, ma mère voulait être danseuse, c’était un rêve de petite fille. C’est elle qui m’a transmis le goût de la danse. Qui m’a fait découvrir les premiers spectacles dont je me souviens, mes premières expos, les films qui m’ont marqué…
Elle m’a fait aimer Eisenstein, Fellini, Truffaut. Et, plus que tout, Les Enfants du paradis, qu’elle adorait. J’ai dû voir ce film une dizaine de fois quand j’étais enfant ! Mon frère aîné s’appelle Pierre-François à cause de Pierre-François Lacenaire, une de mes filles s’appelle Garance, et j’en ai voulu à ma mère de ne pas m’avoir appelé Baptiste, ce personnage à la fois charmeur, timide et fragile que joue merveilleusement Jean-Louis Barrault…
C’est à elle que je dois ma liberté de création : elle m’a poussé à avoir confiance en moi, à aller là où j’avais envie d’aller.
Et votre père, il vous a lui aussi encouragé dans cette voie ?
Mon père était un cerveau. Il avait été le plus jeune bachelier de France, il était sociologue et futurologue, il travaillait beaucoup, parlait beaucoup – j’avais du mal à comprendre ce qu’il disait –, mais il ne s’occupait pas trop de nous. Et encore moins pendant mon adolescence, car mes parents se sont séparés quand j’avais 12-13 ans.
Comme c’est lui qui était parti, c’était lui le méchant à mes yeux, ce qui ne facilitait pas notre relation. C’était vraiment quelqu’un qui passait son temps à réfléchir à l’état du monde, ce qui le rendait assez dépressif. Mais il m’a donné une chance, celle de voyager quand j’étais petit. Il travaillait alors pour l’Unicef, et nous avons pendant plusieurs années habité au Maroc, puis au Liban – je savais reconnaître tous les avions israéliens qui passaient dans le ciel. Rencontrer d’autres cultures quand on est gamin, autrement qu’en touriste, c’est un vrai cadeau : après cela, on ne peut pas envisager d’être raciste. Et on devient curieux du monde.
A 15 ans, donc, vous entrez à l’école du cirque… Quand rencontrez-vous la danse ?
Plus tard. A l’époque, ce que j’avais vu de plus moderne, c’était Béjart, avec ses poils et ses collants, et toutes ces femmes qui étaient folles de lui… Il y avait là une dimension sexuelle qui me dérangeait un peu. J’ai passé un an à l’école du cirque, puis un an à l’école de Marcel Marceau, j’ai fait quelques premiers projets pour gagner ma vie : je me cherchais encore, et ça m’a permis d’apprendre des choses très diverses.
Quant à ma rencontre avec la danse, elle s’est d’abord faite dans les boîtes de nuit parisiennes où j’allais avec mes copains ! Pour peu qu’on se présente comme un joli petit personnage bien habillé, l’entrée était gratuite aux Bains Douches. Mais après, si on restait inactif, il fallait consommer : on prenait donc un verre, puis on dansait non-stop. C’est comme ça que j’ai découvert ce plaisir-là, ces endorphines que la danse génère au bout d’un certain temps.
Je me suis aperçu que je pouvais jouer avec ce que j’avais appris, en faire quelque chose qui swingue, inventer des pas, improviser sur la musique. J’ai commencé à m’intéresser aux chorégraphes américains et allemands, à ceux qui révolutionnaient alors la danse contemporaine. Et puis un jour, j’ai vu Karole Armitage danser.
Karole Armitage ?
Une danseuse et chorégraphe américaine, qui travaillait dans la compagnie de Merce Cunningham. Elle faisait un truc avec un guitariste, un solo qui durait un temps infini et qui était ex-tra-or-di-naire. Pour moi, c’est une révélation artistique : soudain, je comprends que je peux transposer dans la danse l’énergie que me procure la musique.
J’obtiens une bourse pour partir à New York, je travaille avec Merce Cunningham, avec Alwin Nikolais, j’ai trois dollars en poche mais je vis à cent à l’heure… Ce fut une période géniale.
De retour à Paris, très vite, j’ai envie de voler de mes propres ailes. En 1983, je gagne le concours de chorégraphie de Bagnolet, ce qui me permet de monter ma propre compagnie de danse. Avoir une compagnie à soi, c’est la garantie de pouvoir faire à peu près ce qu’on veut. A dater de ce moment, je me suis arrangé pour vivre autant que possible ce qui m’avait tant plu dans les stages avec Alvarez. J’ai recréé cette ambiance avec ma troupe, qui est un peu comme une famille. Et comme lui, j’ai toujours pratiqué le mélange des arts.
On dit de vous que vous faites des spectacles « totaux ». Vous reconnaissez-vous dans cette qualification ?
Le terme est un peu prétentieux, mais c’est vrai que j’aime habiller mes chorégraphies de beaucoup d’autres choses – acrobaties, costumes, lumières, musique live, vidéo. Je me nourris des autres modes d’expression pour créer mes spectacles. J’aime les images complexes, et j’aime jouer avec les sens du spectateur.
En 1992, on vous confie la mise en scène des festivités d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques (JO) d’Albertville, qui vous ont rendu célèbre. Quel souvenir en gardez-vous aujourd’hui ?
D’abord, celui d’un coup de bol extraordinaire. Ma première chance avait été de monter en 1989 La Danse des sabots, l’un des spectacles du défilé du bicentenaire de la Révolution française mis en scène à Paris par Jean-Paul Goude. C’est grâce à ça que ma candidature a été présentée pour les JO. Je revenais du Japon, j’avais très peu travaillé ma présentation, j’ai parlé de la glace et du feu, j’ai montré un clip que je venais de faire…
Et ma deuxième chance, c’est que Jean-Jacques Annaud, pressenti pour ce projet depuis déjà longtemps, voulait envoyer des anneaux olympiques dans la stratosphère, ce qui explosait le budget. Les organisateurs cherchaient donc quelqu’un de moins gourmand.
Du jour au lendemain, je me suis ainsi retrouvé avec tout dans les mains : j’avais 30 ans, beaucoup d’énergie et beaucoup d’idées, j’avais du temps devant moi, une super-équipe, et on me proposait 100 millions pour monter un spectacle ! On n’a fait que ça pendant un an et demi. Ce fut une période fabuleuse. J’avais ma voiture avec chauffeur, je vivais dans des conditions extraordinaires, dès que j’arrivais là-bas, tout le monde s’occupait de moi… J’étais le roi du pétrole.
Y a-t-il eu un avant et un après JO d’Albertville ?
Dans ma créativité personnelle, je n’en suis pas sûr. Cela m’a surtout donné plus de moyens. Mais aussi une célébrité dont je n’ai su que faire. En fait, être connu m’a posé énormément de problèmes. Cela m’a encombré. On a commencé à me solliciter pour toutes sortes de choses, et je me suis dispersé.
Jusque-là, je contrôlais l’image que je donnais de moi. Et soudain, cela m’a complètement échappé. Je ne savais plus si je devais présenter la personne que les gens attendaient ou celle que j’étais vraiment, et ça m’a beaucoup déstabilisé. Quand on vous a dit dix fois que vous étiez génial, vous finissez par le croire ! Cela a créé une forme de renfermement sur moi-même, j’ai fait moins attention aux autres. Humainement, ce n’était pas une bonne chose.
Les JO, une revue pour le Crazy Horse, des spectacles intimes comme « Octopus » et des beaucoup plus grands tel « Paramour » avec le Cirque du Soleil (2016, Broadway) en passant par « Mon nom est Shingo » (2016, Japon) : comment concevez-vous vos créations ?
Ma principale règle, c’est de ne pas avoir de règles. Certains spectacles se montent en quelques semaines, d’autres prennent plus d’un an. J’ai besoin de me tromper, et j’ai besoin qu’on me fiche la paix quand je me trompe. Pour moi, un spectacle a intérêt à être mauvais jusqu’à la veille de la première : ça fait partie du processus de création. La souplesse est essentielle. Nouvelles pièces courtes, par exemple, est né d’une première version qui s’appelait Courtepointe, et le spectacle continue à se modifier chaque mois.
Quand je danse moi-même, j’aime avoir sur scène un certain nombre de rendez-vous – avec une lumière, avec une musique, avec un point au sol ou un autre danseur –, mais aussi, entre ces rendez-vous, avoir la paix et faire ce que je veux. J’essaye d’offrir le même espace de liberté à mes danseurs.
Dans ces spectacles hauts en formes et en couleurs, où se cache votre jardin secret ?
J’ai un handicap : j’ai énormément de mal à raconter une histoire aux spectateurs. Cela vient sans doute de mon père, de mes parents qui écrivaient tous les deux. Je ne suis pas très littéraire, je suis beaucoup plus sensible aux couleurs, aux formes, à la plastique des choses, et j’ai du mal à trouver une narration qui me semble assez intéressante pour la raconter tous les soirs de la même manière.
Cela m’a empêché de faire du cinéma – j’ai passé beaucoup de temps à travailler sur des projets de films qui ne se sont pas faits. Mais c’est peut-être aussi un atout : cela m’a poussé à développer sur scène une écriture qui se passe d’histoire. Ou plutôt : avec des bribes d’histoires qui se mélangent et se croisent.
Car je raconte beaucoup de moi dans mes créations, sans que le spectateur le sache. Ma maman qui me manque – elle est morte il y a quelques années –, c’est dans mon dernier spectacle. Mon rapport à mon père aussi. J’utilise ce qui me touche quand je sens que ça dépasse l’ordre du privé, que ça devient une émotion partageable.
Parfois, ce qui m’a animé est d’ailleurs l’inverse de ce que ressent le spectateur ! Mon meilleur ami venait de mourir quand j’ai créé Décodex [en 1995], et j’ai mis toute ma rage dans ces danses, mais les spectateurs recevaient un message positif. Et Le P’tit Bal perdu [clip créé en 1993 sur une chanson de Bourvil], que les gens trouvent en général si joyeux, je l’ai fait à la suite d’une séparation qui m’avait mis plus bas que terre.
Vous avez dit récemment que vous adoreriez chorégraphier un typhon…
Voici un bel exemple de l’influence de la vie sur l’art ! Cette envie est née lors de mes dernières vacances, passées début septembre avec mes deux filles en Martinique. On était en pleine nature, et juste entre deux passages d’ouragan. J’ai donc vécu en direct ce moment si particulier où tout le monde se prépare, parle du mauvais temps, où tout devient absolument calme la veille du typhon, où l’on se calfeutre chez soi et où l’on attend…
Finalement, le typhon est passé au large de l’île. Mais l’idée est restée, elle est en gestation. Même si je suis citadin, les états et les mouvements naturels me fascinent de plus en plus en vieillissant – encore un héritage d’Alvarez ! J’ai envie de danser la nature, et dans la nature.
Propos recueillis par Catherine Vincent
« Nouvelles pièces courtes », par la compagnie DCA de Philippe Decouflé, du 29 décembre au 12 janvier 2018, au Théâtre national de Chaillot, puis en tournée.
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale ici