Eloge du jeu vidéo comme plaisir tactile
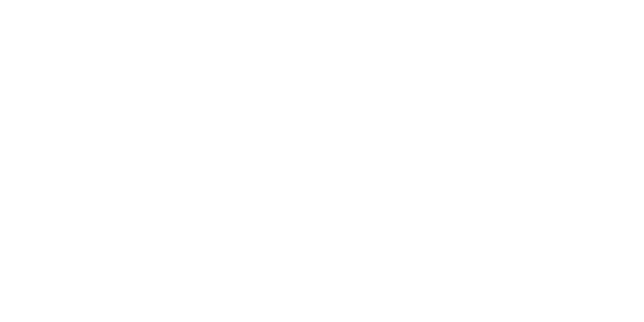
Eloge du jeu vidéo comme plaisir tactile
Par William Audureau
En annonçant Nintendo Labo, une gamme de jouets en carton, Nintendo rappelle que le jeu vidéo est autant un plaisir pour les yeux que pour les doigts.
Le jeu vidéo, le plus digital de tous les arts numériques. En annonçant mercredi 17 janvier Nintendo Labo, une gamme de jouets en carton pour console, Nintendo est venu souligner l’une des particularités les plus oubliées du jeu vidéo : celle d’être une production culturelle que l’on touche.
Aux antipodes des promesses médiatiques de la réalité virtuelle, qui en englobant la vision, tente de faire oublier notre propre corps, l’art de la manette a toujours été de facto un art tactile. Même le vocabulaire du secteur le souffle discrètement : qu’est-ce que cette jouabilité, cette ergonomie, ce « gameplay », tout ce jargon dont on nous rebat les oreilles, si ce n’est l’aveu que le jeu vidéo se ramène toujours à une interface physique, palpable, et même sensitive, entre le joueur et le dispositif de jeu ?
Cette dimension proprement digitale – du latin digitus, le doigt – le joueur en porte la mémoire sensorielle. Loin des pixels, des polygones et des voxels qui s’agitent à l’écran, ce sont ces manettes douces ou rugueuses que l’on empoigne, les grips qui agrippent, les plastiques qui glissent. Ce sont les pavés directionnels qui nous écornent les pouces, les croix qui nous écrasent la pulpe, les chaussettes ou les mitaines que l’on chausse, pour une partie trop éprouvante de Mario Party ou Track Mania, célèbres plaisirs vidéoludiques qui sont autant de souffrances digitales.
Volants, pistolets, bongos
Et puis, il y a tous ces accessoires, qui n’ont de valeur que lovés entre les mains, jouets sacrés d’un âge sans âge : les volants en PVC que l’on agite dans les airs, au volant de karts virtuels ; les pistolets orange que l’on braque, bras tendus et index crispés, sur d’innocents canards de pixels ; ou les bongos que l’on martèle, les guitares que l’on pianote, les buzzers que l’on champignonne, dans un grand concert de cliquetis de boutons.
Obnubilé par le rectangle animé dans lequel se joue sa bataille de pixels, le joueur oublie-t-il totalement les sensations qui l’accompagnent dans sa petite transe ludique ? La pièce de jeu est à elle seule tout un théâtre de gestes et de sensations : en arcade, la breloque de métal que l’on cherche dans sa poche obscure pour l’insérer dans la machine ; dans le salon, la choucroute noire et récalcitrante de fils emmêlés dans lequel les bras se perdent ; dans le grenier, les couches de poussière que l’on écarte doucement, soigneusement, religieusement des boîtes en carton d’antan, d’un revers de la main ému. Jouer, c’est toujours toucher, palper, sentir.
On se rappelle soudain que Shigeru Miyamoto, le si célèbre créateur de Mario et Zelda, n’est pas un programmeur de métier, mais un designer industriel. Au début des années 1970, lors de ses études à Kanazawa, alors que l’exercice consistait à concevoir une chaise, il avait obtenu la meilleure note de sa promotion en imaginant un siège entièrement fabriqué avec une corde et ses nœuds. Un demi-siècle plus tard, les fils de Pong courent après la 4K, le cloud gaming et la réalité augmentée, alors que l’innovation réside parfois là, dans une simple nouvelle idée pour les sens, pour les doigts. Pas une révolution de velours, mais de texture : aux surfaces lisses et sans défauts des bitoniaux en plastique d’autrefois, le susurrement froissé d’un carton à plier. Bref, une révolution digitale.







