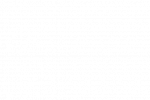« Le commerce des esclaves était alimenté par les conflits entre les royaumes du Dahomey »
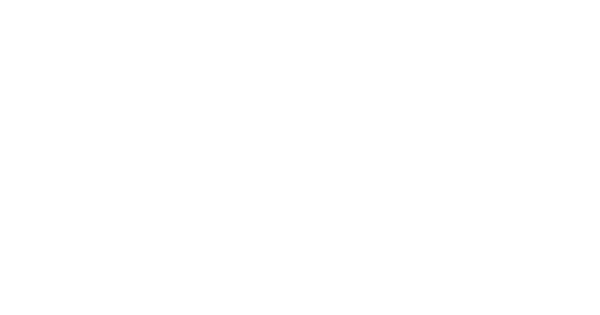
« Le commerce des esclaves était alimenté par les conflits entre les royaumes du Dahomey »
Par Pierre Lepidi (envoyé spécial au Bénin)
Une semaine à pied sur les traces des esclaves du Dahomey (5/9). Dernière étape avant le port de Ouidah, la ville qui a marqué la traite négrière.
A cause d’un coq insomniaque qui a commencé à chanter vers 3 heures, j’ai peu dormi. Le jour n’est pas encore levé lorsque mon guide Hubert et moi lançons nos premières foulées dans la nuit encore fraîche. Après une dizaine de kilomètres, nous traversons la nationale goudronnée pour récupérer un chemin de terre plus agréable.
La marche a le don de réveiller des souvenirs enfouis. Au moment de retrouver la piste en latérite, je repense à cet ami mauritanien venu me rendre visite à Paris il y a une quinzaine d’années. Un jour où l’on se baladait dans un jardin public, Mustapha m’avait demandé s’il pouvait marcher sur un coin du parc non entretenu. « En Europe, vous avez tout goudronné, même les jardins, m’avait-il expliqué. J’ai besoin d’éprouver le contact du sable, des herbes… J’aime sentir le revêtement naturel de la terre sous mes pieds. »
Nous traversons plusieurs villages, où l’on me salue souvent par un bienveillant « Kuwabo yovo ! » (« bonne arrivée le Blanc ! »). Je suis surpris de voir que certaines localités sont parfaitement entretenues avec des rues balayées quotidiennement, et qu’à quelques mètres, d’autres sont jonchées de détritus et de sacs en plastique.
« C’est peut-être lié à l’influence du CV [chef de village] et au message qu’il diffuse dans sa communauté, m’explique le guide. Mais je pense que c’est surtout par effet de mimétisme : si un habitant nettoie l’extérieur de sa maison, son voisin va faire pareil pour ne pas avoir honte et ainsi de suite jusqu’à ce que le village soit entièrement propre. Mais si personne ne montre l’exemple… »
Machettes et parapluie
Denis Hounnon est forgeron et travaille au bord de la piste sablonneuse qui mène à la ville de Kpomassè. D’un geste régulier du bras, il actionne une roue de vélo qui alimente un foyer dans lequel il façonne des outils destinés au travail de la terre. Ce matin, il affine les bords tranchants d’une bêche. « J’aime mon métier. Je viens d’une longue lignée de forgerons », dit-il en me serrant la main. Ses ancêtres travaillaient-ils déjà sur le bord de cette route ? Il l’ignore. J’ai lu que ceux qui assemblaient des pièces de métal étaient très recherchés par les royaumes dahoméens, notamment pour forger les maillons des chaînes des centaines de milliers d’esclaves.
Vers 10 h 30, nous arrivons devant une immense enceinte. Des machettes, deux trônes et un parapluie décorent le portail au-dessus duquel on peut lire : « Conseil suprême des souverains du Bénin ». Deux statues de léopards prêtes à bondir ornent aussi l’entrée.
« Qui cherchez-vous ? demande une femme en sortant de l’épicerie qui jouxte le palais.
– Le roi ! lui dis-je. Est-il possible d’avoir une audience avec lui ?
– Non, malheureusement. Il ne rentrera qu’après-demain. Mais je suis la reine et je peux répondre à vos questions. En revanche, je ne peux pas vous faire entrer dans le palais en l’absence du souverain et il est interdit de me prendre en photo. »
La reine Gbekonton (littéralement « qui a quitté Abomey ») a épousé le roi de Kpomassè en 2013. A 27 ans, elle est l’une des quatre épouses de ce chef de culte vaudou, guérisseur traditionnel.
« Il m’a donné un fils, le prince Don Rodrigue, dit-elle en désignant le poupon de 4 mois qu’elle serre dans ses bras.
– Don Rodrigue a-t-il des chances de monter un jour sur le trône et de devenir roi de Kpomassè ?
– Je le souhaite, mais seul le roi pourrait répondre à cette question. »
L’entrée du palais du roi de Kpomassè, chef de culte vaudou et guérisseur traditionnel. / Pierre Lepidi
Nous reprenons la route. Le soleil écrase nos ombres. « On voit souvent des serpents se reposer ici », dit Hubert en me montrant des traces d’ondulations dans le sable. Au détour d’un virage, une rafale apporte un air chargé d’iode. Elle annonce la fin du voyage. Cudjo Lewis, Mahommah Gardo Baquaqua et tous les esclaves qui ont suivi cette route ont-ils senti cette même bourrasque en passant près des champs de manioc et d’igname qui bordent aujourd’hui la voie ? Venant majoritairement du nord, la plupart ne connaissaient pas l’Océan et ignoraient tout de lui jusqu’à son goût de sel. A vol d’oiseau, une dizaine de kilomètres nous séparent maintenant de l’Atlantique.
« Lavés dans une rivière »
Nous retrouvons la route goudronnée qui mène vers Ouidah. Elle passe par la ville de Savi que nous atteignons en début d’après-midi après un virage en montée. Savi fut une étape majeure de la traite négrière. On raconte que c’est ici que le commerce avec des navigateurs portugais a débuté sous le règne de Kpassè, huitième souverain du royaume de Xwéda, fondé vers 1500. Plus tard ont suivi des commerçants anglais, hollandais et français, qui disposaient tous d’un fort pour leur commerce et leurs échanges à proximité du palais royal. « Les esclaves étaient lavés dans une rivière à l’entrée de la ville afin qu’ils puissent être vendus au meilleur prix, raconte Hubert. Le commerce était alimenté en permanence par les conflits entre les différents royaumes du Dahomey. »
Grâce à un système douanier efficace à l’entrée de la ville, Savi a prospéré. Et, par extension, Ouidah en a tiré profit. En 1727, le roi Agadja, d’Abomey, a conquis la cité en tuant Houffon, le dernier roi de Savi, lors d’un bain de sang qui aurait fait 5 000 morts et 11 000 prisonniers. Le royaume d’Abomey, d’où nous sommes partis il y a maintenant quatre jours, n’avait alors plus d’obstacle, plus d’entrave pour s’étendre jusqu’à la mer. C’est ainsi qu’il est devenu le plus fort, le plus puissant et le plus respecté de tous.
Hubert me demande de l’accompagner faire une offrande – de l’akassa au poulet – à la divinité To-Legba, dont le temple est situé un peu avant le restaurant Les Trois Singes, où nous avons déjeuné. « On peut nourrir ce dieu avec du bœuf ou du mouton, mais il ne faut jamais lui donner de l’alcool, prévient le guide. C’est un esprit puissant qui peut devenir très nerveux. »
A la nuit tombante, le ciel devient menaçant. Est-ce lié à cette route des esclaves qui nous imprègne jusqu’à nous obséder depuis tant de jours, à l’orage qui gronde ou à la fin du voyage ? Je sens monter comme une angoisse. Pour être déjà allé à Ouidah, que nous atteindrons demain matin et qui marquera la fin de cette marche de 125 km à travers le Bénin, je sais que même si la ville est agréable, la piste qui mène à la fameuse porte du Non-Retour est chargée d’une atmosphère lourde et oppressante. Je me souviens y avoir ressenti une gêne et même des maux de tête il y a quelques années.
Nous restons à l’auberge où nous avalons un sandwich fourré aux sardines en buvant une bière tiède. Un écran géant diffuse des clips nigérians où des filles callipyges se trémoussent autour d’un chanteur qui jette de l’argent dans un jacuzzi. La sono est forte, trop forte. Ce soir, le cœur n’y est pas.
Sommaire de notre série Une semaine à pied sur les traces des esclaves du Dahomey
D’Abomey à Ouidah, notre reporter a emprunté la route suivie en 1860 par Cudjo Lewis, le dernier esclave de la traite négrière vers les Etats-Unis.