A Ouidah, « personne ne peut être considéré responsable de ce que ses ancêtres ont commis »
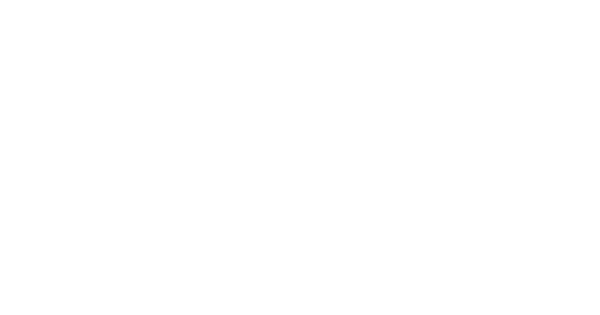
A Ouidah, « personne ne peut être considéré responsable de ce que ses ancêtres ont commis »
Par Pierre Lepidi (envoyé spécial au Bénin)
Une semaine à pied sur les traces des esclaves du Dahomey (6/9). Plongée dans l’histoire de la ville côtière béninoise, intimement liée à celle de la traite transatlantique.
D’un coup de couteau, Hubert fend le pain et le remplit de sardines, puis nous taillons la route à la lueur d’une lampe frontale. Comme chaque jour depuis que nous marchons mon guide et moi sur les traces des anciens esclaves au Bénin, il n’est pas encore 6 heures du matin lorsque nous lançons nos premières foulées.
Ouidah, que l’on écrit Wida, Whydah, Juda voire Fida selon les époques et les récits, n’est distante de Savi, où nous avons passé la nuit, que de 8 km. Nous traversons le grand carrefour de la route qui mène à Cotonou et rejoignons vite le centre-ville de la cité portuaire.
Une communauté afro-brésilienne
On est dimanche, Ouidah s’éveille. Je connais cette ville pour y avoir célébré avec Erick, un ami béninois, le réveillon de la Saint-Sylvestre en 2011. Il flotte dans ses rues un parfum particulier, ce même mélange de douceur et de fragilité que l’on retrouve à La Havane, la capitale cubaine, ou à Salvador de Bahia, au Brésil.
A l’instar de ces cités cosmopolites, Ouidah porte de multiples influences architecturales, notamment brésiliennes dès le XVIIe siècle, inscrites en ses murs par les négriers portugais ou les esclaves affranchis revenus d’au-delà des mers au Dahomey. Parfois pour se lancer dans le commerce… d’esclaves.
Mais il y eut aussi des survivants de la révolte des Malês, menée en janvier 1835, principalement par des musulmans africains et des Yoruba, contre le pouvoir esclavagiste de l’Etat de Bahia. Après l’échec de cette insurrection qui a marqué l’histoire du Brésil, les insurgés furent exécutés, condamnés à des peines de prison et de travaux forcés ou renvoyés vers le Nigeria et le Bénin.
Dans son livre A Brief History of Brazil, l’auteure Teresa Meade explique que 44 % des Brésiliens considèrent « tenir leur patrimoine de l’Afrique ». Inversement, au Bénin, tous ceux qui ont pour patronyme da Silva, d’Almeida, de Souza ou Moreira, entre autres, sont issus de la communauté afro-brésilienne.
A la buvette Chez Colo n°1 de Ouidah, une cuisinière presse du piment qui sera utilisé pour différents mets. / Pierre Lepidi
Après avoir longé le marché Kpassè, le complexe scolaire Fonsarame (littéralement « ceux du quartier Fon » et donc, par extension, ceux qui arrivent d’Abomey, comme Hubert et moi), nous tournons devant le marché Zobè, encore inanimé. A la buvette Chez Colo n°1, une cuisinière presse des piments pour en extraire une pâte rouge. Devant une assiette d’agou (de l’igname pilée accompagné d’une sauce au sésame) et un verre de jus d’ananas gorgé de sucre, Hubert et moi reprenons notre souffle.
Il reste moins de 4 km avant d’atteindre la plage sur laquelle se dresse la célèbre porte du Non-Retour, érigée à l’initiative de l’Unesco et inaugurée en 1995. J’ai la terrible intuition que ces derniers pas seront les plus éprouvants de ce périple commencé il y a cinq jours, 120 km plus au nord. Et cette boule qui me noue le ventre depuis hier soir ne cesse de me le rappeler.
Un million d’hommes, de femmes et d’enfants
Nicéphore Soglo, président du Bénin de 1991 à 1996, est à l’initiative du festival Ouidah 92, organisé en 1993, qui fut le premier rassemblement mondial des arts et de la culture vaudous. Le successeur de Mathieu Kérékou a fait de cette manifestation destinée à favoriser la rencontre entre chefs religieux, artistes et intellectuels de l’Afrique et des Amériques « une commémoration du souvenir, une appropriation de cette page tragique de notre destinée collective que fut la traite négrière ».
A l’occasion du Ouidah 92, le Bénin a voté une loi instituant le 10 janvier journée officielle de fête dédiée au culte vaudou. Le long de la route de sable qui mène à la porte du Non-Retour, six étapes considérées comme emblématiques de l’histoire de la traite ont été identifiées. Six étapes comme six stations sur le chemin infernal précédant l’effroyable traversée de l’Atlantique. Le parcours est aussi parsemé de statues représentant les emblèmes des rois d’Abomey.
La piste qui mène du centre-ville de Ouidah jusqu’à la plage est parsemée de statues représentant les emblèmes des rois d’Abomey. / Pierre Lepidi
Afin de respecter la territorialité des guides, c’est Nadal qui va m’accompagner. Hubert, qui va nous suivre, lui a donné rendez-vous sur la place Chacha, du surnom de Francisco Felix de Souza, le plus connu des négriers, auquel l’écrivain britannique Bruce Chatwin avait consacré en 1980 son roman Le Vice-Roi de Ouidah. Marchand d’esclaves comme son père, ce natif de Salvador de Bahia se serait installé au Dahomey en 1788. Devenu conseiller personnel du roi Guézo, il se comportera jusqu’à sa mort, en 1849, comme le véritable maître de la cité, où un quartier perpétue encore aujourd’hui son souvenir. Sur la célèbre place, l’immeuble de la puissante famille de Souza est immanquable. Une partie de ses nombreux descendants y vit encore, sous la direction d’un chef de famille très respecté.
« N’y a-t-il pas des tensions entre la population et cette famille qui a participé à la traite négrière ?
– Non, répond Nadal. Personne ne peut être considéré responsable de ce que ses ancêtres ont commis. »
Un homme valait une centaine de dollars
Ici, un million d’hommes, de femmes et d’enfants ont été vendus aux enchères. D’autres étaient échangés contre du tabac, des armes ou des tissus. Mahommah Gardo Baquaqua, dont le témoignage a été publié en 1854 sous le titre An Interesting Narrative, a été déporté en 1845 vers le port de Pernambouc, plus d’une décennie après la loi qui interdisait l’introduction d’esclaves africains sur le territoire brésilien. Et, en 1860, Cudjo Lewis, dont une statue a été récemment érigée dans la ville de Mobile, en Alabama, a également quitté les côtes africaines en toute illégalité puisque la traite avait été interdite aux Etats-Unis dès le 1er janvier 1808 par le président Thomas Jefferson.
La place où les esclaves étaient vendus à Ouidah est appelée place Chacha, du surnom d’un des plus célèbres négriers. / Pierre Lepidi
Même si elle a été ralentie par différents décrets et lois tentant d’y mettre un terme, la traite transatlantique, reconnue en France comme crime contre l’humanité en 2001, s’est poursuivie quasiment jusqu’à la fin du XIXe siècle. Afin de maintenir sa puissance, le royaume du Dahomey s’est tourné vers l’exportation d’huile de palme, sans pour autant renoncer au lucratif commerce d’esclaves et, malgré l’Aberdeen Act, une loi britannique appliquée unilatéralement, en 1845, qui permettait aux bateaux de la Royal Navy d’arraisonner tout navire négrier. Dans Ouidah, The Social History of a West African Slaving Port (1727-1892), l’auteur Robin Law estime ainsi que, vers 1860, le prix d’un esclave était à son niveau le plus élevé. Un homme valait alors une centaine de dollars.
Sous un ciel sombre, je devine au bout de la ligne droite qui se dessine devant moi la présence de l’Océan. Je ressens à cet instant son immensité comme une oppression, une menace.
Sommaire de notre série Une semaine à pied sur les traces des esclaves du Dahomey
D’Abomey à Ouidah, notre reporter a emprunté la route suivie en 1860 par Cudjo Lewis, le dernier esclave de la traite négrière vers les Etats-Unis.










