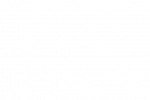L’Université de Juba, une école de la survie au Soudan du Sud

L’Université de Juba, une école de la survie au Soudan du Sud
Par Florence Miettaux (contributrice Le Monde Afrique, Juba)
La classe africaine (10). Dans une capitale où guerre civile se conjugue avec crise économique, les étudiants luttent même pour un verre d’eau.
L’Université de Juba est une institution marquée par l’histoire du Soudan du Sud. Fruit de la lutte pour l’autonomie des Sud-Soudanais, elle est inaugurée dans la joie en 1977, puis exilée à Khartoum en 1989 à cause de la guerre, et à nouveau rapatriée à Juba en 2011, à l’indépendance du pays. Depuis, les problèmes s’enchaînent : au sous-financement chronique se rajoutent les effets, notamment économiques, de la guerre civile qui a éclaté en décembre 2013. En 2017, avec près de 9 000 étudiants, dont 1 949 femmes, l’université était à bout de souffle. « Le futur de l’Université de Juba et des autres universités publiques du Soudan du Sud est sombre : beaucoup vont bientôt fermer », déclarait avec fracas le vice-chancelier de l’institution, John Akec, en mai 2017.
« Nous étions à cours d’argent », se rappelle-t-il, assis dans son vaste bureau du campus historique de l’université. C’est l’intervention du ministère de l’éducation supérieure, en retard de plusieurs mois sur le paiement des salaires des employés de l’université, qui a permis de débloquer la situation, ainsi que la donation d’un homme d’affaires d’un montant de 9 millions de livres sud-soudanaises (56 000 euros). L’année universitaire 2017 s’est achevée tant bien que mal, sans fermeture, et maintenant que les inscriptions sont sur le point de commencer pour l’année 2018, John Akec est plutôt optimiste. « Ce n’est pas un environnement facile, mais nous continuons à avancer, nous essayons d’innover, explique-t-il. Nous voulons être une université digne de ce nom, en dépit des problèmes. »
« Notre pouvoir d’achat a chuté »
Les chiffres n’invitent pourtant pas à l’optimisme. Le ministère de l’éducation supérieure, qui perçoit seulement 1 % du budget national, ne paie que les salaires des personnels et pratiquement aucun frais de fonctionnement, qui restent donc à la charge de l’université. En 2014, selon M. Akec, il fallait 120 000 livres (740 euros) par semaine pour acheter le carburant des groupes électrogènes ou encore les fournitures de bureau. Aujourd’hui, ces dépenses hebdomadaires incompressibles s’élèvent à 1,2 million. « C’est fou ! » s’exclame le vice-chancelier.
Depuis la dévaluation de décembre 2015, la valeur de la monnaie sud-soudanaise a été divisée par plus de 30 par rapport au dollar. Face à la flambée des prix – le taux d’inflation était de 334 % sur deux ans en mai 2017 –, les frais d’inscription payés par les étudiants restent la principale source de revenus propres de l’université. Mais impossible de les augmenter : le président Salva Kiir, qui est aussi chancelier de l’Université de Juba, s’y est opposé. « Notre pouvoir d’achat issu des frais d’inscription a terriblement chuté », explique John Akec, chiffres à l’appui. Les frais varient d’une faculté à l’autre, la plus chère étant la faculté de médecine (4 000 livres) et la moins chère, la faculté de lettres (1 800 livres). Or, quand un étudiant payait 3 000 livres en 2015, cela équivalait à 500 dollars qui rentraient dans les caisses de l’université. En 2018, cette somme ne représente plus que 15 dollars.
A discuter avec des étudiants, on comprend vite les effets du manque d’argent sur la vie quotidienne du campus et des foyers universitaires. « L’eau potable est le problème numéro un des étudiants de l’Université de Juba », estime Odong Thomas Daniel, le porte-parole du syndicat étudiant Juba University Student Union (JUSU). Son président, Kocdit Ngor Achiek, renchérit : « Si tu n’as pas 20 livres pour t’acheter un verre d’eau quand tu as soif, tu ne bois pas de la journée. »
Selon eux, l’Université de Juba manque de tout : pas de connexion Internet sur le campus, les livres en accès à la bibliothèque datent, pour les plus récents, du début des années 2000 et « ne sont pas pertinents dans le monde d’aujourd’hui », déplore M. Odong. Les laboratoires « n’ont que les produits chimiques de base, ce qui ne permet pas d’acquérir une expérience suffisante ». Les salles de classe et les amphis sont surpeuplés, tout comme les foyers, qui ne logent qu’une infime partie des étudiants (entre 600 et 1 500 places disponibles selon les sources). Les maîtres de conférence et professeurs font aussi défaut : face à l’immense perte de valeur de leur salaire (de 3 000 dollars par mois en 2015 à moins de 100 dollars aujourd’hui, en moyenne), certains prennent des congés sans solde, ou cherchent du travail ailleurs.
« Tout faire pour rester ouverts »
L’université fournit un repas par jour aux étudiants et, pour le reste, « on invente des mécanismes de survie, on partage les photocopies, on s’entraide », raconte Moga Umar Williams, un étudiant en quatrième année de science environnementale à la John Garang Memorial University de Bor (à 200 km au nord de la capitale). Il suit des cours à l’Université de Juba en remplacement de ceux qui ne sont plus dispensés dans sa ville, faute de moyens et de professeurs.
« Les familles aisées envoient leurs enfants faire des études à l’étranger », note Moga Umar Williams, qui finance les siennes grâce à un emploi d’enseignant dans une école primaire. Sur le point de décrocher brillamment sa licence, celui qui a fait toute sa scolarité au camp de réfugiés d’Adjumani, en Ouganda, a réalisé son rêve : « Retourner étudier les sciences environnementales dans mon pays. » Il songe même à enseigner à l’université à l’avenir, pour promouvoir les sujets qui lui tiennent à cœur, comme son sujet de mémoire, « l’éradication de la pauvreté à travers l’agriculture soutenable. » Pour lui, « dans toute nation, la jeunesse est la source du changement », et « l’état d’esprit des étudiants permet un vivre-ensemble », contrairement aux « illettrés qui croient encore au tribalisme ».
La classe africaine : état de l'éducation en Afrique
Durée : 01:52
« Nous faisons tout pour garder l’université ouverte », assure John Akec. Pour les Sud-Soudanais qui vont commencer leur année universitaire en février, l’Université de Juba, malgré tous ses problèmes, reste une chance d’accéder au marché de l’emploi dans la fonction publique – l’Etat est le premier employeur des diplômés des cinq universités publiques du pays –, dans le secteur privé ou encore dans les ONG.
Cet article a été réalisé dans le cadre du projet Juba In The Making avec le soutien du Centre européen du journalisme.
Sommaire de notre série La classe africaine
De l’Ethiopie au Sénégal, douze pays ont été parcourus pour raconter les progrès et les besoins de l’éducation sur le continent.