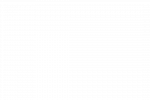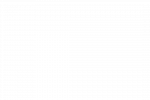#metoo face aux accusations de censure artistique

#metoo face aux accusations de censure artistique
Par Faustine Vincent
Le mouvement a investi le champ culturel, réveillant le débat sur la distinction entre l’homme et l’œuvre, comme le prouve la polémique autour de Woody Allen.
Des féministes manifestent devant la Cinémathèque française à Paris le 30 octobre 2017 pour réclamer l’annulation de la rétrospective de Roman Polanski, accusé de viol. / MICHEL EULER/AP
La vague #metoo pourrait emporter Woody Allen à son tour. Accusé d’agression sexuelle par sa fille, le réalisateur américain est lâché par ses actrices alors que son dernier film, Wonder Wheel, sort sur les écrans. La sortie de son prochain long-métrage, A Rainy Day, est également menacée d’annulation par son producteur, Amazon.
C’est la dernière répercussion en date de l’affaire Weinstein – le producteur américain accusé de viols et agressions sexuelles – sur la production culturelle. La première remonte à la mi-décembre : accusé de harcèlement sexuel, l’acteur Kevin Spacey est effacé en catastrophe du dernier film de Ridley Scott, Tout l’argent du monde, et remplacé au pied levé.
L’humoriste Louis C. K. et l’acteur Ed Westwick, accusés peu après, connaissent le même sort. Suit l’appel, aux Etats-Unis, à retirer un tableau de Balthus, perçu comme un éloge de la pédophilie, et celui, en France, à annuler la rétrospective de Roman Polanski à la Cinémathèque française.
« Vague purificatoire », « censure », « révisionnisme », protestent les signataires de la « tribune des cent femmes », dont Catherine Deneuve. Le débat est lancé. En quelques semaines, le mouvement #metoo, dénonçant les violences sexuelles et le sexisme, a investi le champ artistique.
« La raison est simple », explique Thomas Schlesser, historien de l’art et auteur de L’Art face à la censure :
« Le domaine de l’art est désormais perçu, à tort ou à raison, comme révélateur du degré de liberté d’une société et d’une époque. Dès lors qu’on sent l’art atteint et contraint, des inquiétudes s’expriment. »
Distinction de l’homme et de l’œuvre : deux camps s’affrontent
L’éviction des acteurs incriminés et la polémique autour de Woody Allen relancent un débat classique : la distinction entre l’homme et l’œuvre. Deux camps s’affrontent : d’un côté ceux qui considèrent qu’ils sont indissociables, de l’autre ceux qui déplorent la « confusion » entre les deux, comme l’écrivent les signataires de la « tribune des cent femmes ».
Cette différence de vues recoupe celle, culturelle, qui sépare les Etats-Unis de la France, attachée à cette distinction. « De même qu’une chose représentée n’est pas la chose elle-même, une œuvre d’art n’est pas son auteur, à moins qu’on ne souhaite collectivement en faire notre critère d’appréciation moderne », affirme ainsi Thomas Schlesser, également directeur de la Fondation Hartung Bergman, à Antibes.
Il met en garde contre le jugement d’une œuvre au prisme de la personnalité de son auteur, qui impliquerait que « nos musées soient modifiés de fond en comble » :
« Pour information, Caravage était un criminel, et Degas un misanthrope exécrable. Dans cette perspective, quelle “police” décrétera qui a droit d’être exposé au Louvre ou non ? »
De l’autre côté de l’Atlantique, au contraire, la distinction entre l’homme et l’œuvre ne va pas de soi. « Cela ne veut pas dire pour autant que la France ne subit pas l’importation de normes américaines », observe Nathalie Heinich, sociologue de l’art au CNRS. Même dans l’Hexagone, cette distinction tend à s’amenuiser.
Un phénomène dû « à la montée en puissance de la culture médiatique », avance Matthieu Letourneux, professeur de littérature et auteur de Fictions à la chaîne : littératures sérielles et culture médiatique (Seuil, 2017). « Engager un acteur, c’est engager un personnage public, une célébrité dont la vie privée est connue. L’image de l’acteur affecte donc l’œuvre ». Tout comme celle de Woody Allen affecte aujourd’hui ses films, comme le prouve la polémique.
Selon le professeur, les débats actuels témoignent d’une « rupture majeure en termes culturels » : la mise en cause de cette séparation entre homme et œuvre, mais aussi la transformation de la définition même d’une œuvre d’art et de son périmètre. « Depuis trente ans, on a vu un énorme élargissement de la notion d’œuvre d’art, qui a été étendue aux industries culturelles – séries télévisées, dessins animés, bande dessinée… Puisque tout devient art, la sacralité de l’œuvre est mise en cause, donc tout est plus facilement contestable », explique-t-il.
L’effacement des acteurs « renvoie à une culture stalinienne »
Le mouvement #metoo se traduit-il par un retour de la censure ? « Le terme est inapproprié », selon Nathalie Heinich. Dans le cas des acteurs « effacés », par exemple, la décision émanait des réalisateurs, et non d’une instance supérieure faisant autorité ou d’un Etat, ce qui justifierait qu’on évoque une censure. Il s’agit donc, éventuellement, d’autocensure.
Or, comme l’explique la chercheuse, les artistes s’y soumettent « en permanence, quel que soit le contexte, car ils savent qu’il y a des lois et qu’ils ne peuvent pas inciter à la haine raciale, la pédophilie ou encore l’antisémitisme ». La polémique ravive l’éternelle question de la liberté créatrice : un artiste peut-il tout dire, tout écrire ? En cas de doute, ce sont les juges qui tranchent.
Si l’effacement des acteurs dérange, c’est avant tout parce qu’il « renvoie à une culture stalinienne », affirme Nathalie Heinich. Les images truquées à l’époque de l’ancien dictateur soviétique, qui avait notamment fait effacer Trotski des photos officielles, sont restées en mémoire. « Il est troublant de voir que dans un pays prônant la liberté, on recourt à des manipulations expérimentées dans un régime totalitaire », poursuit-elle.
Mais cette appréciation divise. « Cela n’a rien à voir, objecte André Gunthert, maître de conférences en histoire visuelle à l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales). Dans un cas, il s’agit d’altérer l’histoire à des fins de propagande, et dans l’autre, de la modification d’une production culturelle. »
Modifications fréquentes
Ce type de modifications est « très fréquent dans l’industrie culturelle, y compris pour des œuvres d’art, selon le chercheur. Mais d’habitude, cela passe inaperçu ». Des acteurs de série sont régulièrement remplacés par d’autres pour incarner un même personnage.
D’autres changements sont effectués en fonction du contexte dans lequel l’œuvre est montrée. Les exemples sont légion. Les Schtroumpfs noirs, publiés par Peyo en 1963 et décrivant des personnages violents et agressifs, sont ainsi devenus violets lors de la parution aux Etats-Unis, afin de ne pas donner lieu à des interprétations racistes. A la Renaissance, quelques siècles plus tôt, les feuilles de vignes rajoutées aux statues grecques antiques illustraient, elles aussi, ce phénomène d’adaptation culturelle.
Ce qui semble anodin dans certains contextes paraît insupportable dans d’autres. « L’histoire montre que nos valeurs évoluent énormément, dans un sens comme dans l’autre, alors qu’elles sont toujours perçues à l’instant T comme absolues, ou du moins difficiles à transgresser », analyse Nathalie Heinich, qui a étudié cette question dans son essai Des valeurs. Une approche sociologique (Gallimard).
C’est aussi ce qui s’exprime aujourd’hui lorsque des collectifs féministes réclament le retrait de certains tableaux, ou l’éviction d’acteurs accusés de violences sexuelles. Dans le cas de Kevin Spacey, « entre le début du tournage et la fin, le contexte a changé car la perception des violences faites aux femmes a évolué », analyse André Gunthert. D’où le choix de Ridley Scott, davantage guidé, selon lui, par un « calcul commercial » – afin d’éviter tout boycott – que par un « jugement moral ».
Le débat engagé à la faveur du mouvement #metoo revêt en tout cas un « avantage majeur », estime Thomas Schlesser, celui de « restituer aux œuvres contestées leur pouvoir dérangeant, alors que l’indifférence à leur égard est très majoritairement la norme ». Une performance en soi.