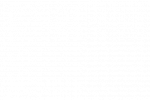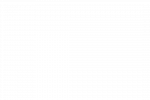A l’université d’Oxford, « le Brexit est une épée suspendue au-dessus de nous »

A l’université d’Oxford, « le Brexit est une épée suspendue au-dessus de nous »
Dans sa chronique d’une année d’études en Grande-Bretagne, Noé Michalon raconte un débat sur le Brexit et comment la décision de quitter l’UE pèse sur le futur de l’université.
Le campus d’Oxford, « une sphère progressiste », pour Noé Michalon / CC BY-SA 2.0 Mario Sánchez Prada
Chronique d’Oxford. Diplômé de Sciences Po, Noé Michalon tient une chronique pour Le Monde Campus, afin de raconter son année à l’université d’Oxford, où il suit un master en études africaines.
« A chaque fois que je parle politique avec mes amis anglais, c’est inévitable : on finit par parler du Brexit, et uniquement du Brexit. » Comme l’explique mon ami italien Pier à la sortie d’un pub, le divorce entre Londres et Bruxelles n’a pas quitté le centre des débats, presque deux ans plus tard. Il est même devenu indécent, pour un leader politique, de ne plus aborder le sujet. Le chef de l’opposition travailliste, Jeremy Corbyn, doit régulièrement faire face à une avalanche de critiques pour son silence sur le Brexit. Qu’il s’agisse de plaider pour un soft ou un hard Brexit, ou même d’implorer un retour dans l’Union européenne, on jauge tout politicien sur son avis à ce sujet.
« Le Brexit est en train de devenir une crise d’adolescence. Les pro-Brexit crient en accusant tout le monde et font claquer les portes parce que ce qu’ils veulent est impossible. Theresa May agit en mère trop indulgente incapable de dire non. Et Jeremy Corbyn endosse le rôle du père qui s’enfuit au pub pour éviter le conflit », résumait récemment un Britannique mécontent sur Twitter.
Confronter des idées reçues aux chiffres
Chaque jour, au rayon presse du supermarché de mon quartier, il n’est pas un quotidien qui ne barre sa une du mot « Brexit ». Le néologisme est encore dans toutes les bouches britanniques, comme s’il s’était substitué à la politique anglaise de manière générale. L’événement semble de ces séismes qui marquent à vie : tous se souviennent avec exactitude de ce qu’ils ont fait le jour du vote. Encore sonnés, ils cherchent à savoir ce qu’il s’est vraiment passé.
Par un venteux mardi de février, mon collège a donc organisé une conférence pour essayer d’y voir plus clair, avec cet intitulé tranchant : « Qui a voté pour le Brexit ? » Dans le tintement vespéral des tasses de thé, deux universitaires anglais ont tenté de dissiper un peu le brouillard d’un pays qui n’en manque pas. L’occasion de confronter quelques idées reçues aux chiffres.
L’explication purement xénophobe trouve bien vite ses limites. « Les régions qui ont le plus voté pour le Brexit sont celles qui comptent le moins d’immigrés », explique tout de go Danny Dorling, affable géographe réputé pour ses travaux sur la division nord-sud du Royaume Uni. L’explication purement économique a aussi ses limites : « Les trois premiers déciles les plus pauvres de la population ont davantage soutenu le remain [le vote pour rester dans l’UE] que les quatre suivants », poursuit ce chercheur à Oxford.
« C’est surtout l’impression d’être pauvre plutôt que la pauvreté elle-même qui semble avoir été déterminante », complète Andrew Oswald, le deuxième intervenant, études à l’appui. Et ce professeur d’économie de l’université de Warwick de s’attaquer à une troisième idée reçue, celle qui voudrait que les plus âgés aient été déterminants dans le référendum en votant davantage, et en grande majorité pour le Brexit : « Certes, les très jeunes, de 18 à 25 ans, ont largement voté en faveur du maintien dans l’Union européenne. Mais il n’y a pas d’énormes différences entre les autres classes d’âge. C’est surtout entre les diplômés et les non-diplômés que l’écart est important », explique-t-il devant une nouvelle batterie de graphiques colorés.
Oxford, une sphère progressiste
La conférence, parsemée de cet humour anglais qui vous fait rire en l’absence de blague et vous laisse de marbre au moment où la salle entière s’esclaffe, est finalement l’occasion de mettre le doigt sur un autre phénomène : l’isolement des universitaires, qui furent nombreux à être sidérés par un résultat électoral qu’ils n’avaient pas vu arriver.
Je l’ai assez dit ces derniers mois, Oxford est une bulle, mais je n’ai peut-être pas assez précisé à quel point c’est une sphère progressiste. C’est non seulement le point de chute d’étudiants de la si fameuse génération Erasmus, avec presque 3 000 d’entre eux (dont 300 Français) issus de pays de l’Union européenne, sur les 23 000 que compte l’université. Mais c’est aussi sans compter les 18 % du personnel qui viennent de ces pays et les 74 millions de livres sterling (environ 84 millions d’euros) perçus de l’UE pour l’année 2015-2016 (soit 14 % du budget recherche).
C’est aussi, d’un point de vue électoral, un bastion rouge-orange. Les derniers maires de la ville étaient successivement travaillistes ou libéraux-démocrate, le parti britannique le plus européiste, et les deux députées du coin appartiennent à ces mêmes formations politiques. Lors du référendum de 2016, la région d’Oxford a voté à 70 % pour rester au sein de l’Union : un îlot pro-remain au milieu d’un océan de leave. Après cinq mois à Oxford, j’attends toujours de rencontrer mon premier partisan du Brexit…
La tentative d’ouverture compromise
Comme souvent depuis l’annonce de son tonitruant départ, le pays tente de se rassurer en se disant plus libre et plus central dans le monde. Le professeur Alastair Buchan, nommé par Oxford chef de la stratégie pour le Brexit, estimait en janvier 2017 que la baisse du cours de la livre attirerait davantage d’étudiants du monde entier au Royaume Uni, notamment en provenance du Canada et des Etats-Unis, des pays qui auraient été négligés ces dernières années selon lui. Quant aux élèves européens, la fin éventuelle des tarifs préférentiels dont ils bénéficiaient pour leurs frais de scolarité signifierait davantage de revenus pour les universités. Après le référendum, ils étaient même 11 % plus nombreux à candidater en 2016 pour rejoindre la « ville aux clochers rêveurs » (ça sonne mieux en VO : « the city of dreaming spires »).
Mais certains symptômes plus inquiétants tempèrent cet optimisme un peu forcé. D’abord parce que cette tentative d’ouverture sur le reste du monde est compromise par une politique migratoire des plus sévères depuis que les conservateurs sont aux commandes. Depuis 2010, le nombre d’Indiens étudiant sur le sol britannique a été par exemple divisé par deux. Et le corps enseignant n’y fait pas exception : « C’est un très faible échantillon, mais tous les chercheurs européens qui ont collaboré avec moi sur mes derniers livres sont partis depuis le Brexit ! », s’exclame Danny Dorling en fin de conférence. L’université d’Oxford a enregistré 230 départs d’universitaires étrangers en 2017 (contre 171 en 2015), selon un décompte réalisé par des députés libéraux-démocrates en janvier.
« Cela fait plus d’un siècle que le Royaume Uni est en déclin »
« Nous entendons déjà que de nombreuses universités européennes refusent de collaborer avec les universités britanniques à cause de l’incertitude causée par le Brexit », nous expliquait Lord Karan Bilimoria, l’un des mécènes de notre collège, lors d’une précédente conférence où il assimilait le Brexit à « une épée suspendue au-dessus des universités britanniques ».
Malgré cette morosité, les étudiants semblent relativiser. « Quel que soit le gouvernement en place, nos gouvernants savent bien l’importance d’avoir des étudiants étrangers sur notre sol. Notre pays a dû faire face à des événements bien plus chaotiques dans son histoire que le Brexit », tempère Jack, un ami étudiant en histoire, tiré à quatre épingles pour le « formal dinner » approchant. « Cela fait plus d’un siècle que le Royaume Uni est en déclin, et ce n’est pas le Brexit qui va y changer grand-chose. »
« Pour l’instant, cette spirale dans laquelle on ne parle que du Brexit semble bien partie pour durer, renchérit Claire, une camarade écossaise étudiant l’économie. C’est une diversion efficace. »