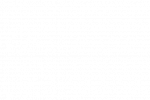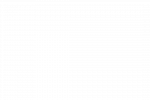Le pouvoir éthiopien à l’heure du choix

Le pouvoir éthiopien à l’heure du choix
Par Emeline Wuilbercq (Addis-Abeba, correspondance)
Après plus de deux ans de contestation populaire et la démission du premier ministre, l’état d’urgence a de nouveau été déclaré, révélant la fébrilité du régime.
Les rebondissements n’ont pas cessé depuis le 12 février, dans le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique : mouvement massif de grèves, manifestations anti-gouvernementales, libération de prisonniers politiques de haut rang et démission du premier ministre. Une série d’événements qui a culminé avec l’instauration de l’état d’urgence, le 16 février, pour une durée de six mois.
C’est la deuxième fois en moins de dix-huit mois que l’Ethiopie impose ce régime d’exception. Le ministre de la défense, Siraj Fegessa, a invoqué le risque de nouveaux « affrontements sur des lignes ethniques » et la nécessité de protéger l’ordre constitutionnel.
Car le regain de tensions et la démission surprise de Hailemariam Desalegn ont plongé le pays dans l’incertitude. Déjà très affaibli par plus de deux ans de manifestations anti-gouvernementales qui ont fait près d’un millier de morts, selon la Commission éthiopienne des droits de l’homme (liée au gouvernement), le régime est embourbé dans une crise politique sans précédent. Décryptage.
Comment est perçu le nouvel état d’urgence ?
La déclaration d’un nouvel état d’urgence a provoqué une levée de boucliers. L’ambassade des Etats-Unis en Ethiopie a affirmé être « en profond désaccord » avec la décision de son allié dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Est. L’Union européenne (UE) a déclaré que l’état d’urgence devait être limité dans le temps et le Royaume-Uni s’est dit « déçu » par cette annonce, ajoutant que cela envoie un signal « décourageant à la communauté internationale et aux investisseurs étrangers ».
L’Ethiopie semblait pourtant prête à s’engager dans un processus de réformes. En témoigne la décision, début janvier, d’amnistier des prisonniers – en niant toutefois qu’il s’agisse de prisonniers « politiques ». En moins de six semaines, plusieurs milliers d’entre eux ont été relâchés, dont des figures de l’opposition comme Merera Gudina, président du Congrès fédéraliste oromo (OFC), et son vice-président, Bekele Gerba, tous deux accueillis en héros à leur sortie de prison par une foule en liesse.
Le retour à cette situation d’exception, qui implique notamment des mesures liberticides et des patrouilles des forces fédérales dans les régions, est perçu par nombre d’observateurs comme un rétropédalage ou une reprise en main du régime. D’autant que le précédent état d’urgence, en vigueur entre octobre 2016 et août 2017, a laissé des séquelles. « Plus de 20 000 personnes ont été arrêtées, ce qui n’a fait qu’aggraver la colère des manifestants et leur a fourni plus de griefs contre le gouvernement », rappelle Felix Horne, chercheur à Human Rights Watch.
Ces griefs étaient déjà nombreux : de l’accaparement des terres par des investisseurs locaux et étrangers, dès 2015, à la répression des manifestations contre le régime. Les protestataires, Oromo et Amhara en tête – près des deux tiers d’une population de 94 millions d’habitants –, reprochaient notamment la surreprésentation de la minorité des Tigréens (6 %) au sein du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (EPRDF), la coalition au pouvoir depuis plus de vingt-sept ans.
A la levée du précédent état d’urgence, la contestation a repris de plus belle. Les manifestations, qui étaient alors interdites sans autorisation, sont redevenues fréquentes et de nombreuses universités se sont transformées en lieux de tensions intercommunautaires. L’Ethiopie a également dû gérer le déplacement d’au moins un million de personnes, selon les Nations unies, en raison de tensions du même ordre à la frontière entre les régions Oromia et Somali, où des affrontements et incursions armées ont fait des centaines de morts.
Pour le chercheur René Lefort, spécialiste de la Corne de l’Afrique, « l’état d’urgence viserait beaucoup plus le danger réel et sous-estimé d’un embrasement ethnique que la répression politique, d’autant qu’au même moment, le pouvoir ne cesse de libérer des prisonniers politiques », notamment le colonel Demeke Zewdu, l’un des leaders de la contestation amhara, relâché lundi 19 février. « Si tel est le cas, le gouvernement a pris la décision que tout gouvernement responsable doit prendre », poursuit-il.
L’état d’urgence doit encore être soumis à un vote de la Chambre des représentants des peuples, la chambre basse du Parlement, dans moins de deux semaines. Des rumeurs circulent sur le fait qu’il pourrait ne pas être approuvé en raison des dissensions internes au sein de la coalition dirigeante et des avis divergents sur ce régime d’exception.
Quel est le rapport de forces au sein du pouvoir ?
Pour certains observateurs, les signes contradictoires d’ouverture et de reprise en main du pouvoir sont la preuve des dissensions qui existent au sein de la coalition au pouvoir, qui détient la totalité des sièges de la Chambre des représentants des peuples depuis 2015. Celle-ci est composée de quatre partis politiques organisés sur une base ethnique : le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), accusé de monopoliser le pouvoir, le Mouvement national démocratique amhara (ANDM), l’Organisation démocratique des peuples oromo (OPDO) et le Mouvement démocratique des peuples du sud de l’Ethiopie (SEPDM, le parti de Hailemariam Desalegn).
Pour le blogueur éthiopien Befeqadu Hailu, la pression du peuple a créé de nombreux groupes à l’intérieur de l’EPRDF. « D’un côté, il y a ceux qui exigent une réforme, car ils considèrent que sans cela, la coalition au pouvoir ne peut survivre. Ceux-là sont les dirigeants de l’OPDO et de l’ANDM. De l’autre, il y a les partisans du statu quo [le TPLF], qui ont l’appareil militaire et sécuritaire derrière eux. » Les premiers ont, d’après lui, le soutien des manifestants. Autrefois considérés par de nombreux observateurs comme les pantins du TPLF, l’OPDO et l’ANDM ont pris leurs distances et sont devenus plus influents au sein de la coalition, rebattant ainsi les cartes. C’est surtout l’influence grandissante de l’OPDO et du président de la région Oromia, Lemma Megersa, qui a concentré les inquiétudes des caciques du pouvoir.
Nommé à la tête du parti fin 2016, Lemma Megersa a réussi à renouer le lien entre l’OPDO et les citoyens en faisant siennes les requêtes populaires. « Pourquoi continuer les manifestations alors que nous avons fait nôtres vos demandes ? Si nous ne parvenons pas à appliquer les mécanismes légaux et institutionnels existants, nous nous joindrons à vous tous pour protester », a-t-il déclaré lors d’un de ses discours. Il a engagé des réformes dans sa région, revoyant notamment les politiques foncières, l’accaparement des terres étant la raison initiale de la colère des manifestants oromo dès 2015. Lemma Megersa a ainsi gagné le cœur des manifestants et des influents militants de la diaspora, dont le moindre post sur les réseaux sociaux est massivement partagé – Jawar Mohammed, suivi par plus d’un million de personnes sur Facebook, en est l’exemple le plus éloquent.
Un remaniement à la tête du TPLF, écartant du pouvoir certains caciques, dont la veuve de l’ancien premier ministre Meles Zenawi, n’a pas suffi à redorer le blason de ce parti. Dans cette guerre interne, certains ont vu l’instauration d’un nouvel état d’urgence comme un test pour l’OPDO et l’ANDM. « S’ils votent en faveur de l’état d’urgence, cela risque de briser le lien avec leur base populaire », souligne un observateur.
Qui sera le prochain premier ministre ?
La principale inconnue, aujourd’hui, est de savoir comment va se dérouler la transition. Qui va succéder à Hailemariam Desalegn ? La démission du premier ministre, le 15 février, était prévisible, mais personne ne s’attendait à cette annonce si rapidement, le congrès de la coalition au pouvoir devant se tenir en mars. M. Hailemariam était le successeur de Meles Zenawi, qui avait pris le pouvoir en 1991 à la tête d’une guérilla qui venait de faire tomber le régime du dictateur Mengistu Haile Mariam. Architecte du développement pour les uns, autocrate pour les autres, cet homme fort et charismatique a laissé son empreinte dans l’histoire de l’Ethiopie.
M. Hailemariam, catapulté premier ministre à la mort de M. Meles en 2012, était vu comme l’homme du compromis – il vient du Wolayta, dans le sud du pays, et non du Tigré, au nord. Peu charismatique, il n’a pas réussi à se créer une base politique forte. Lors d’une réunion à huis clos de son comité exécutif, qui a duré dix-sept jours en décembre 2017, l’EPRDF a vivement critiqué son « leadership ». Il a finalement pris la responsabilité des échecs de sa coalition – notamment l’incapacité à répondre à la crise politique et humanitaire – en démissionnant de ses postes de premier ministre et de président de l’EPRDF.
« C’est une démission forcée, les membres de son parti ont fait de lui un bouc émissaire pour dire : nous changeons de premier ministre, cela signifie que les problèmes vont être résolus », remarque un observateur. « Il n’était pas envisageable que la coalition au pouvoir conserve l’un des plus anciens dirigeants de l’une de ses factions [il était à la tête du SEPDM depuis 2001] tout en se réclamant d’une perspective de changement et de renouveau », analyse l’écrivain et politologue éthiopien Hassen Hussein, professeur adjoint à l’université Saint Mary, dans le Minnesota.
Il semblerait qu’une rude bataille se livre désormais pour la succession de M. Hailemariam. « Des événements dignes de la série Game of Thrones », ironise un observateur. Certains commentateurs estiment que pour satisfaire le peuple, le prochain premier ministre doit faire partie de l’OPDO, compte tenu des attentes des Oromo, en première ligne de la contestation. Si le nom de Lemma Megersa était sur toutes les lèvres du fait de sa popularité auprès des jeunes, c’est finalement Abiy Ahmed Ali qui pourrait être le favori dans la course à la succession. Le vice-président de la région Oromia et chef du secrétariat de l’OPDO vient d’être nommé à la tête du parti, en remplacement de Lemma Megersa – qui n’est pas membre de la Chambre des représentants des peuples, une condition sine qua non pour être premier ministre. D’autres noms ont circulé, comme ceux du vice-premier ministre, Demeke Mekonnen (ANDM), et du ministre des affaires étrangères, Workneh Gebeyehu (OPDO), plus proches des réseaux tigréens.
« Le prochain premier ministre aura une tâche des plus difficile. Il devra lancer des réformes dans un contexte de fissuration croissante du parti, d’aigreur de la population à l’égard de ce dernier et d’exigence de changement », analyse le politologue Hassen Hussein. L’opposition, elle, souhaite plutôt un « changement de système », précise Bekele Gerba, de l’OFC. Le système étant opaque, et la culture du secret règne en Ethiopie, nul ne peut savoir quel nom sortira du chapeau. De ce choix dépendra l’avenir du pays, où la situation est extrêmement volatile. « Le cap que va prendre l’Ethiopie – réforme ou répression, pour simplifier – est loin d’être fixé. Du coup, il est trop tôt pour dire que l’Ethiopie s’enfonce dans la crise ou, au contraire, se dirige vers une porte de sortie », conclut le chercheur René Lefort.