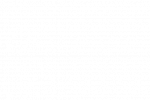De l’océanographie à la création littéraire, des bachelors forment à des métiers atypiques

De l’océanographie à la création littéraire, des bachelors forment à des métiers atypiques
Par Ingrid Seithumer, Ondine Debré
Pour travailler dans les métiers de la mer, la joaillerie, la police scientifique ou tenter de devenir écrivain, zoom sur quatre cursus postbac en trois ans, souvent uniques, proposés en France et en Suisse.
L’Institut national des sciences et techniques de la mer, à Cherbourg, propose un bachelor consacré à l’océanographie. / By HaguardDuNord / CC BY 3.0 (http://creative commons)
L’extrême souplesse du bachelor, cursus postbac en trois ou quatre ans, lui permet de s’adapter à toutes les disciplines. A Cherbourg, dans la Manche, c’est à l’océanographie qu’est consacré l’un des bachelors de l’Institut national des sciences et techniques de la mer, une filière du Conseil national des arts et métiers. Face à l’océan, juste après la dernière digue, des étudiants viennent ici, en formation initiale la plupart du temps, pour apprendre les métiers de l’hydrographie, de l’exploration des fonds marins, de l’exploration des ressources marines renouvelables…
Ce programme solide sur les métiers de la mer permet d’acquérir une formation qui peut mener plus loin que la rade de Cherbourg. C’est le cas de Thomas Linkowski, diplômé en 2011, qui navigue aujourd’hui sur les eaux glacées de l’Arctique pour un grand institut canadien.
Une deuxième année délocalisée au Pays de Galles
« Les ressources pétrolières [l’offshore pétrolier est l’un des domaines d’étude de l’océanographie] n’ont pas le vent en poupe chez nos étudiants », raconte Claire Marion, responsable de ce cursus de trois ans. Son originalité est de proposer une deuxième année délocalisée au Pays de Galles, à la South Wale University. Les étudiants viennent de toute la France, et même de plus loin encore puisque, cette année, l’un d’eux est indien.
Loin du littoral, la rue du Louvre, à Paris, abrite la plus ancienne école de joaillerie de la capitale, la Haute Ecole de joaillerie. Ici, les étudiants viennent apprendre les techniques de fabrication de la joaillerie et de ses pierres précieuses, mais aussi de la bijouterie et des métaux ciselés. Une école d’exception qui propose un bachelor en trois années pour former les futurs créateurs de la bijouterie et de la haute joaillerie, mais aussi du secteur de l’accessoire.
A travers des partenariats avec les grands noms de la place Vendôme, tels que Van Cleef & Arpels, Boucheron, Cartier, et grâce à l’intervention de nouveaux créateurs de mode, cet enseignement attire des étudiants du monde entier. « La création est au cœur de notre formation et nous formons les plus grands designers de bijoux », assure Michel Baldocchi, directeur de l’établissement.
Police scientifique, entre mythe et réalité
En Suisse aussi, les établissements jouent la carte de la singularité. Ainsi en est-il de ce bachelor de « science forensique » – étude des traces et de leur exploitation à des fins judiciaires – dispensé par l’Ecole des sciences criminelles (ESC) de l’université de Lausanne. « Nous sommes uniques dans le monde francophone », assure Olivier Ribaux, le directeur de cette institution créée en 1909, qui compte aujourd’hui quelque 600 étudiants, dont 20 % de Français (les formations sont assurées en français).
Forte de son statut – et du succès des séries télévisées qui font la part belle à l’investigation des scènes de crime par la police scientifique –, l’ESC a vu les effectifs de première année de ce bachelor augmenter de 50 % en six ans, atteignant 220 étudiants. « Nous perdons cependant beaucoup de monde en route », pondère Olivier Ribaux. En cause : le décalage entre le symbole véhiculé par les médias, le cinéma, la télévision et la réalité de la police scientifique, moins glamour ; et le niveau assez élevé des études.
En première année, l’accent est mis sur les sciences fondamentales : physique, mathématiques, chimie et informatique. Seule une quarantaine d’étudiants se retrouve en deuxième année. « Nous leur demandons une grande souplesse d’esprit », note Pierre Margot, grande figure de l’école qu’il a dirigée entre 1986 et 2015 et qui a œuvré à montrer à quel point l’utilisation de la « trace » était essentielle dans les scènes de crime. « Nous touchons à toutes les sciences et nous les utilisons à des fins particulières », résume l’homme dont le nom est associé à des affaires aussi célèbres que celles du Rainbow Warrior et du meurtre du petit Grégory.
La formation, qui devra être complétée par un master avant l’entrée dans le monde professionnel, est large. « La photographie [y] est très importante, c’est un outil indispensable au travail de la police scientifique », explique ainsi Luisa Rodrigues, croisée à la sortie de son oral de deuxième année. Le sujet de son examen : quels traitements peut-on faire sur Photoshop pour améliorer les traces de semelles ? Le programme comprend également des sciences humaines (droit pénal, criminologie), de la médecine (légale), de l’ingénierie (imagerie)… Est-ce pour cette raison que les femmes y sont majoritaires (60 %) ? « Il y a dans nos professions une justification sociale à l’usage des sciences, l’idée d’un usage des sciences pour rendre service à la société », avance Olivier Ribaux.
Ecrivain : un pied à l’étrier
C’est également son haut niveau d’exigence qui rend attractif l’Institut littéraire de Bienne. Cette branche de la Haute Ecole des arts de Berne, créée en 2006, propose un « bachelor en écriture littéraire » et accueille chaque année une quinzaine d’étudiants, triés sur le volet, en fonction de leurs talents d’écriture (un texte de 20 pages doit être soumis). C’est là qu’a été notamment formé le Français Thomas Flahaut, dont le premier roman Ostwald, paru il y a quelques mois aux Editions de l’Olivier, a séduit la critique avec son histoire postapocalyptique dans l’est de la France.
« Nous sommes les premiers à proposer cette formation littéraire diplômante en Suisse », souligne Marie Caffari, la directrice de l’Institut littéraire de Bienne. Dans la patrie de Molière et de Victor Hugo, un tel bachelor n’existe pas. « L’idée de l’écrivain solitaire génial y est encore très prégnante », juge Marie Caffari. Le « bachelor en écriture littéraire » helvétique, dispensé en français ou en allemand – faisant jonction entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, la petite ville de Bienne est bilingue –, se veut un cadre propice pour permettre aux étudiants de déployer leurs moyens d’expression littéraire tout en développant une réflexion au sein d’un groupe.
Le programme s’articule autour de quatre axes : les projets individuels d’écriture accompagnés par un mentor, les ateliers d’écriture avec intervention ponctuelle d’auteurs invités – Maylis de Kerangal (Réparer les vivants, Verticales, 2014) l’année dernière –, les cours d’analyse et de théorie littéraire, et le développement de projets en lien avec l’écriture. « L’Institut est un accélérateur dans le processus d’écriture, il m’a donné de la discipline et de la rigueur », indique Romain Buffat, qui a poursuivi par un master en littérature moderne à l’université de Lausanne après son bachelor et s’apprête à publier son premier roman en novembre prochain.
Si tous les étudiants, d’âges et de profils très variés, ont un désir fort de placer l’écriture au centre de leur vie professionnelle, la réalité peut être différente. « Nous sommes nombreux à rêver d’être auteur, explique Marilou Rytz, en dernière année de formation. Mais après mon bachelor, je ferai une autre formation dans le domaine social pour être certaine d’avoir un travail. » Comme le dit Marie Caffari, « personne n’attend un écrivain après un bachelor… »
Découvrez notre dossier spécial sur le bachelor
Le Monde publie, dans son édition datée du jeudi 15 février, un supplément dédié au bachelor, ce cursus de trois années qui séduit les bacheliers pour son enseignement concret, sa proximité avec les entreprises et son incroyable ouverture à l’international. Plus accessible qu’une classe prépa, le bachelor ouvre des perspectives en termes d’insertion professionnelle comme de poursuites d’études. Est-il la prochaine révolution du supérieur ou un miroir aux alouettes ?
Les différents articles du supplément seront progressivement mis en ligne sur Le Monde.fr Campus, dans la rubrique bachelor